Par Temba Nolutshungu.
Un article de Libre Afrique
Curieusement, la justification originelle de l’introduction des lois sur le salaire minimum en Afrique du Sud était de protéger la main-d’œuvre blanche contre la concurrence des « noirs ». À ce propos, le professeur Walter Williams, économiste américain, cite Henry Allan Fagan, juge de la Division d’Appel en Afrique du Sud, qui a déclaré en 1960 que :
Dans l’intérêt de la préservation et de la protection des intérêts acquis du mode de vie de la « meilleure partie » de la population, un taux de salaire pour le travail [qui signifie un salaire minimum imposé par la loi] et une réservation [de l’emploi] étaient nécessaires pour protéger les Blancs, les métisses et les asiatiques des Bantous.
Quand le salaire minimum excluait les noirs
Williams note également qu’aux États-Unis, la loi fédérale sur le salaire minimum de 1931 visait à exclure les travailleurs noirs de la concurrence avec leurs homologues blancs. Il cite alors le sénateur, Miles C. Allgood, qui a témoigné à l’appui de cette loi :
Cet employeur qui dispose de travailleurs de couleur bon marché, qu’il transporte et met dans des cabanes, c’est ce genre de travail qui est en concurrence avec la main-d’œuvre blanche à travers tout le pays.
Williams démontre également que la pensée de la Confrérie des cheminots (syndicat américain) coïncidait avec les idées du syndicat des mineurs sud-africains. Dans l’accord de Washington de 1910 entre le syndicat américain et la Southern Railroad Association, le syndicat a déclaré :
Lorsqu’il n’existe aucune différence entre le taux de rémunération des blancs et celle des gens de couleur, les restrictions quant au pourcentage de nègres à employer ne s’appliquent pas.
Leurs homologues sud-africains ont déclaré explicitement en 1919 :
Il s’agit maintenant d’une opposition du travail bon marché à ce qu’on appelle « le travail cher », et nous devrons demander à la Commission d’utiliser le mot « couleur » en l’absence du salaire minimum, mais quand ce salaire minimum est introduit, nous croyons que la plupart des aménagements relatifs à la question de couleur seront automatiquement abandonnés.
Le salaire minimum exclut les moins qualifiés
Cette dimension cachée des politiques du salaire minimum est résumée dans l’extrait suivant de l’essai du Professeur Thomas Sowell intitulé “Salaire minimum et conséquences inattendues” :
L’effet économique net des lois sur le salaire minimum est de rendre les travailleurs les moins qualifiés, les moins expérimentés ou les moins désirables, plus chers […]. S’ensuivront alors de grandes disparités dans les taux de chômage entre les jeunes et les adultes, les qualifiés et non qualifiés, et entre les différents groupes raciaux, comme étant les conséquences communes des lois sur le salaire minimum.
Les deux auteurs soulignent que, peu importe la motivation des lois sur le salaire minimum (programme discriminatoire ou considérations altruistes), l’effet est le même. Les lois sur le salaire minimum protègent les travailleurs au détriment des chômeurs, en particulier les chômeurs moins qualifiés. Elles protègent les premiers de la concurrence de ces derniers. Elles rendent impossible l’embauche de chômeurs à des salaires inférieurs au salaire minimum stipulé. De plus, elles constituent une barrière artificielle à l’emploi des demandeurs d’emploi peu qualifiés qui, en général, sont jeunes, inexpérimentés et désespérés d’accéder au marché du travail.
Et ce sont les économies en développement qui sont, par définition, intensives en travail, et ont donc une plus grande offre de main-d’œuvre non qualifiée et des taux de chômage plus élevés que les pays développés à forte intensité de capital, où les lois sur le salaire minimum sont plus nocives.
Les chômeurs préfèrent travailler qu’être dépendants
Dans les pays où les lois sur le salaire minimum existent, les chômeurs se trouvent confrontés à un choix cornélien : mourir de faim ou dépendre de l’État ou de la famille. Pourtant, d’évidence, la plupart des gens préfèrent travailler car le chômage est synonyme d’une pauvreté multidimensionnelle : faible estime de soi, érosion du respect de soi, désespoir et tentation de recourir à la criminalité.
Malgré ce constat, pour la sécurité et le confort d’un emploi fixe, certaines personnes ignorent ou font semblant d’ignorer la misère très visible des chômeurs. Elles préfèrent se réfugier dans une rhétorique populiste, en battant obstinément le tambour du «salaire décent pour un travail décent». Ces champions autoproclamés de la défense des pauvres ne font qu’aggraver leur situation de précarité.
En clair, la loi sur le salaire minimum équivaut à surprotéger tout en conduisant de fait à l’exclusion. Quand on sait que le chômage touche 36% de la main d’œuvre, ce genre de loi protectrice peut conduire le pays au désordre social voire à l’implosion.
—

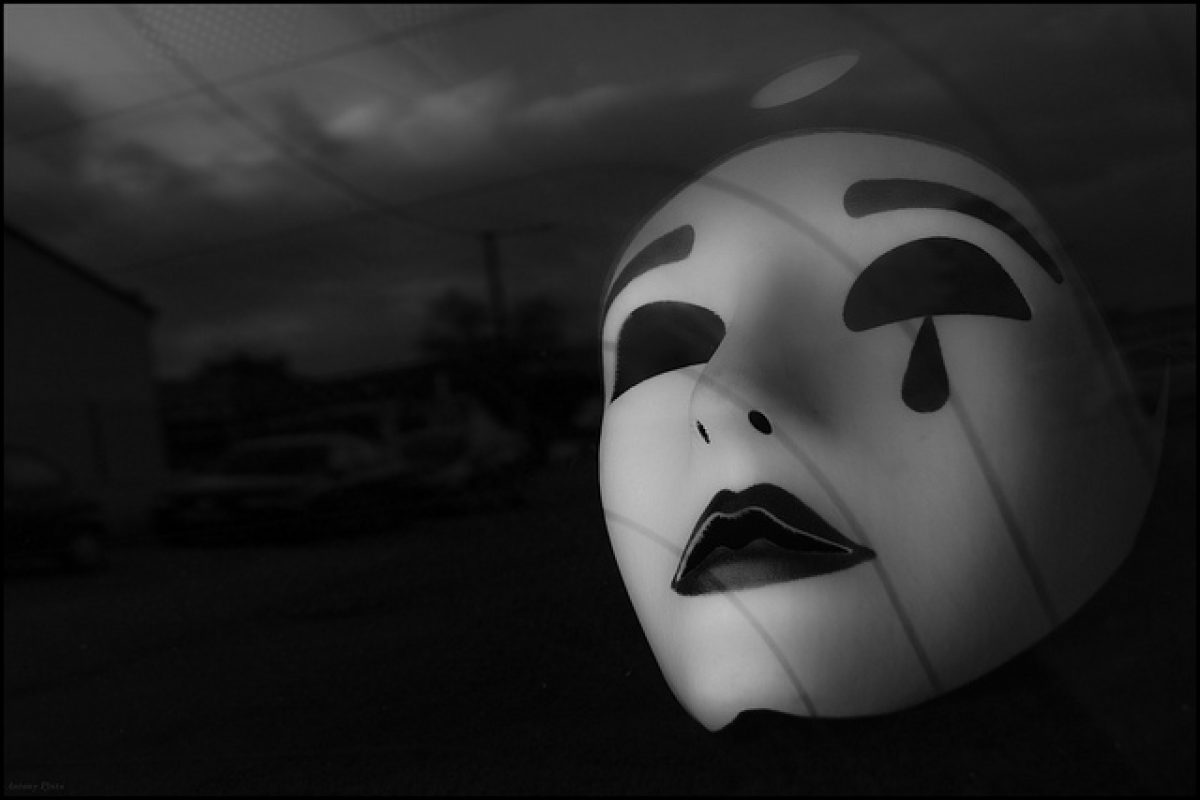

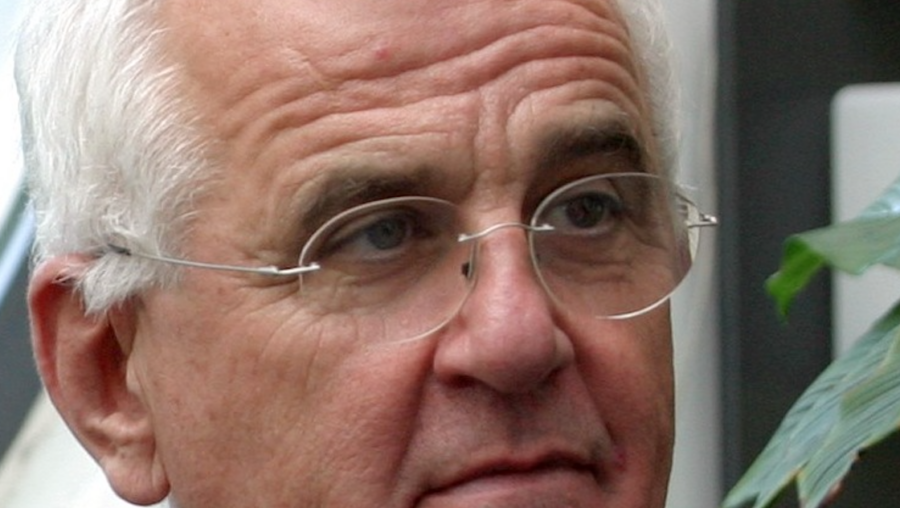

C’est intéressant mais il faudrait voir si ce cheminement s’applique en France ; je ne crois pas que ce soit le cas. Certaines agences d’intérim m’ont refusé certains postes pour une raison qui va peut-être vous surprendre : ces postes étaient réservés aux personnes sans qualification, voire à ceux qui ne parlent pas ou mal la langue française. Dans un souci d’efficacité les agences préfèrent garder sous le coude les personnes qualifiées pour un poste ayant moins de demandes et distribuer les postes ne demandant aucune qualification aux demandeurs n’ayant aucune chance sur les postes exigeant des qualifications. D’ailleurs les employeurs eux-mêmes rechignent à embaucher des personnes sur-qualifiées qui ont plus de chances de vouloir et pouvoir changer d’emploi. Par ailleurs certaines entreprises favorisent l’embauche de certaines ethnies qu’elles considèrent comme défavorisées dans le reste du monde du travail. Le point de vue abordé par votre article ne concorde pas avec mon expérience en France.