Par Johan Rivalland.

Le prix Nobel d’Économie 2016 a été décerné à l’Américano-britannique Oliver Hart, actuellement professeur à Harvard, et au Finlandais Bengt Holsmtröm, professeur au Massachusetts Institute of Technology, pour leurs travaux sur la « théorie du contrat ».
Il récompense ainsi deux chercheurs dans le domaine de la microéconomie et leur approche du marché en termes de contrat, autrement dit d’un accord entre deux parties dont les intérêts peuvent diverger, mais qui trouveront un terrain d’entente ou un intérêt commun à s’entendre.
Histoire de l’idée de contrat
La notion de contrat remonte à très loin dans l’histoire. Sur le plan de la théorie économique, on peut se remémorer par exemple la notion de « juste prix » chez Saint Thomas d’Aquin, qui contenait déjà en germe cette idée de contrat.
Elle peut s’appliquer à de nombreux domaines de l’économie et de la vie de tous les jours (contrat de travail, d’assurance, de crédit, etc.).
D’autres auteurs, à l’instar de Ronald Coase, ou Oliver Williamson, deux autres prix Nobel, ont travaillé sur la notion de « coûts de transaction ». C’est dans cette lignée que se situent les auteurs récompensés cette année, puisqu’Oliver Hart, par exemple, fait partie des investigateurs de la « théorie des contrats incomplets », qui s’intéresse aux contrats à durée longue et l’incertitude qui peut y être liée, induisant des effets pervers potentiels (par exemple concernant la part variable d’une rémunération qui serait conditionnée à des résultats futurs dont on ne peut mesurer s’ils seront liés à la motivation supplémentaire censée les favoriser : stock options, prime au rendement en fonction du nombre d’amendes dressées…).
Quel périmètre au secteur public ?
Plus précisément, ce qui est récompensé par le jury est le fait qu’ils ont « développé la théorie du contrat, un cadre exhaustif d’analyse des multiples aspects du contrat comme la rémunération des dirigeants basée sur leur performance, les franchises ou les co-payeurs dans les assurances, ou encore la privatisation de secteurs publics ».
Leurs travaux permettent par exemple de répondre, selon l’Académie du Nobel, à des questions telles que : « Les fournisseurs de services publics, comme les écoles, les hôpitaux ou les prisons, doivent-ils appartenir au public ou au privé ? Les enseignants, les personnels de santé, les gardiens de prison doivent-ils recevoir un salaire fixe ou indexé à leurs performances ? Dans quelle mesure les dirigeants d’entreprise doivent-ils être payés via des programmes de primes ou de stock-options ? » Sans que les auteurs cherchent à prendre parti dans les réponses à ces questions, leur rôle se limitant à la recherche fondamentale sur ces sujets.
Les deux chercheurs succèdent ainsi à Angus Deaton, récompensé l’an dernier, et à Jean Tirole il y a deux ans. Il porte à 56 le nombre d’Américains (y compris binationaux) primés, sur un total de 78 lauréats.


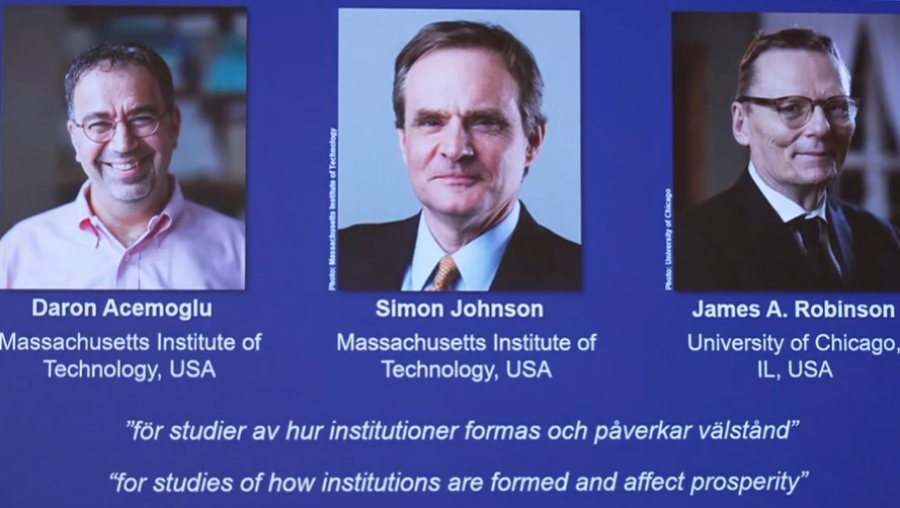
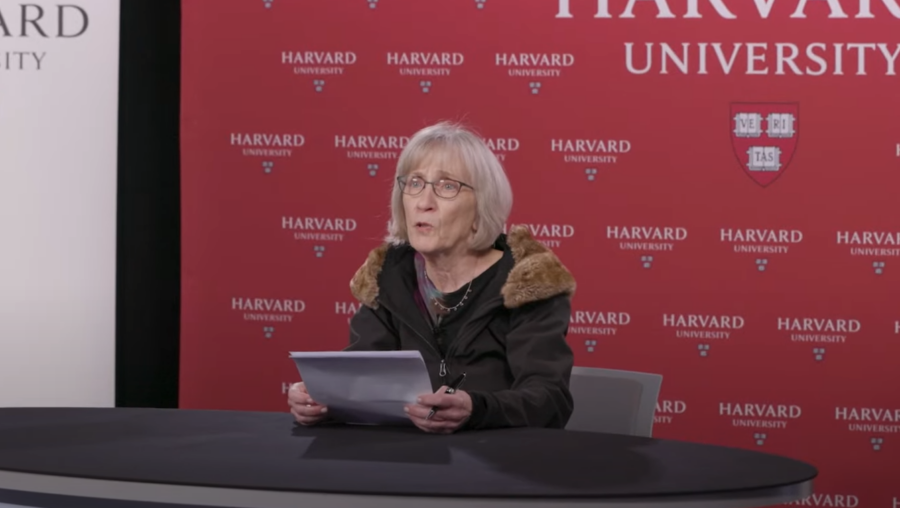
Merci pour cet article et bravo aux lauréats.
“Il porte à 56 le nombre d’Américains (y compris binationaux) primés” Lu ce matin sur Twitter que les six Américains nobélisés cette année sont tous des immigrés.
Sauf un lauréat descendant en droite ligne de Sitting Bull, c’est même 100% de l’ensemble !