Par Vincent Feré.
Un article de Trop Libre

Les commentaires récurrents et prévisibles sur les résultats du baccalauréat témoignent chaque été de la crise toujours plus profonde du système d’enseignement français. Cette année la polémique a même commencé avant leur parution.
Dans un entretien publié par Figaro vox le 24 juin dernier, la philosophe Bérénice Levet a, après d’autres, établi l’acte de décès de l’enseignement français : « l’École républicaine a implosé, elle n’est plus ». Ce qu’il en reste a-t-elle ajouté « vivote, maintenu, sans conviction, dans un entre-deux crépusculaire ».
Et si le pire n’était pas toujours sûr ? Et si l’élection présidentielle de 2017, contrairement à celle de 2012, était l’occasion d’une aube nouvelle pour l’École française ?
Un constat d’échec unanime
Madame Vallaud-Belkacem a eu beau déclarer plaisamment le 13 juin dernier : « la sélection à l’université existe. Elle porte le nom de bac », plus personne n’est dupe. La droite n’est pas seule pour constater que l’examen sanctionnant la fin de l’enseignement secondaire n’atteste pas nécessairement d’un niveau suffisant pour poursuivre avec succès des études supérieures. Ainsi, dans une note d’analyse du 9 mai 2016 — « 2017/2027, quelles priorités éducatives ? » —, France stratégie1 relève que « les enseignements tels qu’ils sont dispensés aujourd’hui préparent mal de nombreux élèves aux études supérieures et à l’insertion professionnelle ».
Et deux jours après la déclaration de la ministre, un rapport de Terra Nova — « Comment sauver le bac ? » — publiait une étude de l’inspection générale de 2011 relevant qu’en 2010 25,1% (série S) et 46,6% (série L) des bacheliers avaient obtenu leur diplôme avec une note inférieure à 10 dans deux des trois disciplines les plus caractéristiques de leur série. L’échec de l’enseignement secondaire prépare donc celui des étudiants dans le supérieur. On s’en doutait.
Sans surprise non plus, celui du secondaire trouve sa source dans le primaire. En dépit du renforcement de l’éducation prioritaire voulu par le gouvernement pour une École plus juste, le constat récent de la DEPP2 est accablant et confirme le diagnostic de l’OCDE à travers son enquête triennale PISA : le système français d’enseignement se situe parmi les plus inégalitaires : « à la fin de l’école primaire, près de 20% des élèves n’ont pas les bases suffisantes en français ; ils sont environ 30 % dans le cas des mathématiques et en science ».
Entre enfants de milieu favorisé et enfants d’origine défavorisée, c’est le grand écart 3. Au même moment une note d’analyse de France stratégie du 10 juin 2016 — « L’éducation peut-elle favoriser la croissance ? » — avance qu’avec des inégalités scolaires ramenées au niveau de celles de l’Allemagne, la France gagnerait « 11,5 milliards d’euros (bruts) en PIB annuels entre 2015 et 2050 » !
Il y a donc urgence à agir et pour cela, à droite comme à gauche, à lever certaines ambiguïtés.
Ambiguïtés politiques
Dans la perspective de l’élection présidentielle, la droite comme la gauche semblent, en matière d’École, se contenter d’un électoralisme prudent, peu à la hauteur des enjeux.
Les Républicains s’appuient sur l’hostilité du corps enseignant envers la réforme des collèges et, par l’intermédiaire de leur président, entendent réaffirmer la place des professeurs dans la transmission des connaissances et le respect dû à leur autorité. Prenant le contre-pied de la célèbre formule de Claude Allègre — « placer l’enfant au cœur du système éducatif » —, Nicolas Sarkozy écrit ainsi : « l’École de la République, c’est une École dont le professeur, le savoir qu’il dispense et l’autorité qu’il incarne forment les seuls piliers et pour tout dire le centre »4.
L’ambiguïté n’est toutefois pas levée puisque si selon Nicolas Sarkozy les enseignants du second degré « ne sont pas des éducateurs mais des professeurs et des maîtres », « leur présence dans les établissements ne peut plus se limiter aux seules heures de cours ». Ils ont donc d’autres tâches que l’enseignement, renvoyant à d’autres missions de l’École, mais le président des Républicains n’en dit rien.
Quant à la gauche, elle s’est récemment lancée dans une opération de reconquête du corps enseignant, sur fond d’augmentations de salaires. Seulement la déclinaison du protocole PPCR – parcours professionnels, carrières et rémunérations – ne s’accompagne d’aucune réforme sérieuse de pilotage du système. Et pourtant la note de France stratégie du 9 mai 2016 précise bien : « un effort pécuniaire supplémentaire pour l’éducation ne saurait améliorer nos résultats sans une évolution des contenus et des modalités de l’enseignement, tout comme de l’organisation et la gouvernance du système éducatif ».
Autre sujet sensible : l’autonomie. À droite comme à gauche, des voix plaident pour davantage de libertés dans le fonctionnement de l’École. Mais électoralisme oblige, le gouvernement entend poser des règles de contrôle plus strictes d’ouverture des écoles hors contrat, relayant une proposition de loi du député républicain Éric Ciotti.
Qui peut dire que ces ambiguïtés politiques sont au niveau des défis de l’avenir ?
En 2017, sortir de « l’entre-deux crépusculaire »
Après des années d’errements et de vaines querelles idéologiques, l’École française mérite mieux qu’une instrumentalisation électorale grossière. Qu’il faille rétablir l’autorité des professeurs, améliorer leurs rémunérations et lutter contre les foyers de radicalisation islamiste, nul n’en disconviendra. Mais l’électoralisme à courte vue ne peut être qu’une source de déconvenues pour tous les acteurs du système, et finalement pour l’ensemble des citoyens. 2012 l’a bien montré.
L’École française mérite également beaucoup mieux qu’un simple constat de décès. Elle ne peut pas non plus continuer de « vivoter dans un entre-deux crépusculaire ». Dans le domaine de l’École, comme dans bien d’autres, la France est donc à l’heure des choix : la campagne électorale à venir doit permettre de les proposer et il appartient ensuite aux politiques de les assumer, au risque de découvrir des convergences au-delà des postures politiciennes.
Un préalable toutefois : la question du sens depuis trop longtemps oubliée. Bérénice Levet le dit fort bien : « si le mot de refondation a un sens, il implique de s’interroger sur les bases, les fondements de l’École et donc ses finalités. Il conviendrait de toute urgence d’instaurer des états généraux de l’École. Une seule question devrait aujourd’hui nous requérir : pour quoi l’École ? L’École pour quoi faire ? »
—


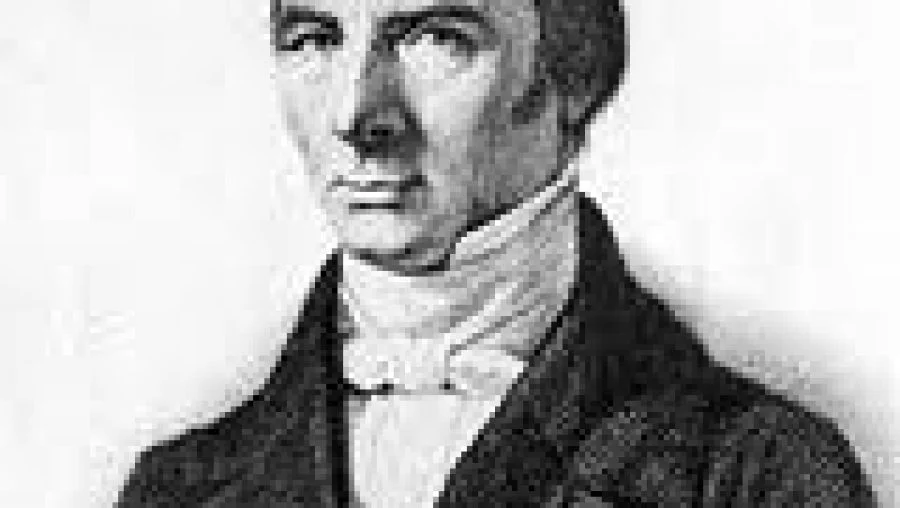


On oublie un peu trop que l’éducation est faite en grande partie par les parents. Les inégalités sont davantage liés à la ghettoïsation accrue des quartiers, et au fait qu’une part de plus en plus importante de la population sous-traite des tâches parentales aux enseignants : exemple entre autre : certains parents ne font aucune éducation au numérique, laissant les enfants 3h30 par jour en moyenne devant les écrans sans aucun contrôle des contenus, ce qui a fait chuter de moitié le temps de concentration des élèves dans les écoles en 30ans. Les contenus, eux, n’ont pas tellement changé quoiqu’on en dise.
Vous avez raison en grande partie, ce sont les méthodes et surtout les exigences qui ont changé, poussant à l’adaptation du niveau des examens. Du pur marxisme: sacrifier le plus grand nombre pour être sûr d’enfoncer les riches…
« 11,5 milliards d’euros (bruts) en PIB annuels entre 2015 et 2050 » !
comme quoi l’égalité n’est pas LA SOLUTION, le gain est négligeable
On ne pourra pas se passer de cette dimension éducative de la vie : l’école.
Pourquoi ?
Parce qu’elle est vital pour l’équilibre de la société et la vie de la cité.
Échouer dans ce domaine, c’est la déchéance certaine et cela pour des générations entières.
Autrement dit on est contraint de réussir en faisant de bon choix de réforme utiles et efficaces mais aussi adaptés à la réalité du moment.
C’est certainement l’une des chantiers avec celui de la santé qui valorise la grandeur et la réussite d’un projet de vie destiné à l’épanouissement d’une communauté.
Les malaises repérées dans ce secteur affectent trois éléments moteur du système éducatif :
Le corps éducatif (l’enseignement )
Le corps familial
L’apprenant
On mesure donc l’impact de mesures inadaptées dans ce secteur.
La réponse à la question est donc simple :
La réussite et que la réussite est admise
AC
Avant d’éduquer, qu’ils commencent par instruire et à donner l’habitude (je ne dis pas : le goût, qui est autre chose) de l’effort.
@tigrou777
Vous faites probablement référence au système d’éducation inégalitaire;
ce n’est pas dus aux logements sociaux dans lesquels les institutions gouvernementales placent systématiquement ou presque, leurs clientèles ou futures clientèles électorales; cette population serait sous cultivée, ne parlerait pas correctement la langue, puisque venant pour la plupart de pays et de systèmes moins développés ou modernes…J’utilise le conditionnel par politesse.
Et bien non, je ne pense pas qu’il y ait un quelconque rapport avec la ghettoïsation!
Si depuis la maternelle, l’école n’apprend rien aux élèves, ni l’effort, ni le travail, ni un contenu permettant de s’élever, alors seuls la culture et les choix des parents permettront d’élever l’enfant. Si les parents en savent peu, les enfants en sauront peu tout en vivant au parmi ceux qui en savent plus ou qui ont plus. La démagogie et le clientélisme politicien fait le reste. Pour peu que les parents entretiennent certaines haines, leurs enfants seront de gros problèmes
pour notre société.
Des politiques (je n’ai pas écrit politiciens) et des programmes scolaires inutiles et délétères, dispensés par des instituteurs dociles et par trop souvent idéologues on fait et font le résultat actuel.
Non seulement les élèves victimes de ce système en savent peu sur le cours comme en “culture générale”, mais ils ne savent rien du langage de la société dans laquelle leurs parents les ont fait naître, de sa politesse, de sa culture, mais aussi de sa manière de voir le monde.
Seul le ressentiment, largement entretenu par la victimisation clientéliste gauchisante semble être un levier de décision pour des individus devenus responsables.
L’égalitarisme interdit la diversité et la liberté. Et c’est dans la diversité et dans la liberté que chacun de nous pourra espérer trouver une place dans ce monde. Liberté, Responsabilité, égalité devant la loi.
Mais l’égalitarisme n’est-il pas un alibi pour la prise et la conservation du pouvoir?
Faut-il souhaiter que l’implosion de l’école républicaine soit évitée ?
Concernant PISA, en regardant le classement 2012 il se trouve que la France est quand même devant le Danemark, la Norvège, les USA, le Luxembourg, l’Espagne, l’Italie la Suède, ce qui relativise notre médiocrité. Quant aux 2 premiers, Japon et Corée du Sud qui se détachent du lot ils ont en commun une (non) fécondité record ainsi qu’une certaine imperméabilité à l’immigration.