Par Jean-Baptiste Besson.

Depuis 1974, aucune loi de finances n’a été votée à l’équilibre. Quarante et un ans de déficits publics cumulés et autant de dette accumulée (augmentation de 30 points de PIB en dix ans).
Au-delà de la question fondamentale des finances publiques, nombreux sont les sujets au cœur des débats économiques nationaux faisant chacun l’objet d’appels réguliers à des réformes structurelles profondes (chômage, marché de l’emploi, retraites, assurance-maladie, professions réglementées…). Les rapports ont souvent été signe de reports, tandis que les ambitieux projets de réforme ont souvent fini en simples réformettes. Les gouvernements pourtant se succèdent et cherchent tous le « guide de la réforme » parfait.
Et si la puissance publique s’inspirait des théories de la conduite du changement ? Tous les étudiants en management et les dirigeants d’entreprise ont étudié et appliqué les grands modèles de « change management ». Utilisés avec succès dans le secteur privé, ces modèles devraient être repris et compris dans la conduite des politiques publiques.
Inspirons-nous notamment des travaux de John Kotter, professeur à la Harvard Business School et de son ouvrage majeur Leading Change, vieux de vingt ans. Huit étapes devraient, selon lui, guider toute démarche de conduite du changement :
- créer un sentiment d’urgence ;
- créer une équipe de pilotage ;
- développer une vision et une stratégie ;
- communiquer la vision du changement ;
- responsabiliser les acteurs pour une large action ;
- générer des victoires rapides ;
- consolider les gains et approfondir les changements ;
- ancrer les nouvelles mesures dans la culture de l’institution
Quelles leçons tirer de ce guide pratique ? Tout d’abord, que toute réforme nécessite au préalable un climat propice au mouvement. Et ce, pour éviter les objections courantes du type Puma, « projet utile mais ailleurs » et les égoïsmes communs chez chacun d’entre nous, « la réforme oui, mais d’abord pour mon voisin ».
Or, nous avons besoin pour cela d’une prise de conscience collective de la nécessité de se réformer. Certains estiment que nous n’avons pas encore « touché le fond de la piscine » ou que seul un choc violent (obligataire, européen, politique, technologique) nous pousserait à changer.
Les Français semblent pourtant individuellement conscients de l’urgente nécessité de réformes, mais encore collectivement hostiles à tout changement. Ce qui fait défaut depuis quarante ans et explique les échecs successifs dans l’acceptation collective du changement est le manque de stratégie et de visions claires et collectives, portées par une « guiding coalition », pour reprendre les termes de John Kotter.
Tous les modèles de conduite du changement appellent également à la responsabilité des acteurs dans cette phase de changement. Or tous les gouvernants depuis quarante ans promettent de protéger les citoyens et d’apporter les solutions miracles : « inversion de la courbe du chômage », « fracture sociale », « tout devient possible », « force tranquille », « le changement, c’est maintenant ». Ce n’est pourtant pas d’une protection supplémentaire qu’il devrait être question, mais bien d’un appel à une plus grande responsabilisation des citoyens et d’une confiance renouvelée envers les Français.
Enfin, il conviendrait d’ancrer le changement dans la culture de notre pays. Nous sommes sur ce point aussi dans un paradoxe bien français. Nous sommes les plus friands de nouvelles technologies, les premiers à embrasser massivement les nouvelles tendances économiques, telle l’économie du partage pour le transport, le logement, la restauration. Nous aimons le changement et la créativité. Nous avons donc les capacités à nous ancrer durablement dans le changement. Inspirons-nous donc de ce qui se fait de mieux en matière de conduite du changement pour engager enfin durablement les réformes plus incontournables que jamais.
À lire aussi :
- Théorie du management versus leadership, sur Wikibéral
- Notre dossier entreprise et management
- Quelles réformes ? Propositions de réformes concrètes pour changer la France
—



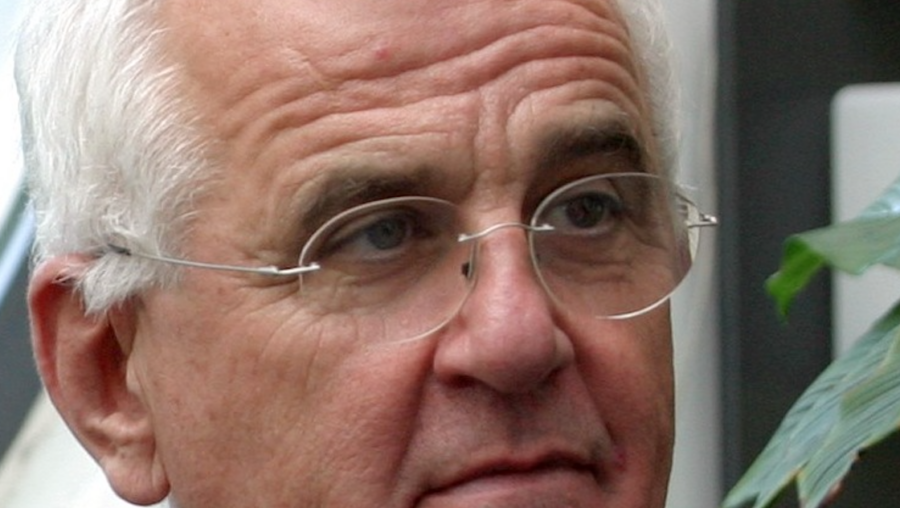

Avant de pouvoir réformer quoique ce soit, il faudrait mettre hors service les ” partenaires sociaux” abroger les privilèges des élus, des journalistes, et j’en passe…
Autant dire qu’il faudrait une révolution.
C’est pourquoi, les réformes ne se feront qu’à très petit pas…espérons dans le bon sens, ce qui n’est pas le cas actuellement.
Ce sont les politiques qui par corporatisme étatique bloquent toute réforme malgré les sondages qui démontrent que les français reformeraient plein de domaines en quelques référendums comme par exemple:
Réformer la retraite des fonctionnaires? Les Français sont pour à 75%
http://www.challenges.fr/patrimoine/20130607.CHA0508/retraite-des-fonctionnaires-75-des-francais-favorables-a-la-reforme.html
Trois quarts des Français hostiles au cumul des mandats local et parlementaire selon un sondage
http://www.20minutes.fr/societe/1227667-20130925-75-francais-hostiles-cumul-mandats-local-parlementaire-selon-sondage
Ceux qui s’opposent aux réformes tiennent sans partage possible tous les rênes du pouvoir, ce n’est pas une question de méthode ni de mentalité.
C’est vrai et c’est bien là qu’on voit que la France ou “la République” n’est plus du tout une démocratie: d’un côté, il y a ceux qui tiennent le pouvoir, quasi solidairement: grands patrons, politiciens de tous niveaux, fonctionnaires et syndicats: tous abusent d’un mandat public pour augmenter leur pouvoir, prestige et privilège personnels.
En face, la France qui travaille, d’une part, et les laissés pour compte, d’autre part.
Aucune réforme n’est à attendre des premiers! (De droite ou de gauche, c’est kif!).
La révolution commence toujours par une destruction: ce n’est pas la solution.
Un président qui vient de décider, seul, d’un 3ième front de guerre en bombardant la Syrie (et en espérant vendre des Rafales) “soutenu” par un pays doucement mais sûrement en ruine, sans croissance, sans emploi, sans avenir.
Malheureusement, je crois que seule une véritable sanction européenne pour cette promesse d’abord votée, ensuite adoptée par l’assemblée nationale puis suivie d’aucune concrétisation de suivre enfin les 3 règles “de Maastricht”, dites aussi critères de convergence, contrepartie logique d’une certaine unité de gestion entre partenaires d’une monnaie commune, promesse pourtant répétée chaque année, la main sur le coeur, par la France, devenu partenaire européen non crédible, ex co-moteur de l’Europe, avec l’Allemagne, et qui risque de se voir doubler dans le rôle par un D.Cameron victorieux dans son référendum, ce qui risque, une fois de plus de se faire retourner le Général Ch.De Gaulle dans sa tombe!
Franchement, je vous plains!
Intéressant, merci à Jean Baptiste Besson. Passons a la mise en œuvre en commençant par le premier point. Comment fait on pour générer un sentiment d’urgence?
En prenant l’entreprise comme modèle, le citoyen-électeur est le client, le politicien est le commercial. Au vu de ce qui est acheté-voté sur le marché électoral, les solutions libérales sont boudées. (voir les scores de Nous Citoyens et du PLD)
Plusieurs niveaux de responsabilités. Primo la demande de rente est bien organisée dans tout ce qui vit de l’argent public. Deuxio la demande libérale est trop rare chez le citoyen parce dépendante d’une prise de conscience individuelle. Tertio les producteurs (les contributeurs net) qui auraient intérêts à soutenir une offre libérale n’ont pas pris la peine de s’organiser partout où se tient une élection pourvue d’enjeux : députation, municipalité.
Quarto les libéraux n’exploitent pas le libéralisme, et croient que le citoyen va voter selon l’intérêt général. Cinquo en fait ce sont les producteurs s’ils daignent s’organiser pour faire valoir leur intérêts, qui équilibreront la demande politique, et donc les choix politiques de notre pays vers plus de liberté économique.