Dans son ouvrage de 2007, Timothy P. Roth compare les visions philosophique, morale et politique des Père fondateurs à celles du “libéralisme moderne”. Cette distinction met en perspective l’idée de liberté, la replaçant dans son contexte classique : celui de morale et de communauté.

Par Damien C.
 Dans Morality, Political Economy and American Constitutionalism, Timothy P. Roth met en parallèle la vision philosophique, morale et politique de l’homme qui animait les Pères fondateurs de la démocratie américaine avec la vision du “libéralisme moderne”. Roth met en lumière les profondes divergences entre ces deux opinions et les conséquences politiques qui en résultent, ce qui l’amène à conclure que jamais l’idéal politique des Pères fondateurs ne fut si compromis.
Dans Morality, Political Economy and American Constitutionalism, Timothy P. Roth met en parallèle la vision philosophique, morale et politique de l’homme qui animait les Pères fondateurs de la démocratie américaine avec la vision du “libéralisme moderne”. Roth met en lumière les profondes divergences entre ces deux opinions et les conséquences politiques qui en résultent, ce qui l’amène à conclure que jamais l’idéal politique des Pères fondateurs ne fut si compromis.
D’une vision morale à un projet politique
Les opinions des Pères fondateurs en matière politique, celles qui ont motivé leur projet de constitution pour les États-Unis d’Amérique, sont fondées sur leur compréhension de l’individu. Profondément influencés par la pensée de Kant et Smith, ils adhéraient à l’idée de la prépondérance du domaine moral dans la vie humaine, et croyaient les individus moralement équivalents. Dans un tel cadre synthétique entre Kant et Smith, l’individu découvre la « loi morale » à travers un processus de dédoublement, en faisant appel à une entité extérieure, le « spectateur impartial », qui montre la voie de l’action morale.
Cette figure du spectateur impartial est produite par les interactions entre les hommes, et est le reflet de leur société ; pour Jefferson, il est évident que « l’homme est formé par la société ». L’individu en leur temps est entièrement plongé dans ce que Buchanan appellera une « communauté morale », qu’il oppose à un « ordre moral » (situation où les individus agissent de façon morale les uns envers les autres mais sans idée de communauté) et à « l’anarchie morale » (situation où les individus se considèrent uniquement comme des moyens les uns pour les autres).
Dans un tel cadre de pensée, le politique n’est pas indissociable de cette morale prépondérante, et les lois en reprennent le trait caractéristique : constitution et législation doivent se conformer à l’impératif d’impartialité. Tout doit être fait, en matière constitutionnelle, pour éviter que des « factions » ne s’emparent du pouvoir de l’État afin d’imposer leur volonté particulière, et c’est dans ce sens, nous dit Roth, qu’à la Constitution des « précautions auxiliaires » sont ajoutées afin de limiter les risques de mainmise factieuse sur l’État fédéral : ainsi par exemple le fédéralisme (que Buchanan compare à la possibilité de refuser un bien sur un marché et qui mène à un certain conformisme des biens), garantie en matière politique d’une certaine conformité des législations et d’une diminution des menaces de discrimination.
Cette protection contre les factions et le comportement discriminatoire se reflète dans la politique économique. Là encore, comme chez Smith, l’économie politique ne se comprend pas autrement que comme un domaine spécifique de la philosophie morale. Roth nous renvoie alors aux discours de Kennedy qui fut le premier à promouvoir l’idée de cesser de considérer l’économie comme une question politique (et donc morale), mais comme une question technique seulement…
La fin de l’État est alors évidente : c’est la justice, conçue elle aussi comme impartiale, procédurale. Une telle insistance sur les moyens/procédures ne laisse pas de place ni au conséquentialisme, ni à l’utilitarisme, et ce même si les lois ne sont pas seulement intrinsèquement valables, mais aussi instrumentalement : tout comme Smith, les Pères fondateurs estimaient que la vertu et la morale se cultivent, notamment par l’exemple. Des lois vertueuses pour des citoyens vertueux. Le célèbre Bills of Rights, considéré comme une « barrière de papier » par ses promoteurs mêmes, a néanmoins à leurs yeux un rôle éducatif.
Car pour les Fondateurs, il est clair que tout cela a un corollaire indispensable : que la population soit elle-même dévouée à la loi morale, qu’elle soit vertueuse afin d’élire des représentants tout autant vertueux. Madison ainsi : “To suppose that any form of government will secure liberty as happiness without any virtue on the people, is a chimerical idea”. Cette vertu, c’est celle de Montesquieu, c’est-à-dire la préférence pour l’intérêt public face à l’intérêt privé, et l’amour des lois de son pays. Ainsi la liberté c’est agir en conformité avec les lois de sa communauté, dans la mesure où celles-ci sont vertueuses.
Le modern liberalism, une pensée différente et instable
Cette vision des Pères fondateurs, dit Roth, contraste sérieusement avec ce qu’il appelle le “modern liberalism”. Celui-ci est un symptôme du « mensonge romantique » : l’individu est compris non pas comme membre d’une communauté mais transcendentalement autonome, c’est-à-dire capable d’avoir ses propres préférences et désirs ; ceux-ci sont entre les individus tous également valables, aucun ne peut se proclamer supérieur. Dans ce cadre, l’État n’a pas à postuler de théorie du bien, et doit assurer un “égal respect” entre tous les individus et leurs préférences, leur accordant un “égal traitement”. Mais il reste alors à définir ce que veut dire concrètement cet “égal respect”. Pour le principal auteur de ce courant, Dworkin, c’est surtout s’assurer que les préférences individuelles ne soient pas dominées par des préférences extérieures, ce qui nierait la liberté de l’individu, liberté ici conçue comme transcendantale, coupée de tout référentiel terrestre ou communautaire.
Roth retrace alors le déroulement logique d’une telle idée : que fera le « modern liberal » qui fonde un État, une société ? Il commencera par partager les ressources initiales également, puis adoptera les institutions qui permettent à chacun d’exprimer leurs préférences, c’est-à-dire le marché pour les préférences économiques, et la démocratie pour les préférences politiques.
Cependant le marché va très vite créer des inégalités entre les sociétaires, et celles-ci risquent de permettre à des préférences extérieures de s’imposer aux préférences individuelles. Très vite le liberal différencie les inégalités qui sont acceptables et celles qui ne sont inacceptables. Il utilise alors la Théorie Économique de l’État, théorie utilitariste qui postule, à l’aide des concepts d’homo œconomicus et de cette définition des inégalités interdites, l’existence d’un équilibre éthiquement neutre qu’il s’agit d’atteindre en intervenant dans le marché. Et pour protéger les individus de cet utilitarisme, mais aussi du principe majoritaire de la démocratie, le modern liberalism déclarera des droits qui auront donc une valeur instrumentale.
L’argument de Roth est de montrer que cette théorie est intenable, non seulement à cause des failles de la théorie économique sur laquelle elle s’appuie (l’homo œconomicus, l’idée même d’équilibre), mais surtout car elle tente d’articuler une théorie des droits (en premier lieu celui d’égale considération) et une théorie du bien (situation où tout le monde est considéré également, c’est-à-dire où personne n’est dominé par des préférences extérieures), cette dernière nécessitant l’utilitarisme. Or les institutions utilitaristes ne promeuvent pas le juste (l’utilitarisme peine d’ailleurs, selon Roth, à donner une définition solide de la justice, ou alors comme le disait Rawls en confondant « impersonnalité et impartialité »), mais le bien. Entièrement basées sur leurs résultats, elles sont jugées en termes d’efficacité. Et en face d’elles, l’idée de droit, pourtant une des bases de la théorie, ne peut subsister car cet utilitarisme leur refuse toute force morale, donc toute existence autre que contingente.
Ce modern liberalism est donc instable, et la philosophie qu’il avance mène à des impasses. Un chapitre critique ainsi cordialement les théories économiques “positivistes” qui fondent la Social Welfare Theory (et au sein desquelles on peut placer le “néo-libéralisme” économique, d’ailleurs), qui se veulent value-free et sans rapport avec les institutions. Encore une fois en total désaccord avec les Pères fondateurs pour qui c’étaient justement ces institutions qui importaient, comme capables de faire vivre en leur sein un peuple en accord avec la loi morale et ce sans que des factions ne puissent remporter le pouvoir.
Conclusion
En bref, cette disjonction entre les Pères fondateurs (et leurs modèles Smith et Kant) et le modern liberalism se révèle éclairante à plus d’un titre. Avant tout elle remet en doute les références souvent mal inspirées faites à ces Pères fondateurs : combien d’économistes « néo-libéraux », donc partisans d’une science amorale, se déclarent encore d’Adam Smith ? Combien d’hommes politiques américain invoquant Madison se souviennent qu’il refusait toute subvention ou aide publique au nom du principe de non-discrimination ?
Surtout enfin, cette disjonction remet en question l’idée de liberté, la replaçant dans son contexte classique : celui de morale et de communauté. À l’heure où l’idée de liberté est souvent vulgairement comprise comme « faire ce que je veux », ce rappel est salvateur.
—
Timothy P. Roth • Morality, Political Economy, and American Constitutionalism • Edward Elgar, 2007

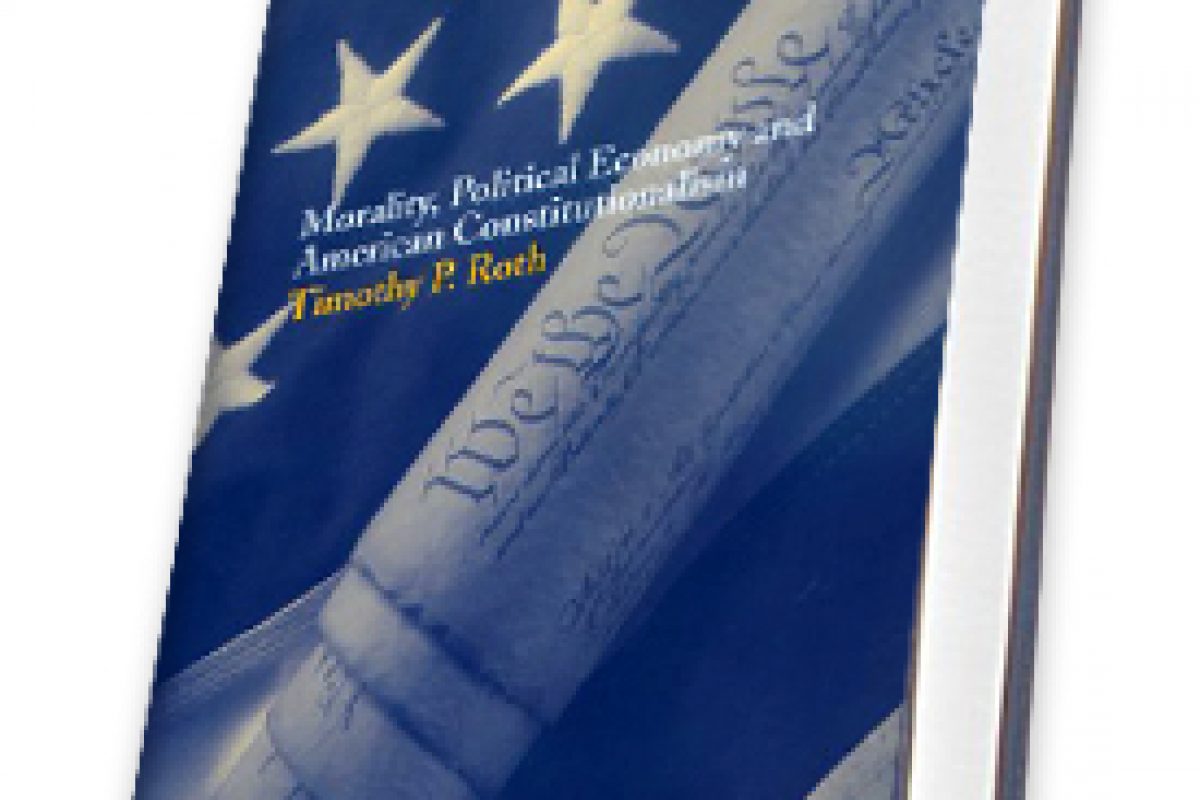



Laisser un commentaire
Créer un compte