Hier, 4 juillet 2012, les Américains célébraient leur Déclaration d’Indépendance, une fête qu’ils appellent “Fourth of July” ou bien encore “Independence Day”. Selon cette Déclaration, rédigée par Thomas Jefferson, tous les hommes sont créés égaux ; ils sont dotés de certains droits inaliénables (vie, liberté, propriété et recherche du bonheur). Le but d’un gouvernement est uniquement d’assurer ces droits.
Par Damien Theillier.
 L’enjeu de l’indépendance était la réaffirmation des principes traditionnels de la citoyenneté britannique. C’est pourquoi la Révolution américaine fut, au sens étymologique, un « retour » à l’héritage des libertés anglaises. Contrairement aux français, les anglais au 18e siècle n’avaient pas d’armée permanente, pas de lettres de cachet, pas d’arrestations arbitraires. Ils avaient leur habeas corpus, leur procès par jury, leur liberté d’expression et de conscience, et leur droit au commerce. La Révolution américaine fut une révolution conservatrice et non une table rase du passé, comme le fut en partie la Révolution française.
L’enjeu de l’indépendance était la réaffirmation des principes traditionnels de la citoyenneté britannique. C’est pourquoi la Révolution américaine fut, au sens étymologique, un « retour » à l’héritage des libertés anglaises. Contrairement aux français, les anglais au 18e siècle n’avaient pas d’armée permanente, pas de lettres de cachet, pas d’arrestations arbitraires. Ils avaient leur habeas corpus, leur procès par jury, leur liberté d’expression et de conscience, et leur droit au commerce. La Révolution américaine fut une révolution conservatrice et non une table rase du passé, comme le fut en partie la Révolution française.
Thomas Jefferson a expliqué que la Déclaration d’indépendance était fondée sur des “livres élémentaires de droit public, comme ceux d’Aristote, de Cicéron, de Locke, etc.” Pour Aristote, le droit naturel a une fonction critique vis à vis de la loi positive, il fonde l’autorité des lois (le droit positif) en garantissant leur justice. Pour Cicéron, il s’agit d'”une seule loi éternelle et invariable, valide pour toutes les nations et en tout temps”. Enfin, pour Locke Le droit naturel est la reconnaissance par l’ordre politique des droits personnels naturellement possédés par chacun, en particulier le droit de propriété : droit à la vie et à la liberté (propriété de soi) et droit à la possession des biens acquis par le travail (propriété des choses).
Le 4 juillet 1776, après quelques modifications de John Adams et Benjamin Franklin, la Déclaration d’indépendance est adoptée par les treize colonies en assemblée à Philadelphie.
En voici un passage célèbre :
Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes : tous les hommes sont créés égaux ; ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits, et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Toutes les fois qu’une forme de gouvernement devient destructive de ce but, le peuple a le droit de la changer ou de l’abolir et d’établir un nouveau gouvernement, en le fondant sur les principes et en l’organisant en la forme qui lui paraîtront les plus propres à lui donner la sûreté et le bonheur.
Leonard Read (créateur de l’institut de recherche Foundation for Economic Education) a écrit un jour que l’essence même de la Révolution américaine était contenue dans un morceau de phrase de la Déclaration d’indépendance. « Je ne pense pas que la révolution américaine réelle se confonde avec le conflit armé des colonies contre le roi George III. La vraie révolution américaine consiste dans un nouveau concept ou une idée qui rompt avec toute l’histoire politique du monde ». Selon Read, « cette nouvelle idée est la suivante : Tous les hommes sont créés égaux ; ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. C’est tout. C’est l’essence même de l’identité américaine. C’est le roc sur lequel l’ensemble du ‘miracle américain’ a été fondé ».
Ce concept révolutionnaire, poursuit Leonard Read, est à la fois spirituel, politique et économique :
- Il est spirituel en ce que le rédacteur de la Déclaration reconnaît et proclame publiquement que le Créateur est la source des droits de l’homme, et donc le Créateur est souverain.
- Il est politique en ce qu’il nie implicitement que l’État soit la source des droits de l’homme, déclarant ainsi que l’État n’est pas souverain.
- Il est d’ordre économique en ce sens que si une personne a droit à la vie, il s’ensuit qu’elle a le droit de conserver sa vie, de la nourrir par les fruits de son propre travail.
À voir : l’excellente mini-série américaine John Adams (disponible en DVD) dont voici un extrait :
Sur le web.



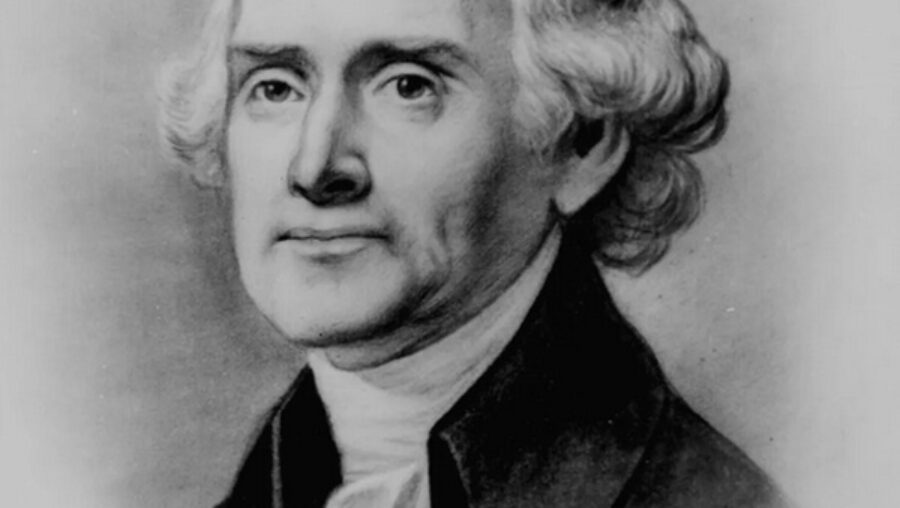
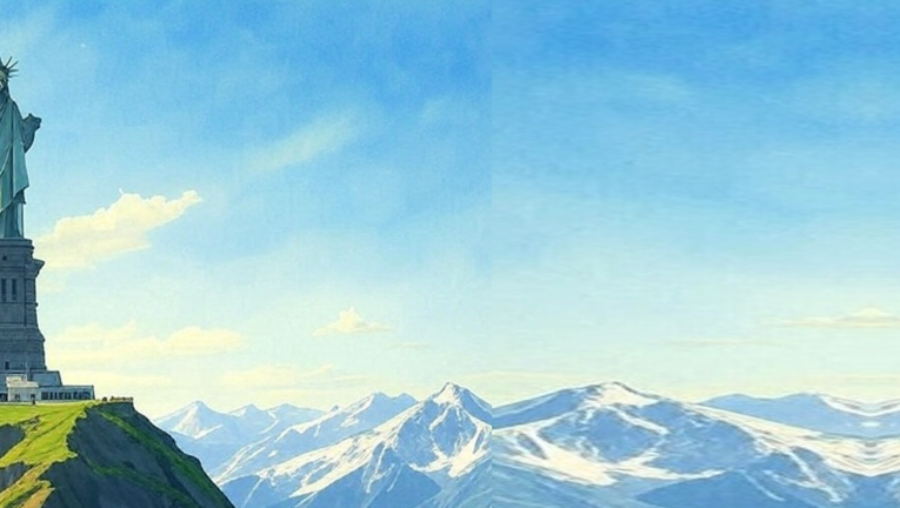

RT @Contrepoints: Les principes philosophiques de la révolution américaine Hier, 4 juillet 2012, les Américains célébraient l… http:/ …
A comparer avec la déclaration des droits de l’homme et du citoyen
“…..l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être Suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen”.