Une récente décision de la Cour européenne des droits de l’homme présente le droit à la protection des sources, non pas comme un privilège attribué aux journalistes, mais comme un attribut du “droit à l’information”. Que faut-il en penser ?
Par Michel Desgranges.
 Une récente décision de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la protection des sources (des journalistes, pour celles d’eau minérale il y a d’autres lois) a fait l’objet ici même d’une fine analyse par Madame Roseline Letteron qui en a exactement situé les conséquences d’un point de vue juridique.
Une récente décision de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la protection des sources (des journalistes, pour celles d’eau minérale il y a d’autres lois) a fait l’objet ici même d’une fine analyse par Madame Roseline Letteron qui en a exactement situé les conséquences d’un point de vue juridique.
Dans cette affaire s’entrecroisent, se chevauchent ou se heurtent divers sujets : liberté d’expression, code de procédure pénale, droit à l’information et même protection des sources. Je ne m’arrêterai pas à la liberté d’expression, inexistante en France, ni à la procédure pénale qui ignore tant l’habeas corpus que la protection du domicile (my home my kingdom, cela n’a pas cours au pays des droits de l’homme), livrant ainsi pieds et poings liés à la brutalité des policiers et des magistrats tout individu tombant entre leurs griffes.
Mais le droit à l’information ? La protection des sources ? Je souhaite tenter d’examiner, d’un point de vue libéral, et même selon un très ordinaire bon sens, ces deux… quoi ? Concepts ? Normes ? Topiques ? Nuages de fumée ?
Commençons par la première bestiole.
La distinction entre droit de et droit à est, nous le savons, fondamentale : autant le premier est légitime (naturel ?) et fonde toute société libre, autant le second oscille selon le vent entre prétexte de spoliation et absence de sens. Ainsi le droit au logement signifie-t-il qu’un individu quelconque disposera d’un logement sans le payer mais au préjudice d’un tiers (dans ce cas, comme s’il était un droit de le droit à devient opposable à un tiers qui sera l’État, une municipalité, un voisin plus riche…) tandis que le droit à la santé ne signifie rigoureusement rien, car contre qui un individu atteint d’un cancer incurable va-t-il l’exercer, son droit constitutionnellement garanti ? (En fait, il faut comprendre : droit aux soins, id- est droit d’obtenir des soins dont le coût est supporté par autrui).
Notre droit à l’information, lui, est apparu voici quelques décennies, venant d’outre-Atlantique, pour désigner le droit consenti à tout citoyen d’obtenir (sous certaines conditions…) communication des informations le concernant et détenues par diverses administrations – il s’agit donc d’un droit de opposable aux bureaucrates (et étendu aux médecins pour le “dossier médical “). Poser alors un “droit de communication” eût eu le mérite de la clarté et de la précision juridique, mais c’est l’informe droit à l’information qui fut imposé. Lequel, hautement affirmé tant dans les discours que dans les textes normatifs, revêt des significations bien différentes selon qu’il est interprété par le citoyen solidaire, responsable et revendicatif ou le professionnel de la commercialisation de l’information – le journaliste.
Pour le citoyen, ce droit à peut s’identifier à un “droit à l’égalité d’accès “, revendication que l’on trouve aujourd’hui accolée à la culture, à l’éducation, aux loisirs, demain sans doute à l’intelligence et à la beauté, et même aux galipettes avec la starlette de son choix. Et c’est fort logiquement que s’est tenu le raisonnement suivant : a/ la première source d’information est dorénavant l’internet ; b/ l’accès égal à l’internet se matérialise par l’arrivée de fibre optique dans tout foyer ; conclusion : tout foyer doit être équipé de fibre optique, ce qui sera financé non par le bénéficiaire mais par un impôt prélevé sur… peu importe sur quoi et qui, et peu importe que cela ait été ou non inscrit dans la loi, bornons nous à constater que la nature du droit à est de générer une nouvelle spoliation. Ajoutons que le droit à l’information est également une très bienvenue justification des grasses subventions que reçoit la presse, laquelle, si elle était vendue à son coût, ne pourrait être accessible aux plus démunis, défavorisés, piétinés de la crise, malchanceux au loto etc.
Hors toutes conséquences économiques, ce droit sera banalement interprété par l’homme de la rue comme le droit que possède désormais tout individu à entrer en possession de toute information sur n’importe quoi et n’importe qui, rejoignant ainsi une déplaisante divinité moderne : la transparence.
Pour le journaliste, ce remarquable droit à signifie : a/le droit d’obtenir de l’information ; b/le droit de publier cette information.
Cette information peut être obtenue grâce à des sources lesquelles peuvent, pour de multiples raisons, vouloir demeurer cachées et n’accepteront de fournir une information au journaliste qu’à cette condition de secret, qui ne peut être effectivement garantie que si elle s’inscrit dans un cadre juridique favorable, d’où la protection des sources, désormais affirmée par une jurisprudence sur laquelle Mme Letteron a dit ce qu’il fallait en dire.
Ce que je veux relever se situe à un autre niveau : contrairement au savant qui, dans ses travaux, s’oblige à citer ses sources, le journaliste échappe à cette contrainte : il lui suffit d’affirmer, sans avoir à se soucier de justifier ce qui fonde son affirmation (qui sera appelée récit, enquête, document, ad libitum).
Nous avons donc obtenu une avancée significative de la liberté de la presse : le journaliste est dorénavant légalement libre d’inventer ce qui lui chante, ou de déformer, manipuler, et, plus fréquemment, produire hors contexte — puisqu’aucune source ne pourra être convoquée pour le démentir ou corriger.
Imaginons maintenant qu’un quelconque individu décide de brandir son droit à l’information (pris alors dans son sens banal de droit de tout savoir et transparence) pour exiger du journaliste la révélation de ses sources. Lequel de ces deux droits en conflit l’emportera ?

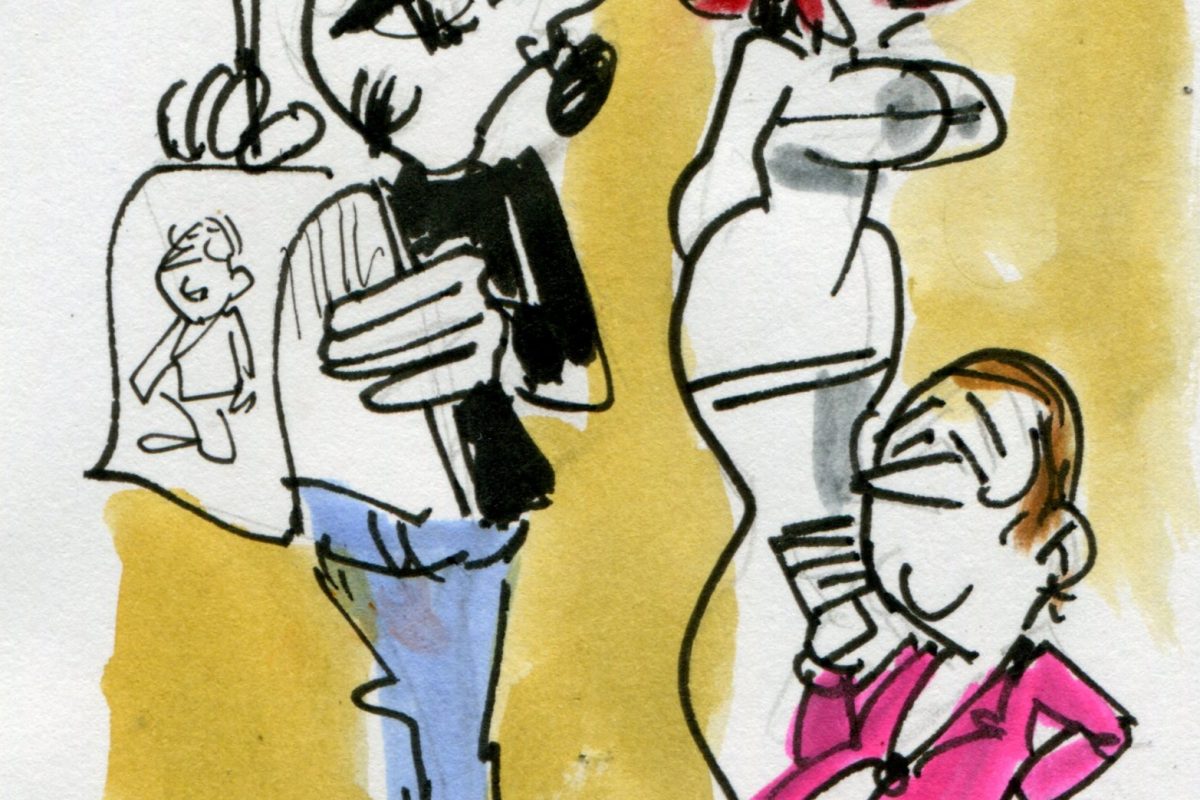
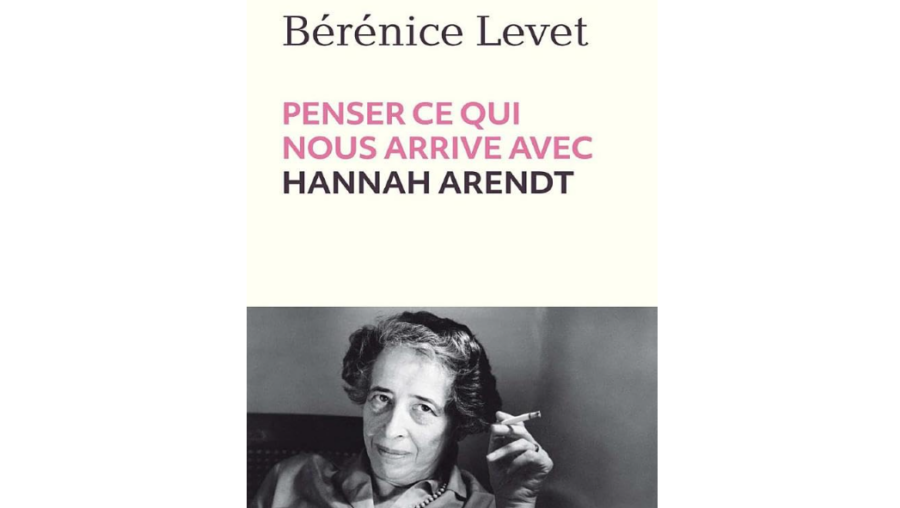


Le droit à la santé n’est pas un droit à n’avoir pas le cancer, ni un droit aux soins au frais de la princesse , c’est le droit de ne pas se faire pourrir la santé par les mauvaises actions d’autrui. C’est en fait une formulation (mauvaise et superflue !) du principe de non agression, permettant de prendre des mesures contre l’air malsain par exemple (alors qu’il ne peut être question de poursuivre les milliers d’utilisateurs de véhicules polluant chacun de façon négligeable mais collectivement de manière sensible).
C’est donc un droit de, pas un droit à, en dépit de sa forme.
Euh… NON. Le droit à la protection des sources n’autorise en rien un journaliste à dire n’importe quoi. Il vise à protéger les sources d’info, ces sources donnant au journalistes des infos, étayée ou pas – à charge du journaliste de documenter ces infos de façon irréfutable avant de les utiliser.
Par ailleurs, ne plus protéger les sources reviendrait à tuer le droit d’accès à l’info, lequel est corrompu lorsqu’il faut que des sources anonymes s’avancent afin de dévoiler ce qui est caché.