En dépit des rodomontades des différents gouvernements, on paie toujours les jours de grèves, sinon en totalité, du moins en grande partie. C’est à nous que la grève coûte cher.
Par Guirec Le Guen
Article publié en collaboration avec le Cri du Contribuable.
 Dans la fonction publique française, la grève est une institution.
Dans la fonction publique française, la grève est une institution.
C’est même une institution vénérable puisqu’elle constitue l’un des principaux droits nouveaux contenus dans le statut Thorez de 1946. Le remettre un tant soi peu en cause, c’est s’en prendre aux fonctionnaires, c’est-à-dire aux gardiens de l’intérêt national et mieux encore, aux gardiens de la justice sociale. On l’a vu lors de la tentative de mettre en place un service minimum élargi, au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy. L’idée même de service minimum résonnait comme un blasphème épouvantable.
Selon l’administration, le nombre de jours perdus pour « fait de grève » a été de 1 851 083 en 2010, uniquement pour les ministères. Entre 1999 et 2010, 1,45 million de jours ont été perdus en moyenne chaque année. Ce chiffre concerne les personnels de l’État, de la Caisse des dépôts, de France Télécom et de La Poste
Il est vrai que fonctionnaires et para-fonctionnaires du secteur public font volontiers la grève. On a vu ainsi, en 2010, les agents des transports en commun (SNCF, RATP) débrayer contre un texte qui ne les concernait nullement.
Incitation à la grève
Il est vrai que les fonctionnaires grévistes ne risquent pas grand-chose pour leur salaire. Aux termes de la loi, une journée de grève donne lieu à une retenue d’une journée de salaire sur un mois. C’est ce que l’on appelle le « trentième indivisible ». Dans la réalité, les retenues prévues sont appliquées plus que mollement au point que l’on peut parler d’une véritable incitation à la grève.
En dépit des rodomontades des différents gouvernements, on paie toujours les jours de grèves, sinon en totalité, du moins en grande partie. Mieux encore : plus la grève est longue, plus le paiement des jours de grève fait partie des revendications non négociables, ce qui entraîne trop souvent le durcissement des conflits et un véritable désastre économique puisque l’argent dépensé est le fruit d’un non-travail. C’est à nous que la grève coûte cher.
—

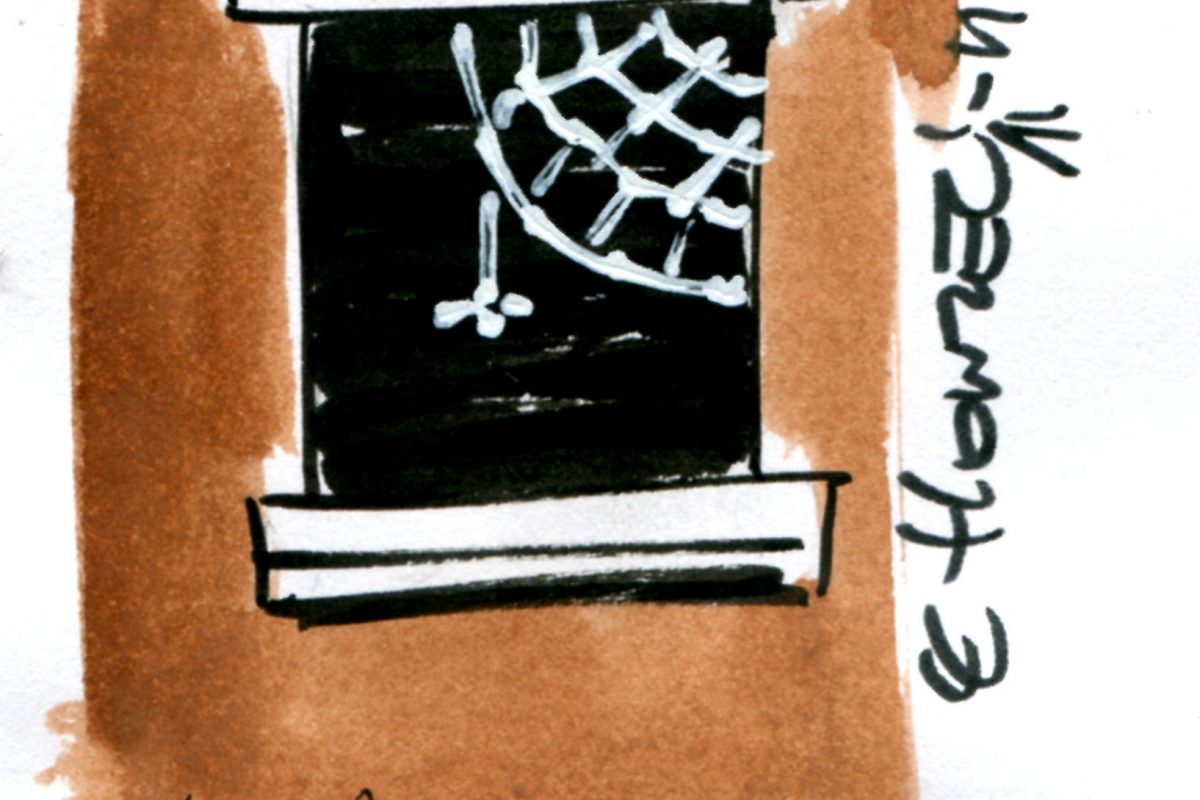
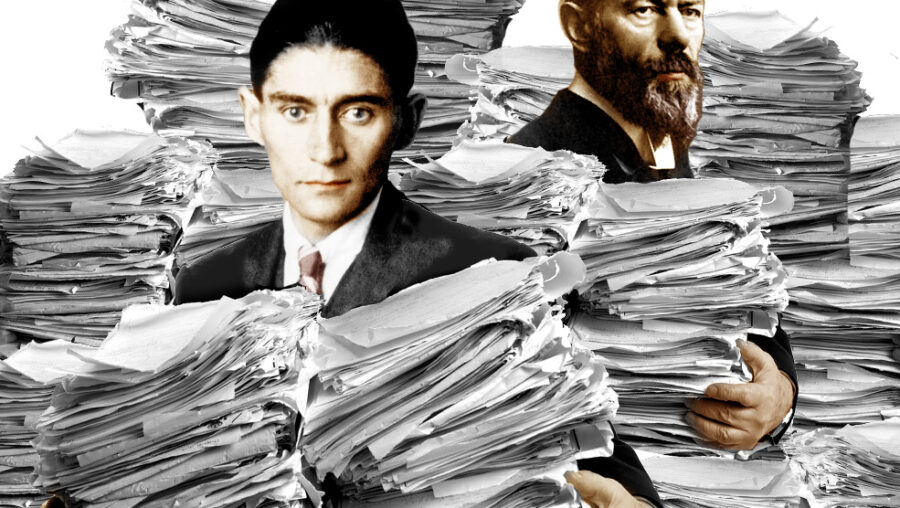

RT @Contrepoints: Fonction publique, la #grève est à nos frais http://t.co/EMXMpL3l @_servicepublic @SNESFSU
Les grèves de la fonction publique sont payées. Payées par vous. http://t.co/51UUmdgp
#greves #fonctionpublique
RT @NickdeCusa: Les grèves de la fonction publique sont payées. Payées par vous. http://t.co/51UUmdgp
#greves #fonctionpublique
Un élément de plus qui confirme la confiscation de la France par la caste bureaucrates-politiques cumulards
Depuis quand le personnel de la Poste est payé par les caisses de l’état ?
La Poste a une gestion indépendante concernant les salaires.
Encore une fois, renseignez vous…
Il y a des fonctionnaires plus chanceux que d’autres. Le personnel enseignant l’éducation nationale est toujours retenu d’une journée de salaire par jour de grève. (au sens comptable de l’administration, qui est un peu spécial : grève lundi-mardi 2 jours de retenue, grève samedi-lundi 4 jours)
Fonction publique, la #grève est à nos #frais http://t.co/ssx5bKOB @stoplagreve
mauvais article : aucun contenu factuel vérifiable (on paie toujours les jours de grève, vraiment ? source ?)
Fonction publique, la #grève est à nos #frais http://t.co/AwaTbgvx @stoplagreve
“Fonction publique, la grève est à nos frais” http://t.co/DZRfnYSX via @Contrepoints
Fonction publique, la #grève est à nos #frais http://t.co/CYEyN1Si @stoplagreve
Le raisonnement est faux. Il part du mensonge gouvernemental selon lequel on lève des impôts pour financer des dépenses. En réalité, l’Etat prélève autant que possible et puis découvre d’innombrables façons de dépenser cet argent. Ce qu’il économiserait sur le salaire des fonctionnaires, il le dépenserait immédiatement pour autre chose. Pour le contribuable, ça ne change strictement rien à l’addition finale que les jours de grève soient payés ou non !
Absolument d’accord avec votre raisonnement !
message précédent @ pasm
Fonction publique, la #grève est à nos #frais http://t.co/QaJ1WGzf @stoplagreve
Fonction publique, la #grève est à nos #frais http://t.co/7qN9tbNe @stoplagreve
Fonction publique, la #grève est à nos #frais http://t.co/bJtINSvy @stoplagreve
Fonction publique, la #grève est à nos #frais http://t.co/mkjijLD3 @stoplagreve
RT @_h16: “Fonction publique, la grève est à nos frais” http://t.co/DZRfnYSX via @Contrepoints
Fonction publique, la #grève est à nos #frais http://t.co/hhpZX52i @stoplagreve
Fonction publique, la #grève est à nos #frais http://t.co/6fPpjV18 @stoplagreve
Fonction publique, la #grève est à nos #frais http://t.co/bZkh3dbS
Fonction publique, la #grève est à nos #frais http://t.co/DW4IkHXV @stoplagreve
RT @Mentalseb: Fonction publique, la #grève est à nos #frais http://t.co/DW4IkHXV @stoplagreve
Fonction publique, la #grève est à nos #frais http://t.co/0QLTJX9V @stoplagreve
“Fonction publique, la grève est à nos frais” http://t.co/DvooRezs via @Contrepoints
“Fonction publique, la grève est à nos frais” http://t.co/Lt2W6epW via @Contrepoints
Fonction publique : la #grève est à nos frais http://t.co/lx5Uyl9d @stoplagreve
RT @Samuel_Lafont: Fonction publique : la #grève est à nos frais http://t.co/lx5Uyl9d @stoplagreve
Il faut interdire la grève. De nombreux dict… Pays le font déjà. http://t.co/lqRyizo6
Fonction publique, la #grève est à nos #frais http://t.co/JUWuu2nD @stoplagreve
Fonction publique, la #grève est à nos #frais http://t.co/08aX1dow @stoplagreve
Fonction publique, la #grève est à nos #frais http://t.co/ruyWQh15 @stoplagreve
RT @JCV_94: Fonction publique, la #grève est à nos #frais http://t.co/ruyWQh15 @stoplagreve
“Fonction publique, la grève est à nos frais” http://t.co/6gAACMfh via @Contrepoints
“Fonction publique, la grève est à nos frais” http://t.co/yfpsAChg via @Contrepoints
Au lieu de vous insurger pour le payement (supposé) de jours de grève, allez un peu chercher du côté des délégués syndicaux (du public ou du privé) qui incitent tout le monde à faire grève (donc à perdre une journée de salaire) et qui eux, se mette en “délégation syndicale” le jour en question… juste pour ne pas perdre de salaire. La, il y a une véritable injustice.
Sinon, pour les jours de grève payés, étayez un peu votre sujet en publiant une liste des fonctionnaires bénéficiant de ce passe-droit.
Mais la encore, on risque de se retrouver avec 10 personnes qu’on va faire passer pour l’ensemble du système.
Pour un site sérieux, contrepoint tombe bas, on se croirait au journal télévisé.
Article globalement insuffisant. Aucun exemple précis ni référence et lien vérifiable. Il s’expose donc a toute les contestations possibles.
Fonction publique, la #grève est à nos #frais http://t.co/X58aCeBA (via @Contrepoints) (cc @lecrinfo et @stoplagreve)
Fonction publique, la #grève est à nos #frais http://t.co/khzEWCtc @stoplagreve
lu recemment sur” contribuables” une interview de jean françois mancel!oui le repris de justesse qui se servait de sa caisse du conseil général mieux qu’un misérable balkany a levallois!precisons qu’il n’y a pas que les syndicalistes qui nous coutent cher,”contribuables” est bien sélectif dans ses indignations
Quelles sont les sources de ces affirmations ?
A la SNCF , les journées de grèves ne sont pas payées , pire , les salariés remboursent aussi leurs parts de cotisations sociales !
Seuls les délégués syndicaux sont payés car cela fait partie de leurs fonctions , comme pour le privé!
Autre point , les salaires dans le secteur public comprend souvent des primes liées au travail effectué , elles représentent alors un manque à gagner en plus de la perte du trentième !
J’invite ContrePoints à vérifier et corriger ses informations ou à rembourser tous les grèvistes de 2010 qui auraient dû toucher leurs salaires en faisant grève , et ce publics et privés!