L’étude des choix individuels et de leurs conséquences est l’objet de l’économie, une discipline dont les concepts de base peuvent être appliqués aussi bien aux choix de placement qu’aux dilemmes amoureux.
Par Michel Kelly-Gagnon, Montréal, Québec.
Et si, en ce jour de Saint Valentin, ce coquin de Cupidon décoche deux flèches sur vous par erreur de sorte que vous ayez le coup de foudre pour deux jumelles (ou jumeaux), en tout point identiques ? Quelle sera votre réaction ?
Et que faire si ces deux personnes sont jalouses ? Et si la seule différence entre ces deux jolies femmes (ou ces deux hommes élégants) est que l’une est riche comme Crésus tandis que l’autre est pauvre comme Job. Question : laquelle de ces deux personnes voudriez-vous épouser ?
Ou bien, si vous trouvez l’idée de tomber amoureux avec plus d’une personne en même temps saugrenue, imaginez plutôt que chacune de ces deux personnes vous invite à un dîner romantique la même nuit. Imaginez aussi que vous pensez que vous pourriez tomber amoureux aussi bien de l’une que de l’autre. Quelle invitation accepteriez-vous ?
Bien sûr, comme nous le savons tous, l’argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue un peu. L’étude des choix individuels et de leurs conséquences est l’objet de l’économie, une discipline dont les concepts de base peuvent être appliqués aussi bien aux dilemmes amoureux qu’aux choix de placement.
Dans les deux cas, nos décisions sont fondées sur des préférences individuelles subjectives. Il est donc tout à fait plausible qu’une personne choisisse un partenaire amoureux plus pauvre, s’il se distingue par ailleurs par d’autres caractéristiques souhaitables, au regard de ses préférences.
En effet, l’économie ne s’intéresse à l’argent que comme moyen — parmi d’autres – pour parvenir à nos fins. Dans son ouvrage Hidden Order: The Economics of Everyday Life, David Friedman, qui s’est spécialisé dans l’analyse économique du droit, montre qu’au fond, l’économie n’est pas qu’une question d’argent.
L’analyse économique de l’amour a des choses intéressantes à dire sur le monde réel. Une économiste américaine, Margaret Brinig, s’est demandée pourquoi la coutume des bagues de fiançailles, quasiment inconnue aux États-Unis jusque dans les années 1940, a fini par se répandre comme une traînée de poudre – avant de redevenir moins importante deux décennies plus tard.
Son explication est que dans les années 1940, il devenait de plus en plus fréquent pour les fiancés d’avoir des relations sexuelles, même si toute jeune femme était au courant que la perte de sa virginité pouvait contrarier ses chances de se marier avec un autre homme. La bague de fiançailles était donc une forme de compensation si le prétendant finissait par refuser de l’épouser. À mesure que l’importance sociale de la virginité s’est flétrie, la coutume de donner des bagues de fiançailles est devenue relativement moins importante.
Un autre spécialiste de l’analyse économique du droit est Richard Posner, un juge fédéral aux États-Unis, auteur de Sex and Reason. Posner soutient que la théorie économique du sexe explique pourquoi les formes et la fréquence des rapports sexuels, à distinguer du désir et des préférences sexuelles, peuvent être interprétées comme des réponses rationnelles face aux opportunités et aux contraintes.
Par exemple, si le coût du sexe (en termes de risque) tombe grâce à une meilleure contraception, on pourrait s’attendre, toutes choses égales par ailleurs, à ce que la quantité de consommation de sexe augmente. De fait, c’est exactement ce qui s’est passé au cours de la révolution sexuelle.
Tout ceci montre que, même dans les aspects les plus spontanés ou passionnels de nos vies, nous demeurons “rationnels” dans le sens où, étant données nos émotions et nos passions, nous agissons en réponse aux contraintes et aux opportunités.
—-
Sur le web
Traduction : Raphaël Marfaux pour Contrepoints.

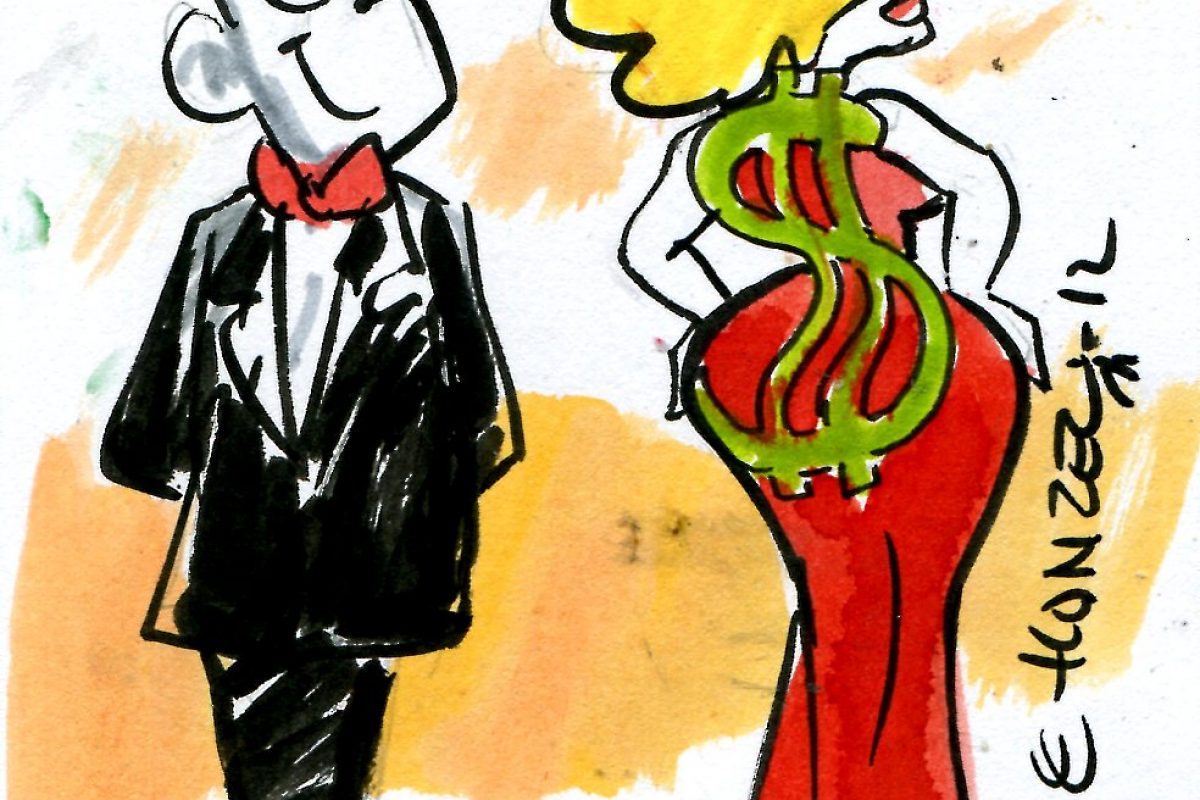

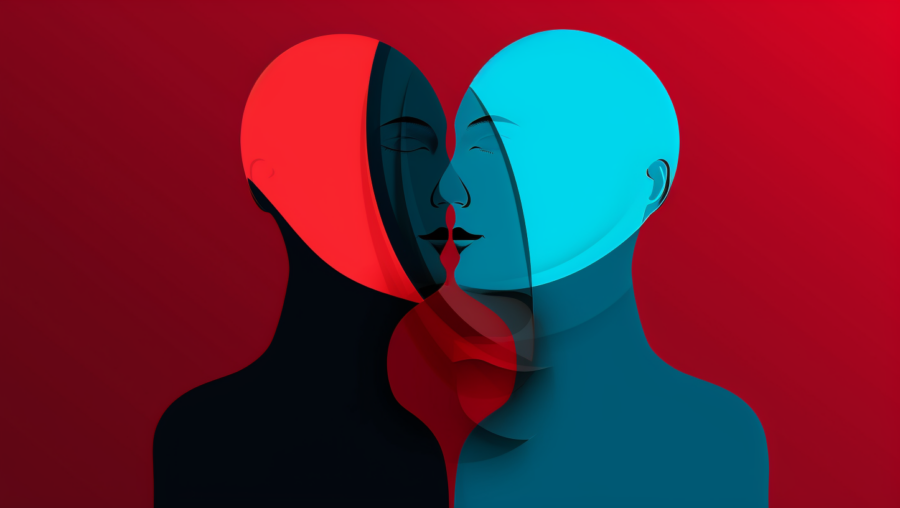

RT @Contrepoints: Économie de l’amour: http://t.co/iITf1BQL
Mouais… Sachant d’autre part que la nouvelle micro-economie est en train de reveler justement a quel point “l’homo economicus” rationnel parfait est une legende, et qu’il tombe inevitablement dans des patterns de comportement irrationnel, equivalents cognitifs des illusions d’optiques (sur/sous-evaluation, mauvaise estimation des risques, de la rarete, attachement aux proportions vs. valeurs absolues, etc.) dans tous les domaines de decision qui incluent beaucoup moins d’emotions que l’amour, on reste un peu sceptique sur le tableau renverse que vous depeignez (c.a.d. la reapparition soudaine d’une rationalite)… Par ex. il est connu que beaucoup de personnes ont le biais d’etre (inconsciemment) attirees par des partenaires qui leur conviendront le plus mal au long terme (“le point commun entre toutes mes relations ratees, c’est moi”)