La liberté économique favorise le développement du business, créant ainsi de la valeur pour tous ses participants.
Par John MacKey (*), depuis les États-Unis
Article publié en collaboration avec l’Institut Coppet

Les États-Unis sont-ils exceptionnels ? Bien sûr ! Il y a deux cents ans nous étions un des pays les plus pauvres du monde. Nous comptions pour moins de 1% du PIB mondial. Aujourd’hui notre PIB représente 23% du total mondial, soit plus du double du second pays, la Chine.
L’Amérique est devenue le pays le plus riche du monde parce que nous avons pratiquement toujours suivi les principes fondamentaux de la liberté économique : droit à la propriété, droit à commercer librement et internationalement, régulations gouvernementales minimales, politique monétaire saine, impôts relativement bas, État de droit, libre Entreprise, droit à l’échec et liberté des échanges.
La liberté économique a eu pour effet de développer la prospérité des individus, d’étendre nos possibilités et d’améliorer notre qualité de vie sous d’innombrables formes. Elle a bâti l’histoire la plus extraordinaire dans ce monde durant les deux cents dernières années. Le PIB par habitant a augmenté de 1000% à travers le monde et près de 2000% aux USA sur les deux derniers siècles. En 1800, 85% de la population vivait avec moins d’un dollar par jour (sur la valeur du dollar à ce jour). Aujourd’hui, il n’en reste plus que 17%. Pour peu que la tendance de croissance économique sur le long terme se vérifie, nous pourrons assister à une presque totale éradication de l’abjecte pauvreté au XXIème siècle. Le business n’est pas un jeu à somme nulle combattant pour une part d’un gâteau figé. Au contraire, plus le business se développe, plus le gâteau devient grand, créant ainsi de la valeur pour tous ses participants – clients, salariés, fournisseurs, investisseurs & collectivités.
Alors, comment se fait-il que notre économie stagne et notre taux de chômage grimpe à plus de 9% ? Je crois que la raison en est simple : la liberté économique décline aux USA. En 2000, les USA étaient classés troisième dans le monde seulement précédés par Hong Kong et Singapour sur l’Index de liberté économique des marchés, Index publié annuellement par la Fondation Heritage. En 2011, nous sommes descendus à la neuvième place derrière des pays tels que l’Australie, La Nouvelle-Zélande, le Canada et l’Irlande.
Les réformes que nous devons réaliser sont considérables. Je souhaite faire ici quelques suggestions, qui, j’espère en tant que simple individu, stimuleront la réflexion et le débat constructif entre les américains concernés, quelle que soit leur opinion politique.
Primordialement, nous devons réduire drastiquement la taille et le coût du gouvernement. Il y a cent ans, le coût total du gouvernement tous prélèvements confondus – local, d’État et fédéral – ne représentait que 8% de notre PIB. En 2010, il était de 40%. Le gouvernement engloutit des trillions de dollars puisés dans notre économie pour sa propre subsistance par des impôts très élevés et un déficit budgétaire sans précédent – au lieu de cela, cet argent pourrait être utilisé par des individus pour améliorer leur condition de vie et par des entrepreneurs pour créer des emplois. La dette de l’État enfle à une telle vitesse que la Commission Budgétaire du Congrès a calculé que dans les prochaines soixante-dix années l’argent public consacré au remboursement de la dette atteindra 41,4% du PIB (soit 27,2 trillions de dollars) alors qu’il est en 2010 de 1,4% (204 milliards de dollars). Aujourd’hui, l’intérêt de la dette représente près d’un tiers du coût de la Sécurité Sociale ; en à peine 20 ans, il dépassera le coût total de ce programme.
Ce n’est qu’en nous focalisant sur la réduction des quatre plus gros budgets de l’État – Défense, Sécurité Sociale, Medicare et Medicaid (tout notre système de santé) qui ensemble avec les intérêts comptent pour environ les 2/3 du budget total – que nous pourrons créer un impact significatif.
Notre budget de la Défense représente à ce jour 43% de la dépense militaire mondiale – soit davantage que les 14 autres plus grandes dépenses militaires réunies. Il est grand temps que nous révisions à la baisse nos ambitions militaires au moins jusqu’à les aligner sur un montant plus conforme à notre pourcentage de PIB mondial, soit 23%. En faisant ainsi, nous épargnerions plus de 300 milliards de dollars chaque année.
La Sécurité Sociale et Medicare nécessitent de sérieuses réformes pour pouvoir assurer leur survie sur le long terme. La crise démographique qui frappe ce système est arrivée au point où 10 000 baby-boomers vont prendre leur retraite chaque jour sur les 19 prochaines années. L’âge de la retraite doit être nettement relevé, mis en adéquation avec celui de notre espérance de vie. Ces programmes devraient également donner lieu à des projections en termes de coût. Des pays tels que le Chili ou Singapour ont pu résoudre ce problème de manière efficace en privatisant leurs programmes de retraite. Nous devrions envisager de suivre la même voie en offrant à chacun la possibilité de sortir du système gouvernemental pour s’orienter vers des alternatives privées et en l’étalant sur le temps pour maintenir la viabilité du présent système.
—-
Sur le web
Article originellement publié dans le Wall Street Journal, le 16 novembre 2011.
Traduction Chris Drapier, Institut Coppet
(*) John McKey, co-fondateur & co-dirigeant de Whole Foods Market, est membre de Job Creators Alliance, un organisme à but non lucratif se consacrant à la protection de la Libre Entreprise.


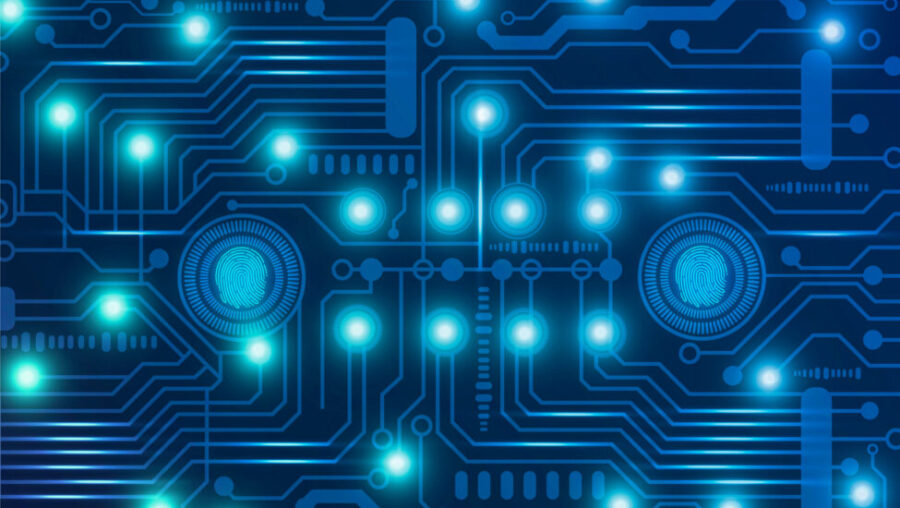

Le “manque d’emploi”, actuellement considéré comme un défaut, devrait être reformulé en “grande efficacité de production”, nécessitant moins de travail pour produire la même chose voire plus. En effet, le travail humain permet de surmonter les obstacles à la satisfaction des besoins. Regretter la trop grande facilité avec laquelle les obstacles sont franchis (car alors il y a moins de travail pour y parvenir), c’est combattre le but pour préserver le moyen.
Comme l’explique Frédéric Bastiat, il y a une confusion entre l’obstacle et la cause des richesses : http://bastiat.org/fr/obstacle_cause.html
Louis Even dénonçait cette même confusion entre le but et le moyen, un siècle plus tard : http://www.michaeljournal.org/lecon1.htm
L’efficacité de la production ne conduit pas au manque d’emplois mais à des emplois différents. Le travail n’est pas un stock, un gâteau à partager.
Si les besoins de la population sont satisfaits avec une certaine quantité de travail Q, l’augmentation de l’efficacité de production permettra à ces mêmes besoins d’être satisfaits avec une quantité de travail Q’ < Q.
Beaucoup luttent contre le remplacement des humains par les robots pour faire des tâches répétitives, au seul prétexte que "cela va faire perdre des emplois". Pour moi, l'objectif ne devrait pas être le plein-emploi, mais au contraire, le moins d'emplois possible : produire le plus efficacement possible.
Tu vas me dire, bien sûr, "mais on va créer de nouveaux besoins, qu'il faudra satisfaire". Et là on tombe en plein dans la schizophrénie du système actuel :
– il faut du travail pour satisfaire les besoins ;
– il faut créer des nouveaux besoins pour avoir du travail.
Supposons que l'on parvienne à une efficacité de production telle que l'emploi de 5% de la population active suffise à satisfaire les besoins de tous : nous serions dans une société qui n'a jamais été aussi productive et riche. Pourtant, nous aurions un taux de chômage de 95%. Si les revenus étaient exclusivement issus du travail rémunéré, une écrasante majorité de la population n'aurait aucun revenu. Restaurer une situation de plein emploi, impossible en pratique, serait très critiquable en théorie : il s'agirait d'imposer à de nombreuses personnes l'occupation d'un emploi utile ni pour elles, ni pour la société.
Et donc, "comment gagner de l'argent si les gens n'ont plus d'emploi" ?
L'emploi tendant à se raréfier avec l'augmentation de l'efficacité et de la productivité, le paradoxe mis en évidence est à mon sens fondamental : si le revenu provient de l'emploi, cela signifie que l'amélioration de la société tend à augmenter la pauvreté. La solution n'est pas d'arrêter l'amélioration et d'empêcher l'utilisation de technologies plus efficaces. Mais elle n'est pas non plus d'accepter la pauvreté, et surtout le lien de causalité entre amélioration de la société et pauvreté.
Et pour résoudre ce paradoxe, il est inévitable de dissocier le revenu et l'emploi : la monnaie correspondant aux richesses créées par les machines doit être, d'une manière ou d'une autre, distribuée à la population. Sans cela, nous nous trouvons dans une situation aberrante où il y a abondance de richesses réelles et pénurie de monnaie pour y accéder, et nous ne pouvons faire autrement que d'accepter avec fatalité les conséquences négatives de l'amélioration de la société (sic).
Et pour cela, il faut corriger l'inique mécanisme de création monétaire (l'argent dette).
« Supposons que l’on parvienne à une efficacité de production telle que l’emploi de 5% de la population active suffise à satisfaire les besoins de tous : nous serions dans une société qui n’a jamais été aussi productive et riche. »
Cela, tu ne le sais pas. Tu pars d’un postulat faux, qui es de penser que nous sommes dans un optimum de production et des besoins/désirs, qu’on est à un point d’équilibre, qu’on n’aura pas de nouveaux besoins dans l’avenir.
Il y a 100 ans, on pensait que tout ce qui pouvait être inventer l’était. Or, le XXème siècle a été un siècle très fructueux en inventions.
Qui sait quels genres de nouveaux besoins on aura dans 100 ans ?
C’est l’erreur typique malthusienne, qui finit toujours par revenir, et qu’on entendait déjà du temps de l’antiquité.
On a 7 milliards de cerveaux sur Terre, c’est un fameux atout concernant l’évolution future de l’humanité, bien plus puissant intellectuellement pour s’organiser eux-mêmes qu’un petit groupe de planificateurs soi disant éclairés.
« si le revenu provient de l’emploi, cela signifie que l’amélioration de la société tend à augmenter la pauvreté. »
Il provient de la rétribution d’un service, que ce soit par l’emploi ou autre.
Le jour où il n’y aura plus de création d’emplois sera le jour où on n’aura plus besoin des services d’autrui, où chaque personne sera entièrement autonome.
Et le principe de réalité démontre que c’est l’inverse qui arrive : l’amélioration de productivité provoque l’enrichissement de la société.
« Et pour résoudre ce paradoxe, il est inévitable de dissocier le revenu et l’emploi »
Ce qui nécessite un état bienveillant, infaillible et surtout absolu… Et qui n’a aucune base objective pour savoir comment le faire.
« nous nous trouvons dans une situation aberrante où il y a abondance de richesses réelles et pénurie de monnaie pour y accéder »
Et c’est là l’utilité d’avoir un système de prix non-fixés.
Si les richesses réelles augmentent, la valeur de la monnaie augmentera et elle aura plus de pouvoir d’achat. Les prix baisseront.
Votre paradoxe n’est qu’apparent, du fait d’hypothèses initiales fausses.
Le travail des employés, des investisseurs, des financiers et des entrepreneurs est un flux qui s’auto-alimente dans le cercle vertueux des échanges volontaires et son potentiel est proprement infini, la production créant toujours une demande équivalente. En luttant contre le travail, en le dévalorisant, en le punissant même, le collectivisme tarit la production et empêche le travail de produire tous ses effets positifs. Ce n’est pas la productivité mais le collectivisme qui place la société dans le cercle vicieux de la pénurie d’emplois (et de toutes les autres pénuries subséquentes).
La monnaie est un bien comme un autre. Comme pour tous les biens, il convient d’isoler sa production du pouvoir de nuisance des hommes politiques et de l’Etat et de confier au marché le soin de déterminer les prix et de quantités nécessaires pour tendre vers l’optimum.
Il est plus que jamais indispensable de lier strictement le revenu au travail et de libérer la production de la monnaie.
C’est donc l’offre qui pousse la demande, et non la demande qui attire l’offre. On ne peut donc pas dire qu’il y a pénurie : si tel était le cas, ce serait la demande qui attirerait l’offre. Il y a seulement pénurie d’argent, pas pénurie de richesses réelles.
Avant de répondre à cette remarque, où tu te dis en faveur de la création monétaire par le privé (comme actuellement) plutôt que par le public, je voudrais citer (désolé, citations longues) la description qu’en fait Louis Even, qui montre l’injustice du système actuel :
Et J.C. Larkin :
La création monétaire par le privé est juste inacceptable, c’est la pire des solutions.
Ensuite, doit-elle être créé par l’État, et distribuée selon le bon vouloir du gouvernement ?
Le débat entre public est privé se pose dans plein de domaines. Et la meilleure solution, c’est “ni l’un ni l’autre”.
Dans le domaine de l’information par exemple, si la TV est entièrement contrôlée par l’État, ça donne une télévision d’État. À éviter. Mais si la TV est privatisée, ça donne d’autres dérives (voir l’excellent documentaire “le temps de cerveau disponible” de France 2). La troisième solution, c’est “tout le monde a le même droit de s’exprimer que les autres, et a accès au contenu de tous les autres”. Internet.
Pour la monnaie, c’est pareil. Il est inconcevable que ce soient des entreprises privées qui créent l’argent, comme c’est le cas actuellement. Mais simplement le nationaliser ne suffit pas, car alors le gouvernement aurait la main sur la création monétaire et pourrait en abuser. La troisième solution, à privilégier, c’est “toute augmentation de la masse monétaire doit être distribuée équitablement entre chaque individu”. C’est le dividende universel.
Trop touffu, faire plus simple. Du peu que j’en comprends, vous répétez les mêmes hypothèses fausses.
Ton post est trop long, cependant, j’ai envie de répondre à ceci:
« Dans le domaine de l’information par exemple, si la TV est entièrement contrôlée par l’État, ça donne une télévision d’État. À éviter. Mais si la TV est privatisée, ça donne d’autres dérives (voir l’excellent documentaire « le temps de cerveau disponible » de France 2). »
K. Popper parle justement de cela dans un de ses bouquins : “La télévision : un danger pour la démocratie”.
En gros, la TV peut être néfaste, qu’elle soit privée ou publique, elle tend au nivellement par le bas intellectuel, soit par la propagande d’état, soit par la course à la médiocrité.
Mais une TV dans un contexte libéralisé permet au moins d’avoir une multitude de chaînes, qui ont leurs propres raisons de diffuser, d’avoir des points de vues différents, etc.
Ce qu’il faut, c’est au moins garder en tête que la télévision peut être néfaste.
« La troisième solution, c’est « tout le monde a le même droit de s’exprimer que les autres, et a accès au contenu de tous les autres ». Internet. »
Ce qui ne signifie pas non-plus que l’information est fiable. Beaucoup de gens tiennent pour argent comptant ce qu’on leur dit, mêmes farfelues. Il suffit de voir toutes les désinformations, les hoaxs, le conspirationnisme sur le net…
Comment peut-on savoir si l’information de ce qui se passe à 1000km d’ici est fiable puisqu’on n’y est pas pour le constater ?
Goebbels avait très bien compris cela.