Tyler Cowen, In Praise of Commercial Culture, Harvard University Press.
Par Geoffroy L.
 C’est un fait depuis longtemps établi : l’économie de marché est le meilleur système pour conduire à la prospérité matérielle. Lorsqu’il est question de culture, à l’inverse, beaucoup d’intellectuels affirment qu’une exception aux principes du marché doit être faite. Le commerce et l’argent corrompraient l’art en sacrifiant la créativité aux exigences de la rentabilité économique ; l’esprit mercantile de la recherche du profit étoufferait l’inventivité et nivellerait la culture par le bas.
C’est un fait depuis longtemps établi : l’économie de marché est le meilleur système pour conduire à la prospérité matérielle. Lorsqu’il est question de culture, à l’inverse, beaucoup d’intellectuels affirment qu’une exception aux principes du marché doit être faite. Le commerce et l’argent corrompraient l’art en sacrifiant la créativité aux exigences de la rentabilité économique ; l’esprit mercantile de la recherche du profit étoufferait l’inventivité et nivellerait la culture par le bas.
Dans In Praise of Commercial Culture, Tyler Cowen, professeur à l’Université George Mason, rejette cette opinion. Sa thèse : l’économie de marché capitaliste et la richesse productive sont les alliées de la production culturelle. La croissance économique et les valeurs qui la sous-tendent sont des institutions vitales pour « supporter une pluralité de visions artistiques coexistantes, fournir un flux constant de créations nouvelles et satisfaisantes, aider les consommateurs et les artistes à raffiner leur goût et rendre hommage au passé éclipsé en le capturant, le reproduisant et le disseminant. » (p. 1). Pour iconoclaste que cette idée puisse être, Cowen la défend de façon convaincante.
Tout d’abord, il est factuellement faux, nous dit Cowen, d’affirmer que la recherche de l’argent doit conduire au conformisme artistique. Selon lui, « Bach, Mozart, Haydn et Beethoven étaient obsédés par le gain à travers leur art » ; puis, citant Mozart : « Croyez-moi, mon seul but est de gagner autant d’argent que possible, car après une bonne santé, l’argent est le meilleur des biens à posséder. » (p. 18). Charlie Chaplin était lui aussi attiré par le profit : « Je suis rentré dans les affaires pour l’argent, et c’est de là que l’art s’est développé. Si les gens sont désabusés par cette remarque, je ne peux rien y faire, c’est la vérité. » (p. 18). Ces artistes ne sont pourtant guère des exemples de conformisme.
Mais ici l’intellectuel ne sera pas convaincu : qu’en est-il de l’amour du beau et du besoin de création désintéressé que ressent l’artiste ? Ne seraient-ils pas bridés par la nécessité de satisfaire le goût des masses dans une économie de marché ? Faux, répond Cowen. Par la multiplication des sources de financements potentielles, l’économie de marché permet à l’artiste de négliger les consommateurs et de poursuivre entièrement ses besoins de création. T.S Eliot, par exemple, travaillait dans une banque. Paul Gaugin était courtier financier et Philipp Glass chauffeur de taxi. Si Marcel Proust a pu vivre reclus dans sa chambre pour écrire À la recherche du temps perdu, c’est grâce au soutien financier de membres de sa famille ayant fait fortune à la bourse. « Le bohémien, l’avant-gardiste, et le nihiliste, affirme Cowen, sont les produits du capitalisme ». (p. 18)
Si la prospérité capitaliste fournit l’indépendance aux artistes, elle possède en vérité d’autres charmes. D’abord, le progrès technique, résultat de l’accumulation du capital, permet de diffuser et de sauvegarder les œuvres. L’imprimerie, par exemple, a été l’innovation la plus importante pour diffuser l’alphabétisation en général et la littérature en particulier. Or, « Gutenberg et la plupart des premiers imprimeurs étaient des commerçants dont le but était le profit, et qui voyaient les livres comme une forme lucrative de marchandise commerciale. » (p. 58). Avec la croissance de la productivité et la baisse du prix du papier, il est désormais possible de se procurer les plus grandes œuvres de la littérature en livre de poche pour quelques euros.
D’autre part, le progrès matériel, rend possible l’existence d’un flux continu d’innovations artistiques. Les changements techniques ouvrent de nouvelles voies exploitables par les artistes. Les nouveaux pigments qu’utilisaient les impressionnistes étaient basés sur des matières synthétiques (cadmium, chrome, cobalt…) provenant de l’industrie chimique naissance (p. 118). La photographie et le cinéma sont d’autres exemples de l’influence positive sur la culture du progrès matériel rendu possible par le capitalisme. Le paysage artistique du 20e siècle eut été bien plus pauvre sans ces créations de la civilisation matérielle.
Une autre preuve de l’influence positive de l’esprit commerçant sur la culture se trouve dans le fait que les grandes révolutions de l’art pictural occidental ont souvent eu lieu dans les centres économiquement dynamiques. L’auteur consacre le chapitre 3 à l’étude détaillée de quatre cas : Florence durant la Renaissance, la Hollande de l’Âge d’or, le Paris de la seconde moitié du 19e siècle, et New York après 1945. Ces quatre lieux ont en commun de reposer sur l’existence d’une classe de riches bourgeois créant les conditions de l’existence d’un pluralisme artistique.
Le livre de Cowen, en somme, est érudit et dense (pour preuve les cinquante pages de notes) ; il n’est pas possible d’en épuiser tous les arguments en une recension. Il permet de remettre en question les préjugés accumulés sur le pseudo danger de la « marchandisation de la culture ». Malheureusement, l’anticapitalisme des intellectuels français risque d’en limiter la diffusion.


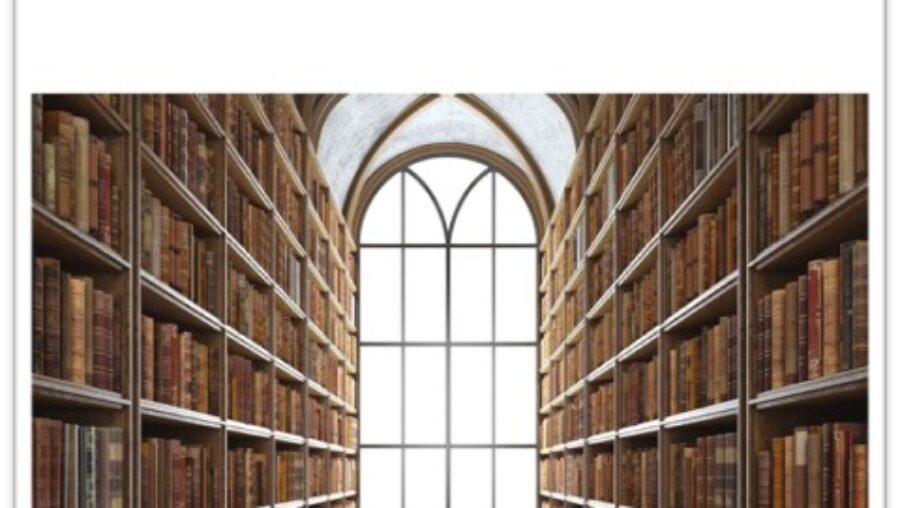

C’est surtout que les “intellectuels français” sont bien trop occupés à lire la production estampillée nationale pour s’occuper de lire des livres en anglais, américains de surcroît…
Le livre “Mozart: sociologie d’un génie” du sociologue Allemand Norbert Elias (1993) retrace la naissance socio-économique du « génie musical ». Un des problèmes que Mozart a eu à affronter tout au long de sa vie est les contraintes réelles, économiques, sociales qui pesaient sur la production musicale á l’époque. Car bien sûr, pour pouvoir passer sa vie á créé des symphonies, des opéras et des marches funèbres, il faut de l’argent. Au temps de Mozart, les musiciens étaient sujets du roi. Il était leur employeur qui demandait des productions á la commande. Ainsi le musicien avait un statut de travailleur manuels tel que les cuisiniers et les jardiniers de la cour (et non de créateur). Le concept de « travailleur du savoir » de Peter Drucker n’existait pas encore. C’est là où réside le secret de la tension inhérente á la vie de Mozart : il vivait la vie d’un artiste indépendant due au nécessité (en temps de travail) de la création de telle œuvre et les contraintes socio-économiques de la culture bourgeoise Viennoise de l’époque qui considérait la production de musique dans le cadre stricte du divertissement alloué par l’aristocratie. Norbert Elias suggère que la naissance de « l’artiste musical indépendant » commença après Mozart avec Ludwig Von Beethoven (« indépendant » étant entendu artistiquement et économiquement). Mozart ne vivait pas á l’époque dans une métropole ou une très large classe de bourgeois aurait consommé son art. Ces conditions économiques lui aurait permis de créer librement comme il le faisait. En résumé, la culture, ce n’est pas l’idéalisation de l’art pour l’art mais aussi la compréhension des possibilités et des conditions économiques réelles avec lesquelles les artistes génèrent leur production. C’est valable hier comme aujourd’hui.