Le problème de la dette n’est que le symptôme d’une mentalité anti-capitaliste qui sape la philosophie politique originelle des droits individuels et de la liberté économique et instaure à sa place une idéologie du paternalisme et de la dépendance.
Par Richard Ebeling
Un article publié par l’Institut Turgot
 Lorsque les Démocrates et les Républicains américains s’affrontent pour proposer des plans différents et concurrents de réduction des dépenses publiques, ils ne précisent jamais à partir de quel « niveau de référence » ils font leurs calculs.
Lorsque les Démocrates et les Républicains américains s’affrontent pour proposer des plans différents et concurrents de réduction des dépenses publiques, ils ne précisent jamais à partir de quel « niveau de référence » ils font leurs calculs.
Ce qu’ils proposent en pratique n’est jamais qu’une diminution projetée dans le taux d’augmentation des dépenses étatiques totales. Presque personne n’imagine que la « part » du gâteau national que les hommes de l’État consomment par l’impôt puisse effectivement être réduite.
Aussi bien les Démocrates que les Républicains tiennent comme allant de soi que le « tout-État » va persister. Même ces Républicains qui soulignent la nécessité de « réformer » les programmes de « droits sociaux » tels que la retraite par répartition, ou les soins subventionnés, ne mettent pas en cause l’idée que ceux-ci constituent un facteur permanent du paysage politique américain. Ils souhaitent seulement les rendre financièrement « plus solides », ou « plus efficaces », voire gérés d’une manière qui donnerait à ceux qui y ont accès un certain « choix » dans la gestion de leur dossier de retraite, ou dans le choix des médecins ou des traitements médicaux.
Qui dit « droits sociaux » veut dire pillage
Ce qui permet peut-être le mieux d’en prendre la mesure est le fait qu’il n’y a pratiquement personne dans l’arène politique de Washington qui récuse l’idée ou l’emploi de l’expression « droits sociaux ».
Le dictionnaire Merriam-Webster définit un « droit social » comme « l’état ou la condition d’avoir un droit à ». Un « droit aux prestations définies par la loi ou par le contrat », comme dans « une politique étatique qui distribue des avantages aux membres d’un groupe particulier. » Il se fonde, nous dit le dictionnaire, sur l’idée « d’une conviction comme quoi on aurait acquis un droit à certains privilèges ».
D’après cette définition, par conséquent, un « droit social » dans l’arène politique est un programme d’avantages que les hommes de l’État fournissent à un groupe privilégié, groupe qui en vient à croire qu’il aurait mérité de tels avantages, voire à considérer ces avantages comme un « droit ».
Les hommes de l’État, cependant, ne peuvent fournir d’avantages à aucun groupe privilégié dans la société s’ils ne forcent pas les autres, en contrepartie, à fournir les ressources, les biens, ou les moyens financiers nécessaires pour payer ce qui aura été promis. Étant donné que l’État n’a aucune disponibilité en ressources, en biens ou en sommes d’argent qu’il n’ait commencé par taxer ou emprunter à d’autres, tout « droit social » de cette espèce oblige d’autres personnes dans la société à fournir les moyens nécessaires pour que les hommes de l’État tiennent leurs promesses envers les groupes privilégiés.
Ce qui veut dire que le privilège d’un groupe entraîne pour les autres une contrainte forcée, que les hommes de l’État imposent par leur pouvoir de police en taxant et en saisissant le revenu et le capital de tous les membres de la société.
C’est ainsi que la société se trouve divisée en deux catégories : 1) les payeurs d’impôt et les receleurs d’impôt ; 2) les discriminés et les privilégiés.
C’est-à-dire :
– ceux que l’on force à renoncer à une partie de la production, des revenus et de la richesse qu’ils ont honnêtement gagnés dans les échanges paisibles du marché,
– et ceux qui reçoivent cette production, ces revenus et ces richesses du pouvoir des hommes de l’État.
C’est, ce que Frédéric Bastiat, le fameux économiste libéral français du XIXème siècle, dénommait la spoliation légale. L’État, au lieu d’agir comme protecteur et gardien du droit de chaque individu à la vie, à la liberté et à la propriété honnêtement acquise, y devient le plus puissant violateur de la liberté des gens, et le plus envahissant.
Le pouvoir monopolistique centralisé des hommes de l’État sur l’emploi de la violence, est bien plus puissant et plus dangereux que celui du pire individu ou groupe privé qui, dans la société, entreprendrait de piller des innocents ou de les maltraiter. Cependant, et c’est tout aussi important, dans la société, les hommes de l’État sont les seuls à employer la force qui soient en même temps largement parvenus à endoctriner la grande majorité de ceux qui se trouvent sous leur coupe pour les persuader qu’il serait « juste » et « bon » qu’ils dépouillent une partie de la population au bénéfice d’une autre, celle qu’ils auront choisi de privilégier.
Domination politique contre maîtrise de l’individu par lui-même
Dans des temps plus anciens, c’est en présentant la royauté comme de Droit divin que les hommes de l’État avaient acquis leur légitimité et l’acquiescement de leurs sujets. Il a fallu plusieurs siècles pour mettre à bas la croyance comme quoi ce serait au nom d’un ordre divin que les monarques régnaient, réglementaient et levaient des impôts.
Avec la fin, ou l’affaiblissement, de la monarchie aux XVIIIème et XIXème siècles, c’est un nouveau maître qu’on a intronisé, avec une prétention presque aussi religieuse à exiger l’obéissance politique des citoyens : la « démocratie » de droit divin. C’est « le peuple » qui y a remplacé le monarque en tant qu’origine légitimée du pouvoir politique. Si c’était « le peuple » qui se gouvernait « lui-même » par « son » vote démocratique, comment pourrait-« il » jamais « se » tyranniser et s’asservir « lui-même » ? Comment, en effet, un homme pourrait-il mal se traiter lui-même, si ses actions ne sont dictées que par sa propre volonté ?
Aux États-Unis, l’idée du « gouvernement du peuple par le peuple » avait à l’origine un sens différent. Ce qu’elle voulait dire ce n’est pas d’abord, ni principalement, un gouvernement issu d’une procédure électorale. Ce qu’elle affirmait, c’est le Droit de tout citoyen de décider par lui-même pour lui-même. Lorsque la Déclaration d’Indépendance américaine parlait des “droits inaliénables” que l’individu possède à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur, ce que disaient les Pères fondateurs est que tout homme est son propre propriétaire, et qu’il a le Droit de vivre sa vie comme il l’entend, aussi longtemps qu’il mène tranquillement les affaires qu’il a choisies, et respecte le Droit égal des autres à en faire de même.
Dans cette conception typiquement américaine des droits individuels et de la propriété de soi, le rôle des hommes de l’État était celui de protecteur et de garant de la liberté de chaque personne. L’autorité politique y était censée être au service de tout individu souverain, qui choisissait ses propres objectifs et projets dans la vie, et qui entreprenait de les atteindre au moyen de sa propre énergie intellectuelle et matérielle. Quand il avait besoin de l’aide et d’association avec autrui pour atteindre certains de ses buts, la méthode était la liberté du choix et le caractère volontaire de l’échange.
Le socialisme et la mentalité anti-capitaliste
Comment se fait-il, par conséquent, que l’Amérique ait abandonné cette idée des individus souverains qui se gouvernent eux-mêmes, avec un État confiné aux fonctions peu nombreuses mais essentielles de la protection des droits, en faveur de l’idée comme quoi ce serait l’État lui-même qui est le souverain « au nom du peuple », où l’individu est réduit au rôle d’un serf dont on exige et attend qu’il paie n’importe quel impôt et supporte n’importe quelle règlementation au nom d’un « bien commun », de l’« intérêt national » ou de la « solidarité » ?
En un mot, la réponse est : le socialisme.
Cette année-ci marque le 20ème anniversaire de la chute de l’Union soviétique. Après la réalité de presque 75 ans de socialisme réel dans l’Union soviétique et ailleurs dans le monde, il n’y a plus que très peu de gens pour croire et aspirer au régime dictatorial d’un Parti communiste prétendant connaître les « lois inéluctables du développement historique » ; il y en a peu pour vouloir vivre dans un système de complète et globale planification centrale socialiste. L’expérience a convaincu suffisamment de gens autour du monde qu’un tel système ne mène à rien qu’à une brutale tyrannie, en même temps qu’à la stagnation économique et à la pauvreté.
Alors que l’idéal du socialisme soviétique et de la planification centrale a été rejeté et compte de nos jours peu d’adeptes déclarés, ce qui perdure effectivement et influence les attitudes générales vis-à-vis du pouvoir politique, de la politique économique et du rôle de l’État dans la société, tant aux États-Unis que dans le reste du monde, c’est la critique socialiste du capitalisme et de la société libre de marché.
C’est sur l’analyse socialiste de l’économie de marché que se fondent les rationalisations du vaste filet de programmes sociaux étatiques ainsi que de réglementations et d’ingérence dans les entreprises privées. Lorsqu’on laisse libre l’entreprise privée, ont prétendu les socialistes, la recherche égoïste du profit conduit les patrons à porter atteinte à la protection de l’intérêt commun ou général. Les employeurs cupides exploiteront et maltraiteront les travailleurs à la recherche d’emploi si les hommes de l’État ne les protègent pas par une règlementation du travail, y compris par l’imposition d’un salaire « décent ».
L’État doit donc assumer le rôle de fournisseur paternaliste des soins de santé, des pensions de retraite, de l’assurance chômage, des logements publics, de l’enseignement, ainsi qu’une grande variété d’autres services sociaux. Pourquoi?
Premièrement, dans un capitalisme débridé, les travailleurs ne gagneraient pas assez pour s’assurer à eux-mêmes ces biens nécessaires.
Deuxièmement, les entreprises privées mues par leur seul intérêt ne pourraient certainement pas fournir ces biens et ces services en quantité et en qualité suffisantes.
En d’autres termes, on ne saurait faire confiance aux individus pour mener eux-mêmes leur vie, pour faire leurs choix propres, et interagir librement avec leurs semblables dans une société de liberté. C’est un contrôle collectif, sous couvert du processus démocratique, qu’il faudrait pour contraindre et circonscrire la souveraineté de l’individu dans le domaine de ses affaires propres.
Partout les hommes de l’État, y compris aux États-Unis, au nom de la protection des personnes contre le capitalisme sans frein, ont créé des administrations en expansion constante qui règlent quasiment tous les aspects de nos existences. C’est pourquoi notre monde est aujourd’hui le prisonnier permanent d’une idéologie anti-capitaliste.
Les bureaucraties d’État qui règnent grâce aux politiques anti-marché se sont transformées en élites politico-idéologiques qui s’imaginent savoir, et prétendent nous dicter avec arrogance, comment il nous faudrait à tous vivre et travailler. Ceux qui détiennent le pouvoir politique peuvent se comparer à la noblesse d’antan, devant laquelle les roturiers devaient ramper pour qu’ils puissent vivre et prospérer.
Le capitalisme comme libérateur de l’Homme
Ces charges contre le capitalisme et la société libre sont-elle justifiées ? Absolument pas. En fait, il n’existe aucun récit historique qui falsifie et dénature la réalité au point où le fait cette critique socialiste de la société libre de marché.
À partir du XVIIIème siècle et pendant tout le XIXème le capitalisme, et la philosophie politique du libéralisme classique qui l’accompagnait, ont insisté sur la liberté et la dignité de l’individu. Ce sont les libéraux classiques qui ont fait campagne contre l’esclavage et qui y ont mis fin, d’abord en Europe puis dans le reste du monde.
Ces libéraux appelaient à la fin du règne des rois et des princes, ou du moins à restreindre leurs pouvoirs par des constitutions et des élections paisibles. Ils appelaient à un règne impartial du droit, à l’abolition de la torture et autres châtiments cruels.
Le programme libéral classique comprenait l’abolition de tous les privilèges, faveurs et subventions censés bénéficier à l’aristocratie, ainsi que la fin de tous les monopoles créés par la réglementation et le protectionnisme d’État. Il appelait à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie, et à la liberté de déplacement.
En d’autres termes, le libéralisme classique et le capitalisme sont une idéologie de la libération de l’homme vis-à-vis de l’oppression politique et de la pauvreté. Ils sont à l’origine de la liberté humaine et de la prospérité matérielle dans le monde moderne. Ce sont eux qui ont servi de fondement à la République américaine.
Jamais le capitalisme du XIXème siècle n’a condamné aucun travailleur à une vie de perpétuelle pauvreté. Bien au contraire, l’économie marchande en expansion n’a cessé de créer des emplois nouveaux, et mieux rémunérés que les décennies précédentes.
C’est elle qui a produit la richesse et la hausse des revenus qui ont permis l’émergence d’un phénomène complètement nouveau dans l’histoire humaine : une classe moyenne autonome et instruite qui n’a cessé de croître à mesure que les classes inférieures amélioraient leur bien-être économique. C’est grâce à l’investissement privé que le capitalisme n’a cessé de porter la productivité du travail à de nouveaux sommets. Enfin, les parents ont pu gagner suffisamment pour que leur progéniture ne soit pas contrainte d’entrer dans la vie active à un âge prématuré. Et cela a produit quelque chose d’unique dans l’histoire : l’enfance, une période où les jeunes pourraient connaître l’insouciance du jeu, et la possibilité d’apprendre, avant d’entrer dans le monde du travail.
Le libéralisme classique et l’ordre du marché ont favorisé les associations privées et les organismes de bienfaisance qui ont donné aux travailleurs pauvres accès aux soins médicaux, aux retraites et aux places à l’école pour leurs familles. Les famines ont disparu, la pauvreté n’a cessé de se réduire dans d’immenses proportions, et les longs horaires d’un travail difficile ont été lentement mais sûrement facilités et raccourcis à un degré sans précédent.
Le capitalisme a été le libérateur de l’humanité. Il nous faut réapprendre cette grande histoire et ces glorieux résultats de la première ère du capitalisme, dans une société qui ne reconnaît plus guère quel est le système qui a fourni le confort et le niveau de vie que trop de nos concitoyens tiennent pour acquis.
La dangereuse croissance de l’État
Cela fait aujourd’hui plus d’un siècle que la mentalité anti-capitaliste sape la philosophie politique américaine originelle des droits individuels et de la liberté économique. Et c’est la politique du paternalisme et de la dépendance qui se développe à la place.
Cela a fait le jeu de ceux qui, sous le couvert de la démocratie, voulaient toujours plus de pouvoir politique ainsi que de ceux qui aspiraient à obtenir des créances sur les largesses de la redistribution – et qui s’imaginent désormais y avoir « droit », parce qu’ils ne peuvent plus imaginer de vivre sans ces « filets de sécurité » étatiques et qu’ils croient qu’un monde où le marché serait libre et l’État limité serait cruel, insensible et inhumain pour eux et pour les autres.
En 1902 aux États-Unis, les dépenses de l’État comme pourcentage du produit intérieur brut (PIB) n’était que légèrement au-dessus de 7 %. En 1930, avant la croissance massive de la taille et des prétentions des hommes de l’État lors du New Deal de Franklin Roosevelt et de sa Grande Dépression, les dépenses publiques en pourcentage du PIB n’allaient guère au delà de 10 %. En d’autres termes, il y a seulement 75 ans, 90 pour cent de la production de valeur dans l’économie américaine étaient employés et dépensés dans le secteur privé.
Aujourd’hui, ce sont plus de 40 % du PIB du pays que dépensent les hommes de l’État américain, et le secteur privé n’utilise et consomme que 60 % de sa production de valeur dans l’économie. Au cours de ces 75 années, la part des hommes de l’État a été multipliée par quatre, et la possibilité pour le secteur privé de disposer de sa propre production valorisée a diminué de 30 % au cours de cette période.
En 2010, les dépenses de l’État fédéral ont été de 3, 4 billions de dollars. En 1930, le même gouvernement fédéral avait dépensé 156,7 milliards de dollars (en dollars de 2010). Ainsi, les dépenses actuelles de l’État sont aujourd’hui 22 fois ce qu’elles étaient il y a 75 ans.
En 2010, les recettes fiscales de l’État fédéral ont été 2,16 billions de dollars. En 1930, l’État fédéral avait perçu 176 milliards de dollars en taxes (en dollars de 2010). Les impôts de l’État fédéral sont aujourd’hui 12 fois plus massifs qu’en 1930.
Qu’est-ce qui explique la différence de croissance entre les dépenses étatiques et celle des impôts perçus aux États-Unis ? Le déficit budgétaire de l’État fédéral.
En 1980, l’endettement fédéral accumulé (en dollars de 2010) était d’environ 3 000 milliards de dollars. En 2001, il était passé à quelque 7 000 milliards de dollars (en dollars de 2010).
Aujourd’hui, la dette de l’Oncle Sam dépasse 14 400 milliards de dollars, soit plus du double de ce qu’elle était il y a dix ans. En 1980, la dette publique s’élevait à moins de 30 % du PIB; aujourd’hui, elle atteint 100 % du produit intérieur brut américain.
La Constitution fiscale non écrite des États-Unis
Pourtant, pendant la plus grande partie des 150 premières années de l’histoire américaine, le gouvernement fédéral avait respecté ce que James Buchanan, prix Nobel d’économie, a appelé la “Constitution fiscale non écrite des États-Unis.”
Il n’y a rien dans la Constitution américaine qui oblige l’État à équilibrer son budget. Cependant, pendant le premier siècle et demi, la règle budgétaire était que l’État devait limiter ses dépenses aux fonctions étroitement énumérées par la Constitution, et devaient s’abstenir d’imposer aux générations actuelles et futures un endettement qui serait dû aux dépenses déficitaires du passé.
Si une urgence, comme la guerre, devait nécessiter que l’État emprunte pour couvrir une hausse inattendue et immédiate des dépenses, le gouvernement devait, lorsque l’urgence était passée, dégager des excédents budgétaires pour rembourser cette dette. Puis, il devait revenir à la règle de l’équilibre budgétaire.
Les économistes libéraux du XIXème siècle comprenaient que, lorsque chacune des dépenses de l’État doit s’accompagner d’un impôt correspondant, les citoyens connaissent directement la totalité de ce que toute dépense étatique envisagée coûtera et doit nécessairement coûter. Dans les conditions de l’équilibre budgétaire, toute proposition extravagante en faveur de dépenses étatiques plus massives et plus étendues, est inséparable d’une indication claire et explicite à l’usage des citoyens et ses électeurs sur ce qu’il faudra relever comme impôts et de combien. Il se peut que les électeurs continuent à soutenir une telle augmentation des dépenses publiques, mais il n’y a aucun moyen de leur cacher ce qu’il leur en coûtera en termes d’argent et de richesse en moins dans leurs poches, parce qu’il faudra bien lever des impôts pour couvrir les nouvelles largesses des hommes de l’État.
Pendant une bonne partie de l’histoire américaine, la constitution fiscale non écrite d’un budget équilibré a opéré comme une contrainte imparfaite, mais néanmoins effective sur la croissance de l’État.
La prescription keynésienne et le déficit budgétaire
Au début des années 1930, la règle d’équilibre budgétaire a été jetée par-dessus bord. Une cause majeure de ce changement est la « révolution keynésienne » en théorie et en politique économique.
Nommée d’après John Maynard Keynes qui a le premier formulé cette nouvelle théorie dans son livre de 1936, La Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, elle prétendait que l’économie de marché serait intrinsèquement instable et sujette à des fluctuations vastes et prolongées de l’emploi et de la production. Le remède était qu’en période de récession ou de dépression les hommes de l’État fassent des déficits budgétaires pour soutenir la dépenses et la reprise dans l’économie, et dans les phases de prospérité engrangent des excédents budgétaires pour amortir les tendances inflationnistes et pour rembourser ou réduire tout endettement accumulé.
Au lieu d’équilibrer le budget chaque année, les keynésiens disaient que c’est sur le cycle économique que le budget doit être équilibré, les décideurs étatiques usant de leurs théories avec sagesse et clairvoyance pour gérer et manipuler les dépenses, l’imposition et l’emprunt de l’État pour maintenir le plein emploi, la stabilité économique, et la croissance économique à long terme. Avec une arrogance extrême, ces économistes keynésiens prétendaient qu’ils auraient découvert, et pourraient administrer, une panacée pour toutes les incertitudes et vicissitudes dans la plus grande partie de la vie économique quotidienne.
Cependant, alors que les keynésiens caressaient leurs rêves de maîtriser et de manipuler l’économie de marché par l’« activisme » miraculeux de leur politique monétaire et budgétaire, les politiciens ordinaires qui cherchent à se faire élire et réélire, trouvaient dans cette révolution keynésienne leur miracle à eux.
C’était enfin là le moyen d’offrir à leurs électeurs quelque chose pour rien. Sous prétexte de « créer des emplois », de « favoriser la croissance économique », et de « libérer l’économie de ses fluctuations », ils allaient apparemment pouvoir proposer indéfiniment des dépenses sans avoir besoin d’associer la facture d’impôts correspondante à leurs promesses électorales.
Davantage de redistribution sociale, de logements sociaux; de dépenses publiques d’enseignement, plus d’argent pour les heureux bénéficiaires des subventions de l’État dans la culture ou la recherche scientifique ; de plus grosses subventions pour certains groupes de producteurs dans la circonscription électorale du candidat ; des administrations publiques en expansion pour réglementer et contrôler divers aspects des entreprises et des échanges au bénéfice des divers groupes d’intérêts particuliers qui tentent de manipuler le marché à leur avantage propre grâce au pouvoir des hommes de l’État.
Les possibilités paraissaient illimitées, et toutes avec une facture pour le contribuable bien plus faible que la facture réelle, pour toutes ces merveilleuses dépenses offertes à des divisions croissantes de la société.
Les politiciens n’auraient pas pu le faire, si la contrainte n’avait pas été levée sur la capacité de l’État à emprunter pour dépenser.
Le recours à l’emprunt a ouvert la boîte de Pandore de la démagogie et du pillage politiciens. Ceux à qui l’État a promis ses dépenses, ses politiques et autres prestations diverses les reçoivent aujourd’hui, et au cours de la période qui précède les élections que les politiciens, qui offrent ces avantages politiques, espèrent bien gagner.
Ce qu’il en coûte d’emprunter l’argent
La charge totale de leur financement ne ressortira qu’au bout de nombreuses années ou décennies, à mesure que les déficits annuels s’ajoutent à la dette accumulée, avec l’intérêt et les remboursements du principal qui arrivent périodiquement à échéance.
En ce moment, le gouvernement des États-Unis emprunte environ 40 cents de chaque dollar qu’il dépense. Les contribuables ne ressentent pas directement et immédiatement l’impact des déficits, car on ne les taxe pas assez pour couvrir ces 40 pour cent-là de dépenses étatiques.
Il y a lieu de souligner et de ne pas oublier, cependant, que les citoyens paient bel et bien un prix aujourd’hui pour les déficits que l’État subit. Il se peut que les hommes de l’État ne confisquent pas tout le montant de l’impôt nécessaire pour couvrir la totalité de leurs dépenses, mais pour en couvrir le reste ils doivent emprunter la différence. Récemment, ce besoin de financement du déficit a égalé un billion de dollars ou plus par année.
Chaque dollar emprunté par les hommes de l’État, et les ressources réelles que cette somme représente comme pouvoir d’achat sur le marché, sont autant de moyens de production qui ne sont plus disponibles pour une utilisation dans le secteur privé. C’est un dollar de moins en ressources réelles disponibles pour l’investissement dans le secteur privé et la formation du capital, pour la recherche et le développement dans le secteur privé, ou pour le développement de la production et la création des emplois dans le secteur privé.
Le financement des déficits et de la dette accumulée ne sont donc pas des charges que pour les contribuables à venir. Ce sont des charges sur la population actuelle, laquelle s’en trouve appauvrie d’autant, et qui laissent d’autant moins de richesse et de capacité productive à la prochaine génération, car on les arrache à l’entreprise privée pour couvrir à la place les cadeaux actuels du gouvernement.
De l’État limité au tout-État
Ce qui a permis de fonctionner à la première constitution fiscale de l’Amérique au XIX° siècle et au début du XXème n’est évidemment pas qu’elle avait été gravée dans le marbre – parce qu’elle ne l’était pas. On s’y est conformé parce qu’en général on la considérait comme « ce qu’il fallait faire ». Et on la tenait pour telle parce que cela faisait partie d’un ensemble d’idées politiques et économiques assises sur la conviction que les hommes de l’État n’avaient pas à distribuer de faveurs financières ou réglementaires, ni de privilèges aux dépens des autres membres de la société, à divers groupes d’intérêts particuliers.
La pratique d’un État limité voulait dire des dépenses publiques limitées. Personne n’avait besoin de tenter de cacher ce que coûtait l’État, quand ce sur quoi les hommes de l’État dépensaient de l’argent consistait, pour l’essentiel, dans le petit nombre de fonctions énumérées que la Constitution confiait à l’État fédéral.
En 1869, quand fut publié le premier World Almanac, tous les bureaux et activités du gouvernement fédéral y tenaient littéralement sur une seule page, et la moitié de cette page unique était couverte par les noms des ambassadeurs américains à l’étranger.
Aujourd’hui, si vous prenez un exemplaire du World Almanac, vous constaterez que les bureaux, départements et agences de l’État fédéral occupent plusieurs pages avec des centaines d’entrées en caractères minuscules.
Le tout-État apporte avec lui une dette immense et galopante parce que la société des « droits à », la société de la redistribution, celle du pillage politique, n’a aucune limite lorsqu’on envisage l’État comme un distributeur paternaliste, et non plus comme le protecteur, essentiel mais plus modeste, de la vie, de la liberté et de la propriété de chaque individu.
Ce ne sont pas des accords conclus entre les principaux coupables, alors que leurs interactions avec les groupes d’intérêt particuliers sont ce qui a créé et qui entretient le Léviathan de l’État fiscal, qui permettront de résoudre le problème de la dette et des déficits américains.
Ce dont nous avons besoin, est d’une mutation des idées et des croyances. Tant qu’il y aura trop de citoyens pour croire qu’ils auraient des « droits » sur le revenu, le patrimoine et la production d’autrui, et aussi longtemps que tant d’entre eux accepteront, soit par ignorance, soit par sentiment d’être coupables, de subir l’obligation d’être imposés, réglementés et pillés pour satisfaire ces « droits »-là, il ne pourra se produire et il ne se produira que peu de changement pour radicalement changer la direction prise.
Défense morale de la liberté
Une autre façon de dire ce qui précède est que nous devons réhabiliter l’argumentation morale pour la liberté.
Pour ce redressement moral, le point de départ est de rejeter la conception collectiviste de l’homme et de la société. Les collectivistes de tout poil, socialistes, communistes, fascistes, interventionnistes et socio-démocrates, partent du principe que le groupe – la tribu, la «nation», ou la « classe sociale » – aurait le pas sur l’individu. Celui-ci devrait servir et, si nécessaire, être sacrifié pour le « bien commun» ou « l’intérêt général », puisque l’individu n’aurait ni existence distincte ni « droits » indépendants du collectif auquel il appartient.
Comparez cela avec la philosophie unique et nettement différente de l’homme et de la société que traduit la Déclaration d’indépendance américaine :
« Nous tenons ces vérités pour évidentes : que tous les hommes sont créés égaux, qu’ils sont dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la poursuite du bonheur.” « Que c’est pour garantir ces droits, que les gouvernements sont établis parmi les hommes, la justice de leur pouvoir émanant du consentement des gouvernés ».
Les Droits sont antérieurs à l’État ; ils ne sont pas quelque chose qui serait donné à l’homme par une autorité politique quelconque. Chacun de nous possède des droits que ceux qui se trouvent avoir le pouvoir politique ne peuvent pas supprimer ni disqualifier. Nous possédons tous un droit inaliénable sur notre vie, sur notre liberté et notre propriété. Nous sommes propriétaires de nous-mêmes et, par extension, nous avons un droit de propriété sur ce que nos esprits créatifs et nos efforts ont produit sans violence. Personne n’a le Droit de nous asservir, de nous sacrifier, ou de nous piller, que ce soient des particuliers ou des États institués.
C’est l’individu, et non quelque mythique collectivité, qui est le centre et le point de départ de la société. Le marché libre est le lieu où les gens forment des relations pour leur avantage réciproque sur le fondement de l’échange volontaire.
C’est par lui-même que l’homme libre trouve le sens de sa vie, guidé par la philosophie ou la foi de son choix. Il se refuse à imposer par la force sa volonté à autrui, de même que les autres n’ont pas à employer la force contre lui. C’est par la raison et par l’exemple qu’il persuade les autres de changer de vie et de projets, et non avec des balles ou des baïonnettes. Et il n’existe aucune autorité politique qui puisse émettre des prétentions sur sa vie, sa liberté et sa propriété honnêtement acquise, parce que le rôle d’un État limité est d’assurer sa liberté à lui contre les prédateurs et leur pillage.
Voilà la philosophie de l’individualisme et du capitalisme qu’il faut faire renaître parmi nos semblables, si nous voulons libérer notre société de l’emprise du tout-État et de son océan de dettes.
Cela exige que nous soyons assurés d’avoir raison, que la raison et l’histoire ont démontré les résultats bénéfiques de ce qu’Adam Smith avait appelé « le système de la liberté naturelle ».
L’importance de la bataille des idées
Un tel appel à une bataille des idées politiques et économiques pourrait sembler irréaliste voire inutile vu l’urgence de nos problèmes politiques et budgétaires.
Cependant, les crises sociales politiques et économiques de notre époque sont l’effet d’une bataille d’idées plus ancienne que les ennemis de la liberté et du capitalisme ont alors, dans une large mesure, gagnée.
Ceux-ci ont mis la société de liberté au banc des accusés; ils ont falsifié la réalité du capitalisme et de ses résultats spectaculaires comme libérateur de l’homme face à la pauvreté, et ils ont ancré dans l’esprit de trop de monde une conception des créances politiques qui sert la volonté de puissance des paternalistes, et passe nécessairement par le pillage des membres de la société qui sont paisibles et productifs.
Il y a bien une crise budgétaire – le monde occidental atteint les limites de la possibilité de vivre d’argent emprunté, à partir de promesses irréalistes et de principes criminels. Notre société est assujettie à un régime politique paternaliste et pillard qui menace de porter un coup d’arrêt à son potentiel de production. À l’extrême, cela pourrait conduire à une situation de consommation du capital, où les politiques de pillage, de dépenses et d’emprunt des hommes de l’État confisquent tellement au secteur privé qu’il en devient impossible pour les entreprises privées de maintenir la capacité productive dont notre niveau de vie dépend.
Les civilisations ont régressé dans le passé. Et cela peut se reproduire.
Que ce soit l’an prochain, ou dans deux ans, ou dans cinq que la phase finale de la crise budgétaire du système de redistribution étatique et de « droits à » soit atteinte, la question sera alors :
Qu’est-ce qui va succéder à la faillite et à l’effondrement du Léviathan de l’État fiscal ?
Notre société se trouvera à la croisée des chemins. Et lorsque ce moment-là arrivera, il est essentiel qu’il y ait suffisamment de gens qui comprennent les idées et les idéaux des droits individuels, de la liberté économique et du système de libre marché, qui puissent les expliquer et soient prêts à les défendre.
À défaut, l’avenir pourrait amener une régression vers un passé tragique, moins civilisé et bien plus pauvre.
—-
La version originale (en anglais) de ce texte de Richard Ebeling a été mise en ligne sur le site de Northwood University “In Defense of Capitalism” en date du 25 juillet 2011 sous le titre The Debt Crisis and the Fiscal Leviathan. Traduction de François Guillaumat.

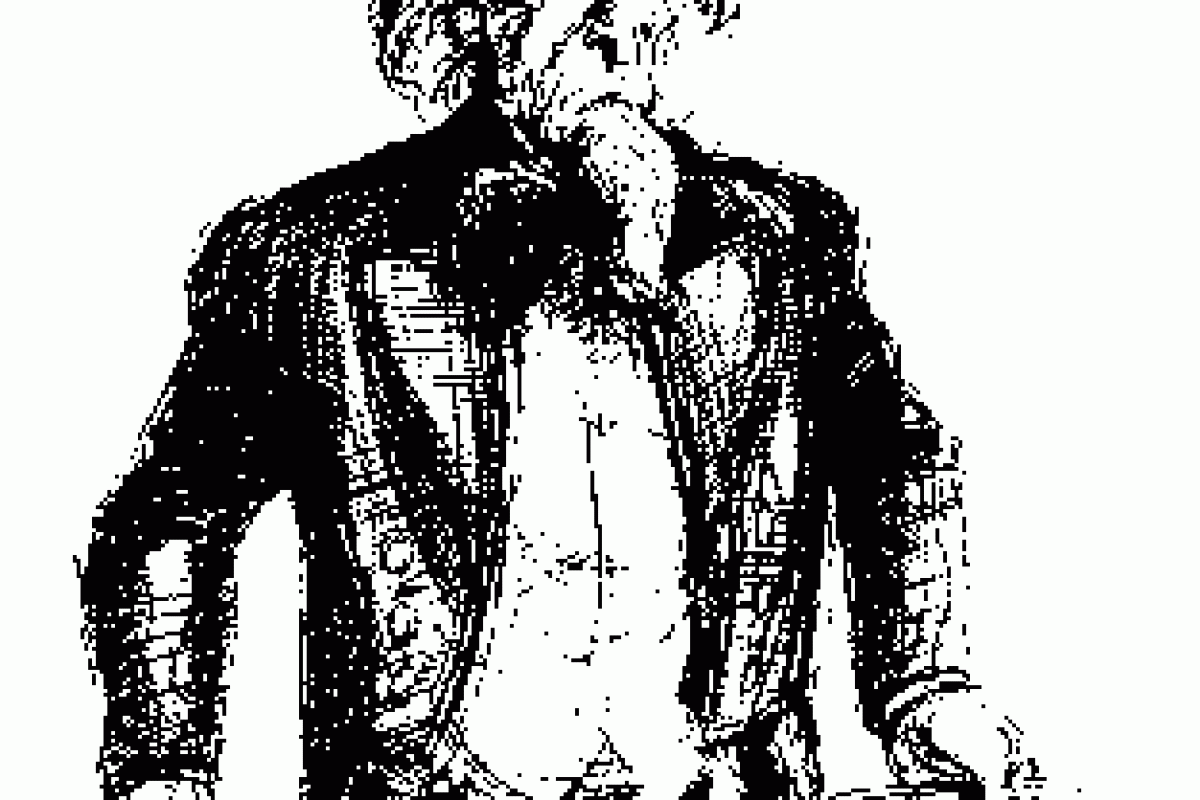



Excellent article. J’espère que les lecteurs de contrepoints ne passeront pas à côté compte tenu de sa longueur.
“Ce sont les libéraux classiques qui ont fait campagne contre l’esclavage et qui y ont mis fin, d’abord en Europe puis dans le reste du monde.”
Faux ! Ce sont les protestants des pays Baltique (Suède) relayés par les Anglicans qui ont réussi via leurs liens et relais avec les armateurs et les parlements a prohiber la traite négrières. Le mouvement est à l’origine religieux (protestant).