Par Arthur C. Brooks et Peter Wehner (*)
Le modèle de la nature humaine que l’on retient conditionne tout le reste, du système économique que l’on préfère au système politique que l’on soutient.
Au cœur de tout système social, politique et économique on retrouve une certaine image de la nature humaine – pour paraphraser le chroniqueur du 20e siècle Walter Lippmann. Les suppositions avec lesquelles nous allons commencer, et qui ont trait à la manière dont cette image est développée, déterminent la vie que nous menons, les institutions que nous construisons, et les civilisations que nous créons. Elles font office de première pierre.
Trois visions de la nature humaine
Au cours du 18e, une période qui a vu l’avènement du capitalisme moderne, il y avait plusieurs courants de pensée sur la nature de la personne humaine. Trois modèles ont été particulièrement importants.
Le premier défendait l’idée que les humains, bien qu’imparfaits, sont perfectibles. Selon le second, nous sommes imparfaits, et ce de manière « fatale » ; nous avons besoin d’accepter et de construire notre société autour de cette réalité déplaisante. Un troisième point de vue était que, bien que les êtres humains soient imparfaits, nous restions capables d’actes vertueux et d’auto-gouvernement. Autrement dit, dans les bonnes circonstances, la nature humaine peut fonctionner d’une manière qui profite au plus grand nombre.
La première école inclut ceux qui, représentant les Lumières françaises, croient en la perfectibilité de l’homme et en la prééminence de la rationalité scientifique. Leurs plans ont été grandioses, utopiques et révolutionnaires, visant à « la régénération universelle de l’humanité » et la création d’un « homme nouveau. »
Ces notions, défendues par Jean-Jacques Rousseau et d’autres philosophes des Lumières, ont fortement influencé, toute une génération plus tard, des penseurs socialistes. Ces théoriciens, parmi lesquels Robert Owen, Charles Fourier, ou Henri de Saint-Simon, ont estimé que la nature humaine pouvait être aussi facilement transformée que de la cire chaude. Ils ont considéré la nature humaine comme plastique et malléable, au point qu’aucun caractère fixe de l’homme ne pouvait être distingué. Les architectes du système social pourraient, par conséquent, mouler la société dans tout ce qu’ils ont imaginé.
Ces théoriciens rêvaient d’une société commune, libérée de la propriété privée et débarrassée de l’inégalité humaine. Ils ont formulé une théorie de la nature humaine et de l’organisation socio-économique qui a finalement influencé le critique le plus célèbre et amère du capitalisme : le philosophe allemand, économiste et révolutionnaire Karl Marx.
Le second courant de pensée, incarné par les écrits d’auteurs anglais du 17e siècle tels que Thomas Hobbes et Bernard Mandeville, voyait la nature humaine comme au contraire inélastique, « cassante », et inaltérable. Et les individus étaient, selon eux, des êtres antisociaux.
Hobbes, par exemple, s’inquiétait de ce que les gens soient un jour confrontés au danger de retomber dans un état pré-civilisé, « sans un pouvoir commun qui les tienne tous en respect », qui, à son tour, conduirait à une existence sans espoir, un « état de nature » caractérisé par la « guerre de tous contre tous. » C’était, écrit Hobbes, une vie « solitaire, pauvre, désagréable, brutale et brève. » Pour éviter ce sort, la solution est de se soumettre à l’autorité de l’ État, ce qu’il appelait le « Léviathan » – une monstrueuse créature de mer polycéphale mentionnée dans la Bible hébraïque. Dans un tel processus, nous gagnerions assurément en sécurité, mais au détriment toutefois de la liberté.
Le troisième modèle de la nature humaine se trouve dans la pensée des fondateurs de l’Amérique. « Si les hommes étaient des anges», écrit James Madison, le père de la Constitution, dans le Federalist Paper n° 51, « aucun gouvernement ne serait nécessaire. » Mais Madison et les autres fondateurs savaient que les hommes n’étaient pas des anges et n’en deviendront jamais. Ils croyaient plutôt que la nature humaine a été mélangée, avec une combinaison de vertu et de vice, de noblesse et de la corruption. Les gens sont influencés à la fois par la raison et la passion ; ils sont capables de s’auto-gouverner, mais pas d’inspirer confiance s’ils détiennent le pouvoir absolu. L’hypothèse de ces fondateurs était que, dans chaque cœur humain, ou bien plus simplement entre individus différents, des impulsions morales contradictoires se font concurrence.
Ce dernier point de vue de la nature humaine est compatible avec la réflexion de l’enseignement chrétien. Les Écritures enseignent que nous sommes faits à fois à l’image de Dieu et des créatures déchues ; dans les paroles de saint Paul, nous pouvons être des « instruments de justice » au même titre que des « instruments de méchanceté. » Les êtres humains sont capables d’actes misérables et d’actes de noblesse ; nous pouvons poursuivre le vice tout comme la vertu.
Quant à la question de l’État, il est clairement indiqué, dans Romains-13, que le gouvernement est mandaté par Dieu pour préserver l’ordre public, empêcher le mal, et rendre la justice possible. Cela, aussi, était un point de vue partagé par la plupart des Pères fondateurs. Le gouvernement reflète la nature humaine, ont-ils fait valoir, « parce que les passions des hommes ne se conformeront pas aux préceptes de la raison et de la justice sans contrainte. »
La philosophie des Lumières à la mode anglo-écossaise d’Adam Smith, David Hume, et Francis Hutcheson peut s’aligner à la fois avec le point de vue des fondateurs américains et celui de l’enseignement chrétien. Smith a été lui-même un professeur de philosophie morale ; sa Théorie de morale des Sentiments a précédé La richesse des Nations. Smith et ses compatriotes ne croyaient pas en la perfectibilité de la nature humaine et jugeaient inepte de construire toute institution humaine sur la possibilité d’atteindre une telle perfection. Ils ne croyaient pas non plus que la nature humaine était irrémédiablement corrompue et sans vertu.
L’intérêt personnel : une caractéristique positive ou négative de l’homme ?
Les Fondateurs américains croyaient, et le capitalisme repose sur cette conviction, que les individus sont entraînés par leur « intérêt personnel » ainsi que par le désir d’améliorer leur condition. La poursuite de l’intérêt personnel n’est pas nécessairement une mauvaise chose; en fait, Smith croyait que le bien-être général dépendait de la capacité à permettre à un individu de poursuivre ses propres intérêts « tant qu’il ne violait pas les lois défendues par la justice. » Quand une personne agit en son propre intérêt, « il favorise souvent [les intérêts] de la société plus efficacement que quand il a vraiment l’intention de les promouvoir. »
Michel Guillaume Jean de Crèvecœur, qui figure parmi les premiers écrivains qui ont tenté d’expliquer le concept de frontière américaine ainsi que l’idée de l’« American Dream » à un public européen, a bien saisi cette idée en écrivant :
L’Américain devrait donc aimer ce pays beaucoup plus que celui dans lequel lui ou ses ancêtres sont nés. Ici les fruits de son industrie suivent d’un pas égal les progrès de son travail ; son travail est fondé sur la base de la nature, c’est-à-dire l’intérêt personnel… peut-il espérer plus fort attrait ?
Adam Smith a considéré comme acquis que les gens sont motivés par la poursuite de leur propre intérêt, et par le désir d’améliorer leur condition.
« Ce n’est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner », ainsi qu’il l’a formulé, « mais de leur égard pour leur propre intérêt. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur amour-propre, et ne leur parlons jamais de nos propres besoins, mais de leurs avantages. »
Exploité et canalisé dans le bon sens, alors, l’intérêt personnel, lorsqu’il est placé au sein de certaines règles et limites, peut être bon, menant à une société plus prospère et plus humaine.
Ici, il est important de distinguer entre l’intérêt personnel et l’égoïsme. Le premier, à la différence de l’égoïsme, conduit souvent à commettre des actes d’altruisme ; bien compris, il sait que nul homme n’est une île, que nous faisons partie d’une communauté plus large, et que ce qui est bon pour les autres est bon pour nous. Pour le dire autrement : la poursuite de notre propre bien peut faire progresser le bien commun. De plus, promouvoir le bien commun peut faire avancer notre propre bien.
Les partisans de la libre entreprise estiment que la créativité, le sens de l’initiative, et l’ingéniosité sont des éléments essentiels de la nature humaine. Le capitalisme vise à tirer parti de l’intérêt de la nature humaine, sachant que les effets collatéraux feront tendre le tout vers une société plus décente et plus bienveillante. Les capitalistes croient que la liberté est un bien inhérent et devrait constituer la pierre angulaire non seulement de nos institutions politiques, mais de celles qui sont économiques. Les défenseurs du libre-marché ont également insisté pour que la richesse et la prospérité puissent atténuer l’envie et le ressentiment, qui ont des effets acides sur les relations humaines. Les marchés, précisément parce qu’ils créent de la richesse, finissent aussi par distribuer cette richesse.

De la relation entre la nature humaine et l’État
Pourquoi est-ce que tout cela est-il important ? Tout simplement parce que notre « image de la nature humaine » détermine, dans une large mesure, les institutions que nous concevons. Par exemple, les architectes de notre système de gouvernement ont soigneusement étudié l’histoire et tout arrangement politique possible qui ait été conçu en leur temps. Dans le cadre de leur analyse, ils ont porté des jugements fondamentaux sur la nature humaine et ont conçu une forme de gouvernement constitutionnel avec ce reflet à l’esprit.
Ce qui est vrai pour la création d’institutions politiques est également vrai pour les aventures économiques. Elles aussi procèdent de la compréhension du comportement humain.
Il est difficile d’exagérer l’importance de cette question. Le modèle que l’on retient de la nature humaine conditionne tout le reste, du système économique (capitalisme de libre marché ou socialisme) au système politique (la démocratie ou la « dictature du prolétariat »). Comme un navire sur le point de commencer un long voyage, une erreur de navigation au départ peut conduire une équipe à s’égarer puis s’orienter vers le naufrage. Pour utiliser une autre métaphore, cette fois-ci issue du monde de la médecine : un médecin ne peut pas traiter une maladie avant qu’elle ait été diagnostiquée correctement; diagnostiquer de manière incorrecte peut rendre les choses bien pires que ce qu’il pourrait en être autrement.
Ceux qui défendent le capitalisme s’appuient sur une vérité dont l’influence ne se tarit pas: si vous créez un lien entre récompense et effort, vous obtiendrez plus d’efforts. Si vous créez des incitations pour un type particulier de comportement, vous pourrez voir ce comportement se développer.
Un marché libre peut aussi améliorer notre condition morale ; non pas toujours de façon spectaculaire et ni systématique, mais assez souvent néanmoins. Il met l’accent sur l’épargne et l’investissement. Et le capitalisme, lorsqu’ils fonctionne correctement, pénalise certains types de comportements comme la corruption et l’anarchie parce que les citoyens, dans une société capitaliste, ont un intérêt énorme pour décourager un tel comportement, qui est tel un poignard visant directement le cœur de la prospérité.
Le critique Irving Kristol a fait valoir, à juste titre à notre avis, que les architectes au début du capitalisme démocratique croyaient que les transactions commerciales « seraient elles-mêmes constamment affinées et élargiraient le sens que l’individu a de son propre intérêt, de sorte qu’à la fin, le type de société commerciale qui a été envisagé correspondrait à une communauté relativement humaine. »
Mais le capitalisme, comme la démocratie américaine elle-même, n’est guère parfait ou suffisant en tant que telle. Il a une histoire pleine de revers et de moments glorieux. Et, comme l’Amérique, il s’agit d’une expérience sans fin, qui ne se réalise jamais pleinement. Le capitalisme exige, hors du champ politique ou économique, des structures fortes, dynamiques, comme la famille, les églises et autres lieux de culte, ainsi que les associations civiques et les écoles. Ces institutions sont nécessaires pour permettre au capitalisme de faire avancer le progrès humain.
Une société capitaliste a besoin de générer, par l’éducation, une population instruite. Elle doit être conduite par des personnes qui possèdent et qui enseignent des vertus comme la compassion, l’altruisme, l’autodiscipline, la persévérance et l’honnêteté. Et cette société a besoin d’un système politique qui respecte les lois, les contrats, et les résultats des élections – quelle que soit leur résultat. Sans ces vertus, la vénalité peut ronger le capitalisme de l’intérieur et l’utiliser à des fins pernicieuses.
Nous devons comprendre que le capitalisme, comme la démocratie, participent d’un réseau social complexe. Le capitalisme dépend à la fois de ce tissu tout en y contribuant puissamment. La morale et le capitalisme, comme la morale et la démocratie, sont intimement liés et très complémentaires. Ils se renforcent l’un l’autre, ont besoin l’un de l’autre, et sont terriblement diminués si l’un va sans l’autre. Ces deux piliers sont, en vérité, les maillons d’un véritable « chaîne d’or. »
Article publié initialement dans la revue The American. Traduit par Philippe Deswel pour Le Bulletin d’Amérique.
———————
(*) Arthur C. Brooks est Président de l’American Enterprise Institute. Il a été Professeur d’économie et de théorie du gouvernement à l’université de Syracuse. Il a obtenu son Ph.D à la Rand Corporation et a écrit de nombreux ouvrages, notamment The Battle: How the Fight Between Free Enterprise and Big Government Will Shape America’s Future (Basic Books, May 2010), Gross National Happiness (Basic Books, 2008), et Who Really Cares (Basic Books, 2006).
Peter Wehner est Senior Fellow au Center for Ethics and Public Policy. Il a servi dans les administrations Reagan et Bush père et fils. Il a notamment dirigé le Bureau des initiatives stratégiques en 2002. Il est l’auteur de City of Man: Religion and Politics in a New Era. Le Bulletin d’Amérique a déjà traduit un de ses articles: Ronald Reagan et la promotion de la Démocratie.
Source : Nicomaque.

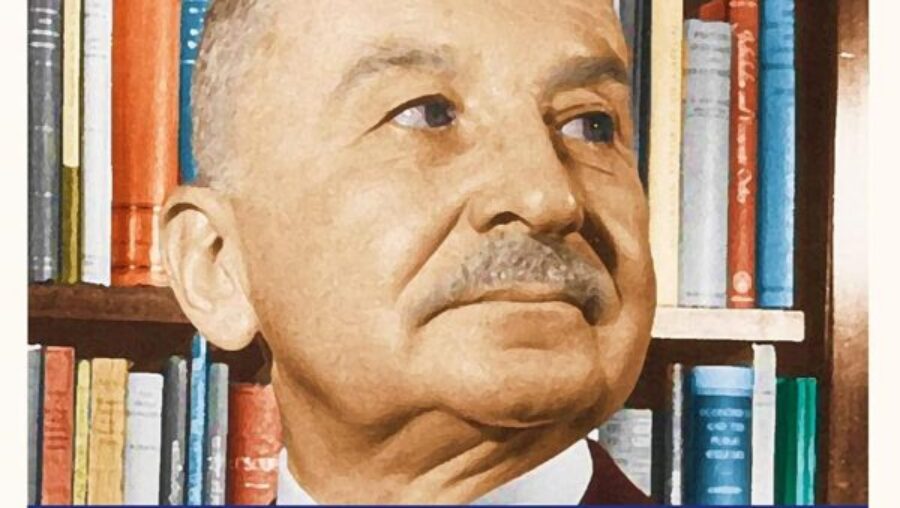

Laisser un commentaire
Créer un compte