 Un des arguments récurrents dans le débat sur le sous-développement, notamment en Afrique, consiste à poser le problème en termes de culture et de mentalité. Nombre d’Africains, pour expliquer leur « sous-développement », pointent ainsi du doigt le manque de confiance en soi et entre eux, le manque d’organisation et d’esprit d’initiative : l’ « homme africain » serait sujet à une peur paralysante l’empêchant d’initier la dynamique du développement. Ce qui s’apparente à un véritable complexe d’infériorité, à un discours d’auto-dévalorisation, semble être internalisé, particulièrement par l’élite universitaire africaine : « les Africains n’ont pas l’esprit d’entreprise ou du commerce ».
Un des arguments récurrents dans le débat sur le sous-développement, notamment en Afrique, consiste à poser le problème en termes de culture et de mentalité. Nombre d’Africains, pour expliquer leur « sous-développement », pointent ainsi du doigt le manque de confiance en soi et entre eux, le manque d’organisation et d’esprit d’initiative : l’ « homme africain » serait sujet à une peur paralysante l’empêchant d’initier la dynamique du développement. Ce qui s’apparente à un véritable complexe d’infériorité, à un discours d’auto-dévalorisation, semble être internalisé, particulièrement par l’élite universitaire africaine : « les Africains n’ont pas l’esprit d’entreprise ou du commerce ».
À voir les milliers de petites échoppes sur les routes africaines, ou toutes ces femmes qui vendent des fruits et légumes qu’elles transportent souvent sur leur tête, ou encore ces jeunes agents de change informels sur les trottoirs, on a du mal à croire que « l’homme africain n’a pas l’esprit d’entreprise ou du commerce ». C’est même tout le contraire qui se dégage de cette vie économique informelle qui grouille véritablement partout en Afrique. En fait, la culture du marché est profondément ancrée dans la tradition africaine. Le contraste est donc saisissant entre cette réalité et l’analyse rapide de la société africaine par une certaine élite africaine (et internationale).
Un complexe étouffant
Cette vision pessimiste des Africains semble en fait légitimer un modèle d’État autoritaire, planificateur, initiateur, doté d’une administration étouffante, une bureaucratie d’État productrice de réglementations souvent insensées : c’est le paternalisme à l’africaine. Et monter une entreprise formelle passe nécessairement par des appuis politiques. Le « bas » étant posé par définition comme incapable, on le dénigre ; et on justifie en même temps un « haut » qui ne fait en réalité qu’étouffer le « bas » en l’empêchant de s’épanouir.
L’idée que le développement se fait « par le bas », c’est à dire par l’activité entrepreneuriale, ne semble pas faire partie du paysage analytique de cette élite. Une certaine science économique, très largement inspirée par une macroéconomie désincarnée plutôt que par l’étude de l’action humaine, a ici contribué à biaiser la perception des mécanismes du développement. « Politique d’industrialisation », planification, encouragement des secteurs clés : tout passe « par le haut », c’est à dire le politique. Ce mécanisme d’autolégitimation est bien pratique et aboutit à un formatage idéologique des jeunes diplômés, qui finissent alors par aspirer à un poste dans l’administration plutôt qu’à devenir des entrepreneurs. Le système est alors verrouillé : les intérêts « en haut » comme les idées vont dans le sens du statu quo.
La vision de la mondialisation est elle aussi biaisée dans ce discours élitiste pessimiste. Plutôt que de réaliser que les africains ne profitent pas assez des opportunités de la mondialisation, cette dernière est fustigée comme source de leurs malheurs. Pourtant, dans ces États, les « relations internationales » sont limitées à quelques contrats avec des multinationales soutenues par d’autres États. Ces collusions ont plus à voir avec la corruption du politique (des deux côtés), que d’une quelconque logique de marché libre : les privatisations sont par exemple très souvent effectuées sans véritables appels d’offres. L’argument « nous ne sommes pas prêts » revient de manière récurrente, et renforce l’attitude « parentaliste », cet appel à l’État protecteur. Mais ce dernier est en réalité étouffeur et prive les populations des opportunités de la mondialisation.
Culture ou incitations
Mais les comportements économiques ne sont pas que déterminés par la culture : les incitations des individus sont très largement dépendantes des institutions formelles, c’est à dire les règles économiques et juridiques explicites, en vigueur dans un pays. Lorsque tout est fait par une administration pléthorique pour mettre des obstacles à la constitution d’entreprises légales dans le secteur formel, comme des délais de plusieurs années pour obtenir des autorisations ou des titres de propriété, il est bien évident que les populations se cantonnent au secteur informel qui par définition ne leur offre pas l’opportunité de faire grandir leur affaire. La faible qualité institutionnelle du soi-disant paternalisme africain étouffe le développement.
Bien sûr la plupart des gens n’ont pas l’esprit d’entreprise, et n’ont pas un sens aigu de l’organisation. Ce fait n’est pas limité aux pays en développement : il est aussi vrai dans les pays dits développés. Mais dans ces derniers règne en règle générale un certain degré de qualité institutionnelle qui favorise justement l’épanouissement de l’esprit d’entreprise et de l’organisation de certains, qui peuvent ainsi faire prospérer leurs affaires dans le secteur formel, créer des grands réseaux anonymes de commerce, et embaucher, diriger ceux qui n’ont pas ces aptitudes. Dans ce cadre, la possibilité d’imiter ceux qui réussissent, à travers un processus d’essai-erreur-correction, est un moteur puissant pour l’évolution sociétale et économique.
En matière de développement, avant de se poser des questions de culture, qui sont bien sûr importantes, il faut d’abord traiter celles des incitations posées par les institutions formelles émanant du politique. La créativité humaine et l’échange sont universels : dans ce cadre, le processus de développement qui est fondé sur leur épanouissement ne peut être initié que par les institutions de la liberté.


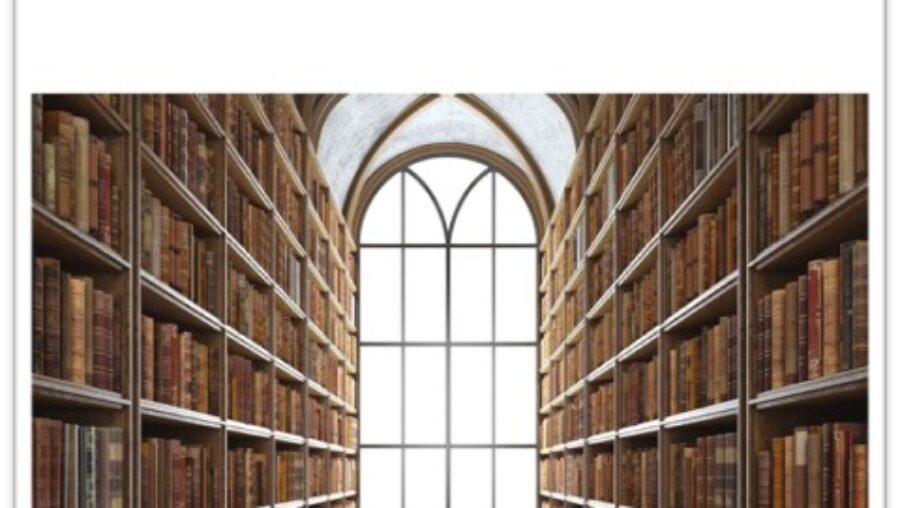

C'est le fond de ma pensée !
Le soucis viens de la possibilité de changer les choses.
Couper les têtes des politiques et placer des occidentaux capables de mettre en place?
Pas de légitimité…
Influencer les politiques Africains lors de lors études (toujours effectués en occident)?
Trop long… (et possible?)
Autres solutions?
Je serai ravis de les connaitre, à vos idées svp !
Comme j’ai ecris il y a quelques annees dans ma these d’urbanisme : Le devellopement n’aura pas lieu.
(avec un point) cela fait 50 ans de pseudo tentatives de devellopement en Afrique … sans resultat. les dirigeant sont incapable du moindre “bon sens” de base. La seule solution que j’entrevoie passe par des initiatives privees d’infrastructures qui peuvent etre support d’autres initiatives conjointes … le tout en ecartant les intances etatiques et gouvernementales le plus possible. Tout un programme !!!
quelques exemples de sociétés qui sont passée du Tiers-Monde à des pays industrialisés en moins de 40 ans:
-La Corée du Sud, qui était il y a moins de 40 ans bien plus pauvre que la Corée du Nord. Aujourd’hui, un est un état failli et l’autre est un pays hyper-développé
-Hong Kong
-Le Japon qui a connu une croissance très grande entre les années 50 et 80 avant qu’elle s’embarque vers le corpo-keynésianisme qui a eu des conséquences néfastes jusqu’à nos jours
-Taiwan
-Le Chili qui est probablement l’un des pays les plus prospères en Amérique Latine en ce moment
-La Nouvelle-Zélande qui a entrepris des réformes très importantes dans les années 80-90 pour devenir un exemple d’une véritable société libérale
-Singapour qui malgré qu’avec état assez paternaliste a connu un développement sans pareil depuis les années 50
-L’Estonie qui est un exemple peu mentionné