S’adapter, de Clara Dupont-Monod
Je ne m’intéresse pas particulièrement aux prix littéraires, dont je crains toujours qu’ils répondent à des critères qui nous échappent en partie… J’éprouve moins de réserves – peut-être à tort – à l’égard d’un Goncourt des lycéens, en qui j’ai un peu plus confiance qu’en d’autres prix.
Ce roman est, en effet, bien écrit, d’une réelle force et identité, centré sur un sujet sensible et souvent méconnu. La naissance d’un enfant au lourd handicap, pas forcément visible immédiatement, constitue de fait un événement pas banal et difficile à gérer, contraignant chacun à… s’adapter.
C’est le cas du frère aîné, encore très jeune lors de cette naissance. Sa personnalité va changer du tout au tout, dès lors qu’en tant que grand frère, il se sent investi d’une responsabilité de prendre en charge en grande partie la vie végétative de ce petit être loin de tout, hors de la vie sociale des humains.
C’est à une observation de sa vie et de sa manière particulièrement bienveillante et investie de se soucier du bien-être de son petit frère, au point de sacrifier sa propre vie sociale, que l’on va s’intéresser dans la première partie.
Puis vient le tour de la cadette, dont nous allons observer également la manière de réagir à cet important bouleversement de la vie familiale et les états d’âme qui sont les siens. Toujours de manière pudique, en observant les non-dits, les réactions des parents, de la grand-mère et de l’entourage, tout comme le parcours du combattant que doivent livrer le père et la mère face à des administrations et autres instances face auxquelles il faut se battre pour tenter d’obtenir un peu d’aide et de compréhension.
Un tel événement ne laisse personne indemne. Il lui faudra accepter de voir sa famille se déliter en partie, supporter les non-dits et le relatif effacement qu’elle subit au milieu de tous ces tourments. Pas facile. Là aussi, il lui faut trouver sa place. Et donc, s’adapter… à sa manière.
Enfin, une dernière partie, à laquelle on aurait moins songé spontanément, met en jeu l’arrivée plus tardive d’un autre enfant plusieurs années après, lorsque ses aînés ne vivent plus au sein du foyer familial.
Son regard sur ce passé qu’il n’a pas connu et dont on lui a peu parlé, mais dont il ressent tout le poids à travers sa particulière perspicacité, constitue un angle de vue original. C’est là aussi la force du roman que de l’imaginer et que le lecteur puisse envisager cette hypothèse.
Un roman original, assez puissant, efficace en matière de renforcement des qualités d’empathie que les lectures amènent chez ceux qui apprécient la littérature. Une belle leçon de vie et de philosophie de l’humanité. Un beau roman.
— Clara Dupont-Monod, S’adapter, Stock, août 2021, 200 pages.
Les âmes grises, de Philippe Claudel
Le roman porte parfaitement bien son titre. Je n’avais jamais lu Philippe Claudel et je ne connais donc pas son style, j’ignore par conséquent si l’écriture, dans ce roman, lui est purement spécifique, mais celle-ci est parfaitement adaptée à la situation : froide, chirurgicale, factuelle, sombre.
Le roman se situe en pleine Première Guerre mondiale, dans une petite ville de province, située près de terrains de guerre où les affrontements font rage et la mort rôde, emportant de nombreuses vies.
Il n’en faut sans doute pas davantage pour expliquer cette atmosphère de lourdeur particulière et intense qui sévit au sein de cette petite ville. Malheur, tristesse, résignation, état de folie, sentiment de culpabilité de ceux qui ne sont pas à la guerre, expliquent évidemment en grande partie cet état d’esprit tourmenté, même si on reste dans le non-dit, le temps qui semble figé, le malheur à peine refoulé.
Mais ce n’est sans doute pas tout. Toutes les âmes de ce village sont grises. D’un terrible gris terne. Pas une âme qui se distingue dans cette palette de couleurs sombres. Si ce n’est peut-être cette petite Belle de jour, dont il sera aussi question dans cette horrible histoire. Surtout, parmi les personnages qui nous sont présentés et seront au cœur de ce roman, certains se distinguent – au-delà des circonstances du moment – par leur monstruosité, la noirceur de leur âme, leur caractère décomplexé face aux malheurs, et leur manque total d’humanité. À faire frémir.
Quant au personnage dont il est probablement le plus question, ce procureur excessivement solitaire que j’ai imaginé tout au long du roman sous les traits de Jean-Pierre Marielle, influencé par la couverture du livre, il demeure d’un bout à l’autre totalement absent, comme ailleurs, dénué d’émotions et sans trace apparente d’un quelconque bonheur, prenant ses décisions comme de manière mécanique et froide, avec rectitude. Un personnage apparemment droit, digne, charismatique et respecté, mais sans saveur, terriblement terne, perdu, silencieux, sans doute profondément triste, très gris lui aussi, peut-être plus encore que tout autre à sa manière.
J’imagine parfaitement, sans l’avoir vu, le style du film qui en a apparemment été tiré. On penserait même que le livre est écrit à la manière d’un scénario de film. L’écriture de Philippe Claudel est irréprochable, il est parvenu à écrire une histoire qui s’accorde parfaitement avec le titre, de manière froide, très sombre, sans aucune lueur d’espoir. C’est certainement remarquable, et la lecture m’a semblé parfaitement convaincante et originale en ce sens. Mais cela m’a justement un peu trop rappelé le cinéma français, qui n’est pas celui que je préfère, parfois talentueux comme ici, cependant caractéristique d’un certain malaise qui ne m’est pas forcément agréable.
— Philippe Claudel, Les âmes grises, Le Livre de Poche, 286 pages.
Les coups, de Jean Meckert
Que se passe-t-il lorsqu’on ne possède pas les mots, que l’on peine à s’exprimer, à se faire comprendre, à comprendre les autres ?
Le sujet m’intéressait, car j’ai souvent lu – et j’ai souvent fait mienne – l’idée selon laquelle moins on a de vocabulaire, plus on peut être gagné par l’envie d’en découdre par d’autres moyens, c’est-à-dire en recourant à la violence, la bagarre, les coups. Une autre manière d’exister ou de se valoriser. Mais il me manque toutefois de preuves, d’exemples, de points d’appui bien concrets. C’est pourquoi je souhaitais lire ce roman, dans l’espoir d’avoir au moins une référence littéraire, faute de mieux.
La lecture a toutefois relevé un peu du calvaire. L’histoire est assez glauque, les personnages et leur milieu peu engageants, leur vie assez déprimante. Mais c’est aussi cela la littérature. Savoir se projeter dans différentes situations, différents milieux, différentes époques. J’ai donc pris sur moi et lu assez activement, de manière à me débarrasser assez vite de cette lecture guère passionnante (j’aurais aimé que ce roman fût plus court).
Quand je dis que c’est aussi cela la littérature, et que la lecture ne m’était pas très agréable, je rends hommage à l’écrivain, puisque Jean Meckert (dont je n’ai rien lu par ailleurs, donc dont je ne connais pas le style) réalise le tour de force d’écrire dans un style fautif et familier qui rend bien l’état d’esprit et la faiblesse de vocabulaire et d’expression du personnage principal.
Ce roman écrit sous la forme de la narration par le personnage principal, retrace donc l’état d’esprit qui est celui de Félix, jeune manœuvre un peu rustre et désœuvré, qui décide de se reprendre en mains, de chercher un vrai travail stable et une conquête féminine. C’est ce cheminement au départ réussi, chez un personnage dans le fond pas mauvais, que nous allons suivre, jusqu’au tournant qui va le conduire une première fois (avant que d’autres ne suivent hélas comme c’est généralement le cas) à user de coups envers sa bien-aimée, se sentant dépassé par son incapacité à savoir user des mots, à comprendre les autres, trouver la mesure afin de pouvoir se comporter socialement sans pour autant se renier et tomber dans le conformisme.
Un roman du quotidien, de la banalité, de la vie dans un milieu modeste des années 1940, et aussi de la violence conjugale qui hélas reste une constante quelles que soient les époques. Pas passionnant à mon goût et un peu long, mais une sorte de témoignage d’un état d’esprit d’un milieu, d’une époque, mais aussi d’un phénomène de société intemporel que l’on aimerait éradiquer.
— Jean Meckert, Les coups, Folio, 270 pages.
Un enfant sans histoire(s), d’Amélie Antoine
Ce roman est d’une construction plutôt originale. On comprend dès le début qu’un drame s’est déroulé, mais on ignore encore pour l’instant de quoi il s’agit exactement. Tout l’objet du roman va être d’entretenir le suspense pour nous faire comprendre peu à peu ce qui s’est joué et par quel processus on en est arrivé là.
Il s’agit d’un roman de nature psychologique, au suspense haletant et à l’atmosphère oppressante. La construction nous tient en haleine jusqu’au bout, laissant place aux témoignages a posteriori des différents témoins indirects et protagonistes de cette histoire, entrecoupés du vécu des parents du personnage central, un enfant de six ou sept ans, les quelques mois qui précèdent le drame. Jusqu’au dernier chapitre, qui présente enfin le dénouement final, celui où on finit par comprendre ce qu’il s’est passé… à la grande stupeur du lecteur.
Sylvain et Marianne sont un couple de parents qui ne parvenaient pas à avoir d’enfant. Jusqu’à ce qu’ils optent pour l’adoption d’un garçon bébé ukrainien de 17 mois, Vadim, adoption qui sera suivie étonnamment de la naissance impromptue d’un petit frère, Nathan.
Le bonheur est au rendez-vous pour ce couple uni. Jusqu’au jour où, vers l’âge de 5 ou 6 ans, Vadim évoque de manière insistante l’existence d’un grand frère, Volodya. Que personne ne constate et qui exaspère de plus en plus des parents pourtant patients.
Fantasme, caprice d’un enfant pourtant étonnamment calme et sans histoire, exceptionnellement mature et presque excessivement raisonnable, schizophrénie, traumatismes refoulés de l’enfance, manifestation paranormale ? Nous allons essayer de comprendre ce qu’il en est. Et l’auteur ne nous dévoilera rien du drame final jusqu’aux toutes dernières pages…
Cet auteur, Amélie Antoine, jouit apparemment d’un réel engouement. Ses romans semblent susciter un enthousiasme certain auprès d’un public conquis par son art de diversifier les situations, de sortir des sentiers battus pour captiver le lecteur, le surprendre, le faire pénétrer des lieux et situations d’une certaine noirceur et sans complaisance. Sans qu’on puisse facilement la classer, semble-t-il, dans telle ou telle catégorie littéraire. Prometteur.
— Amélie Antoine, Un enfant sans histoire(s), Muscadier, avril 2024, 268 pages.
Sodibor, de Jean Molla
Abasourdi, je l’ai été après avoir passé tout une journée à lire ce roman en continu, jusqu’à arriver à son terme. Mais abasourdi aussi par son contenu, d’une dureté toujours difficile à supporter.
« Est-ce qu’on peut savoir ce qu’on ignore ? », se demande le personnage principal au début du chapitre 14. Question qui peut ressembler à un sujet de philosophie, mais que vous comprendrez à la lecture de ce roman.
Une histoire forte et pleine de profondeur, dont je ne révélerai pas davantage le contenu que ne le fait la présentation de l’éditeur. Encore un livre sur les mêmes thèmes usés jusqu’à la corde, pensera-t-on ? Et pourtant, traité ici avec beaucoup d’intelligence, sans sensiblerie outrancière. Et l’auteur lui-même, en fin d’ouvrage, explique en quoi son roman n’est pas qu’une pâle copie d’autres productions déjà vues.
En ce qui concerne la cible, en revanche, il s’agit d’un roman recommandé à partir de la classe de troisième. Cela m’a, de prime abord, un peu freiné, mais, en fin de compte, même si j’en comprends bien l’idée, non seulement je ne regrette pas du tout ma lecture, mais j’aurais tendance en outre à considérer que 13-14 ans est bien jeune pour devoir affronter des réalités si effrayantes, même si chacun, bien évidemment, ne dispose pas de la même maturité.
Je conseillerais plutôt, pour cet âge, de commencer par la lecture de Maus, de Art Spiegelman, une BD qui permet de mieux faire ressentir certains événements avec une réelle efficacité et sensibilité, tout en restant bien plus pudique sur le fond. La lecture de ce roman, quant à elle, pourrait alors intervenir dans un second temps, par exemple.
Quoi qu’il en soit, un véritable chef d’œuvre (et, pour moi, une belle découverte), magnifiquement écrit par un écrivain dont on peut affirmer qu’il est de grand talent.
— Jean Molla, Sodibor, Belin – Gallimard, 224 pages.
_________
À lire aussi :
- Un été littérature – 1) Grands classiques de la Littérature
- Un été littérature – 2) Littérature épistolaire
- Un été littérature – 3) Théâtre classique
- Un été littérature – 4) Théâtre moderne
- Un été littérature – 5) Théâtre moderne très récent
- Un été littérature – 6) L’univers des contes
- Un été littérature – 7) Littérature maritime
- Un été littérature – 8) Littérature témoignage
- Un été littérature – 9) Littérature sur les mots
- Un été littérature – 10) Littérature à suspense
- Un été littérature – 11) Littérature fantastique
- Un été littérature – 12) Littérature tragique ou tourmentée
- Un été littérature – 13) Huis-clos
- Un été littérature – 14) Littérature sur le corps / l’apparence
- Un été littérature – 15) Nouvelles
- Un été littérature – 16) Romances
- Un été littérature – 17) Littérature étrangère
- Un été littérature – 18) Littérature pour ados
- Un été littérature – 19) Littérature à caractère historique
- Un été littérature – 20) Littérature bucolique



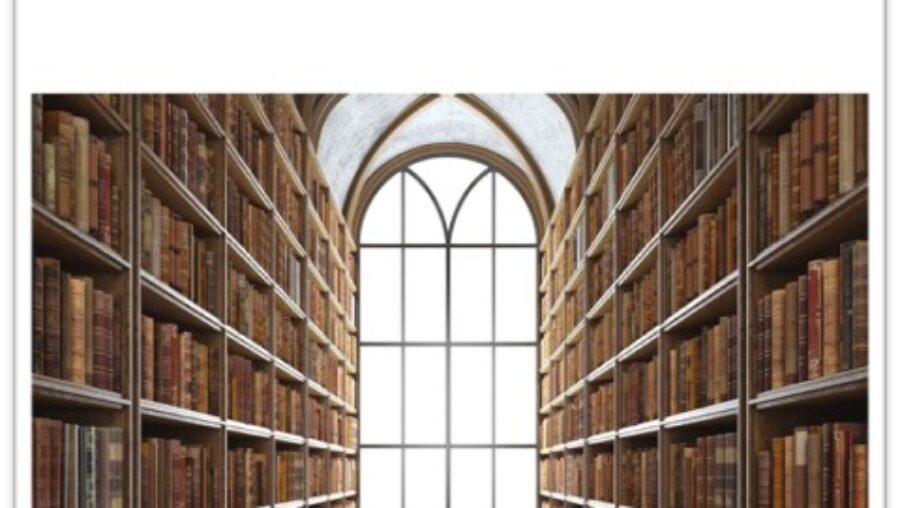

Laisser un commentaire
Créer un compte