Je ne suis pas un partisan de la colonisation, au contraire : en tant que libéral, je m’y serais opposé au XIXe siècle. Mais nous sommes au XXIe siècle, la colonisation a eu lieu, et elle appartient à l’histoire. Le problème est que cette histoire est pour l’instant totalement fantasmée. L’objet de cet article est de rétablir certains faits historiques pour pouvoir raisonner aujourd’hui.
J’insisterai sur deux points essentiels particulièrement oubliés de l’époque coloniale : la suppression de l’esclavage et la paix civile, avant de rappeler que « le pillage économique » de l’Afrique par la France est une légende.
Je m’adresse plus particulièrement à mes amis subsahariens, victimes d’une vision historique biaisée par leurs responsables politiques, qui s’en servent pour masquer les vrais problèmes d’aujourd’hui.
Je précise que si j’évoque parfois l’Afrique anglophone, mes exemples s’appliquent surtout à l’ancienne « Union française », et non, notamment, à la République démocratique du Congo.
Une histoire paralysée par l’idéologie « décoloniale »
Personnellement, je m’efforce de recueillir les témoignages des personnes encore vivantes ayant vécu la colonisation et la période néo coloniale qui a suivi, qualifiée aujourd’hui de « fausse indépendance » .
Hélas, ils n’ont que rarement laissé des traces écrites sur leur analyse de la situation coloniale, et les rapports qu’ils ont fait à l’administration française sont purement techniques, c’est-à-dire limités à leur action en matière sanitaire ou agricole par exemple.
D’où le portrait suivant : le « colon » français type en Afrique subsaharienne était un fonctionnaire colonial, civil ou militaire. Il est souvent seul dans « le bled » ou avec une poignée de « tirailleurs » africains s’il est militaire. Il est donc à la merci des populations locales, et il n’aurait pas manqué d’être tué s’il avait rencontré l’hostilité de la population, comme le prétend aujourd’hui la légende.
Et s’il était accepté, c’est bien parce que son action apportait un plus aux locaux : la fin de l’esclavage et la paix civile, l’arbitrage des litiges, et surtout une expertise technique, notamment dans le domaine sanitaire ou agricole.
Mais quand je rappelle ces faits historiques, je me heurte au politiquement correct d’aujourd’hui, qui diabolise ces fonctionnaires.
Même dans les milieux politiques de droite, tout article sur l’Afrique subsaharienne se doit aujourd’hui d’évoquer « l’horreur coloniale » et d’exprimer « un repentir » et « des excuses » sur l’action des Français à cette époque. Sans cette précaution, l’article sera tout bonnement censuré, y compris dans la presse orientée à droite.
Tandis qu’à gauche, cette horreur coloniale est de plus en plus revendiquée comme incontestable, au mépris total de l’histoire !
Dans ce qui suit, je vais parler de l’Afrique subsaharienne anciennement française, l’actualité étant focalisée sur le Sahel où le sentiment antifrançais se développe, au moins dans certaines sphères gouvernementales locales.
Cela crée une mode intellectuelle suffisamment puissante pour que tout le monde se sente obligé de la suivre.
Un bref rappel de l’histoire de cette colonisation
La colonisation de l’Afrique subsaharienne et d’une une grande partie de l’Afrique par les Anglais et les Français, a commencé dans les années 1880 : elle n’aura donc duré que trois quarts de siècle.
Pendant ce temps, à l’autre bout de la planète, d’autres colonisateurs se sont répartis certains territoires : Taïwan et la Corée deviennent des colonies japonaises, tandis que sont officialisés des quartiers ou des bases japonaises, russes et européennes en Chine, pays trop peuplé pour être véritablement colonisé.
À l’époque, les Anglais, et dans une moindre mesure les Français, les Hollandais et les Espagnols sont alors installés en bien d’autres endroits de la planète.
Il s’agit de la deuxième vague de la colonisation européenne, à laquelle s’est joint le Japon, la première ayant commencé à la Renaissance et ayant amené notamment au peuplement des Amériques par les Français et les Anglais au Nord, les Espagnols et Portugais au Sud.
Parallèlement avait lieu la colonisation d’une partie de l’Asie par les Portugais, bientôt remplacés par les Anglais et les Hollandais, avec quelques miettes pour les Français.
La colonisation de cette partie de l’Afrique par les Français n’est donc qu’un épisode d’un mouvement très général ayant des causes profondes que je n’aborderai pas ici.
Je rappelle qu’elle ne faisait pas l’unanimité en France, et que notamment les libéraux s’y opposaient.
Néanmoins la géopolitique l’emporta.
En effet, la France était alors traumatisée par la défaite de la guerre de 1870, avec la perte de l’Alsace-Lorraine et la conscience de la puissance de l’Empire allemand.
Il y avait aussi la vieille rivalité avec l’Angleterre, que la mise en place de la colonisation va finir par calmer en 1898, du fait de la nécessité d’une entente franco-anglaise face à l’Allemagne, alliance concrétisée en 1904.
Donc, la priorité stratégique de la France était d’empêcher les Allemands de s’implanter outre-mer. Il fallait donc arriver avant eux, ainsi qu’avant les Anglais, du moins jusqu’en 1898.
Ainsi, contrairement à ce dont beaucoup d’Africains sont persuadés aujourd’hui, il n’y avait pas de motif économique à la colonisation française.
D’ailleurs, les Français sont un peuple d’administrateurs et non de commerçants, contrairement aux Anglais ou aux Hollandais. Je mentionnerai notamment le rôle déterminant de Cecil John Rhodes, grand homme d’affaires anglais et homme politique, qui inspira et parfois pilota la colonisation britannique en Afrique. Alors que, côté français, les principaux personnages sont des militaires connus pour leur attention aux populations locales, tels Lyautey ou Faidherbe.
D’ailleurs, l’Afrique a coûté cher au trésor français, seules certaines entreprises privées y ont prospéré… et bien d’autres ont coulé.
Je vais maintenant insister sur un point pour lequel la confusion est grande : la colonisation, ce n’est pas l’esclavage, mais au contraire sa suppression.
La colonisation de l’Afrique subsaharienne a supprimé l’esclavage
L’esclavage a été supprimé par les deux principales puissances coloniales, la France et l’Angleterre AVANT la colonisation, en 1807 et 1838 pour l’Angleterre (respectivement fin de traite et libération des esclaves) et en 1848 pour la France, après une première suppression à l’occasion de la Révolution française.
Or, la colonisation de l’Afrique subsaharienne date des années 1880, et la première préoccupation des nouvelles autorités de l’Afrique subsaharienne a été d’interdire aussi bien l’esclavage local que la traite arabe.
En effet, il y avait depuis toujours un esclavage local. La traite occidentale, abolie donc depuis la première moitié du XIXe siècle, n’avait fait qu’utiliser, et bien sûr développer, ce marché de la traite locale.
Un témoignage parmi de multiples autres est celui d’Ernest Kakou Tigori dont des ancêtres ont été esclaves d’une tribu voisine.
Par ailleurs et surtout, le Sahel et l’Afrique orientale étaient ravagés par la traite arabe. Cette traite avait commencé aussi loin que l’on peut remonter dans l’histoire arabe, et donc bien avant l’arrivée des Européens.
Au moment de la colonisation européenne, avec leurs fusils modernes, les Arabes raflaient des villages entiers, et certaines régions étaient largement dépeuplées.
Ce sont les armées françaises et anglaises qui arrêtèrent ces razzias.
Bref, la confusion entre colonisation et esclavage empoisonne à tort le débat. En Afrique subsaharienne anciennement française, ainsi que dans de nombreuses colonies anglaises, on semble avoir oublié que c’est la colonisation qui a supprimé l’esclavage.
C’est bien sûr un point positif, mais le mot « positif » semble interdit quand on parle aujourd’hui de la période coloniale.
La colonisation a apporté la paix
Je ne vais pas me lancer dans l’analyse de l’époque coloniale, il faudrait des volumes pour cela. Et surtout il faudrait la situer par rapport à « l’avant » et « l’après », ce qui est malheureusement tabou aujourd’hui.
Un point seulement, mais fondamental : une paix civile meilleure qu’avant et qu’après.
Avant ?
En simplifiant, on peut dire que cette partie de l’Afrique était meurtrie par des violences tribales ou avec les voisins arabes du Nord. Certaines de ces violences sont « éternelles » et on les retrouve ailleurs qu’en Afrique : rivalité entre nomades (souvent des Peuls) et sédentaires, recherche d’esclaves dans les tribus voisines ou par des Maghrébins, contrôle de certaines voies commerciales…
Après ?
Ouvrez vos journaux : les massacres ne manquent pas. On retrouve l’opposition sédentaires–nomades (par exemple Peuls ralliés aux islamistes ou soupçonnés de l’être). Par contre, la chasse aux esclaves a en principe disparu, quoique dans certaines régions sous contrôle islamiste ou fermées aux journalistes étrangers, je ne serais pas étonné que l’esclavage subsiste sous certaines formes…
Mais de nouvelles violences sont apparues, avec de nouvelles raisons. On peut citer la mainmise de certaines ethnies sur le pouvoir central, entraînant des réactions d’opposition et donc de répression, ou des guerres tribales au sens traditionnel du terme.
L’apparition d’un sentiment national (voir les passions pour les équipes nationales de football dans les compétitions internationales) nourrit de nouvelles rancunes, par exemple dans le nord du Mali, dont les habitants Touaregs ne se sentent pas Maliens, ce qui est incompris à Bamako.
Il y a aussi et surtout les violences liées à la découverte de nouvelles « richesses » (je préfère parler de malédiction s’agissant du pétrole et d’autres minerais) : prise de contrôle des sites de production ou du trafic en aval… le groupe russe Africakorps (ex Wagner) n’est pas le seul acteur dans ce domaine !
Bref, l’avant et l’après colonisation font ressortir par contraste la paix civile qui régnait alors, au bénéfice de la très grande majorité de la population. On peut faire un parallèle avec la pax romana qui a permis le développement économique de l’Empire romain, notamment dans sa partie africaine.
Après les indépendances, beaucoup de ces fonctionnaires coloniaux sont restés comme coopérants : c’est la période dite « néo coloniale », qui dans la plupart des pays, a été une période de calme et de relative prospérité, contrairement à la connotation négative qu’à ce terme aujourd’hui : taxée de « fausse indépendance » à déblayer par une « révolution ».
Ces « révolutions » déclenchent en général un appauvrissement profond.
J’ai pu observer de près celle de Madagascar, plus ou moins inspirée de l’expérience chinoise et nord-coréenne, qui a entraîné l’écroulement du pays avec le départ d’une grande partie des Français, mais aussi de l’élite malgache. J’ai noté les souvenirs de participants enthousiastes au début, catastrophés ensuite par les résultats.
La Côte d’Ivoire, le Burkina, le Bénin, le Mali… ont aussi perdu au moins des années de développement, sans parler de la Guinée qui a fait cette révolution dès l’indépendance, avec l’écroulement et les répressions que l’on sait.
Le contraste avec l’Angleterre
Par contre, une erreur de la colonisation française est d’avoir envoyé comme fonctionnaires des techniciens, certes dévoués aux populations locales, mais qui avaient une vue « administrative » du développement, alors que ce dernier doit se faire de préférence par le secteur privé.
Cette vue « administrative » était celle de la plupart des élites françaises et elle perdure encore aujourd’hui. Cela s’est traduit par la mise en place d’une administration avec les défauts français, notamment l’idée que c’est l’administration, et non le secteur privé, qui est à la source du progrès économique.
De leur côté, les Anglais ont colonisé, bien sûr pour des raisons géopolitiques, mais surtout pour y développer le business de leurs entreprises. Le cas emblématique est celui de Cecil John Rhodes, magnat notamment des diamants, puis homme politique inspirant la colonisation britannique.
C’était une vue plus terre à terre que celle des Français, mais qui a été plus efficace dans un premier temps.
Soixante ans après, cette différence s’est atténuée, et ce qui distingue aujourd’hui les divers pays anciennement colonisés, c’est la qualité de leur gouvernance.
L’Afrique francophone se développe maintenant mieux que l’Afrique anglophone. C’est une illustration de plus que les conséquences de la colonisation sont maintenant très lointaines.
La Françafrique
Parlons maintenant de la Françafrique si décriée.
En fait, il s’agit d’une appréciation politique et non économique qui évoque « la consanguinité » entre élites africaines et élites françaises (dont les services spéciaux), et dont le président Senghor est l’exemple le plus accompli.
Cette consanguinité vient tout simplement du fait que la plupart des responsables politiques de la période qui a suivi les indépendances avaient commencé leur carrière en France (et se sont souvent mariés à une Française), notamment comme représentants de leur pays alors seulement autonome.
C’est une combinaison de l’impatience des jeunes de remplacer les Français et les élites d’alors, et l’influence de l’URSS (aujourd’hui relayée par la Russie…) qui explique la fin de la période néocoloniale… Et une bonne partie du sous-développement actuel !
Parmi ce qui est reproché à la colonisation et à la période néocoloniale, il y a le franc CFA et la langue française.
Le franc CFA
Supprimer le franc CFA est une très ancienne revendication africaine basée sur un fantasme total : leur politique économique serait « entre les mains de la France » et cette dernière « les exploiterait ».
Pourtant, les hommes politiques au pouvoir se gardent bien de matérialiser cette revendication. En effet, la « souveraineté monétaire » se concrétise par une difficulté de gestion considérable, comme en témoignent les autres monnaies africaines, et notamment celles du Ghana et du Nigéria, deux voisins importants, qui fluctuent et se dégradent rapidement.
L’exemple de la France, qui n’a plus de monnaie et utilise l’euro comme l’Afrique (le franc CFA est une fraction d’euro) montre qu’on peut parfaitement se passer de souveraineté dans ce domaine !
Un mot sur la francophonie
La langue française est souvent dénoncée comme coloniale, mais là aussi on est pour l’instant au stade des simples proclamations.
En fait, il y a deux cas :
- Les États ayant des dizaines, voire des centaines de langues, comme la Côte d’Ivoire ou le Cameroun, trouvent pratique d’avoir le français comme langue commune. Lorsque plusieurs générations ont été scolarisées en français, et que celui-ci est est utilisé dans la rue, il devient une langue familiale puis maternelle.
- Par contre, les États où dominent une langue comme le wolof au Sénégal ou le bambara au Mali, sont plutôt sensibles au fait que faire passer une langue locale au statut de langue officielle demande énormément de travail, non seulement pour adapter l’enseignement, mais aussi et surtout pour la mise à disposition en langue locale de l’immense corpus du français (et de quelques autres langues).
On peut ajouter qu’avec l’importance que prennent maintenant les entreprises, la francophonie économique prend un nouveau départ. Et pas seulement du fait des entreprises françaises, mais aussi québécoises ou marocaines, de plus en plus présentes au sud du Sahara.
En conclusion
Ce qu’on peut mettre sur le dos de la colonisation, c’est une gestion plus administrative qu’économique illustrant l’ignorance des élites françaises des mécanismes du développement.
Mais cette ignorance était pire avant, et c’est encore plus manifeste aujourd’hui : dans certains pays, les élites au pouvoir sont surtout préoccupées de mettre la main sur la caisse des ressources minières ou énergétiques.
Le résultat de leurs turpitudes, et accessoirement de leur ignorance, nourrit la ritournelle de « c’est la faute de la colonisation ».
On pourrait dire que la colonisation ne mérite ni cet excès d’honneur, qu’elle a eu au XIXe siècle et au début XXe, ni cette indignité : ce fut un mélange d’idéalisme civilisationnel et d’impérialisme froid au début, et une organisation du développement ensuite.
Aujourd’hui, la colonisation est taxée d’horreur coloniale.
On la désigne comme étant à l’origine de tous les maux, et c’est une catastrophe pour les Africains, à qui cela cache les vrais problèmes, ceux d’aujourd’hui, qui n’ont plus rien à voir avec la colonisation qui s’est achevée il y a près de 70 ans !



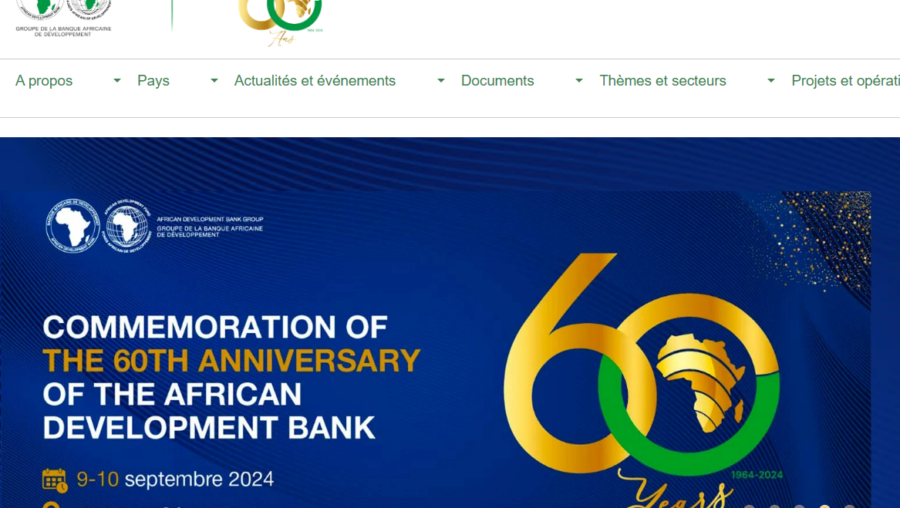

Très intéressant, merci. Les mêmes remarques s’appliquent au nord du Sahara. L’état pitoyable de l’Algérie en est l’exemple le plus flagrant.
L’auteur ne parle que des pays qu’il a connus par lui même ou par des “VOIX autorisées”. C’est une attitude empreinte de sagesse. Probablement n’a-t-il pas suffisamment connu les pays du nord du Sahara. Mais votre remarque est tout à fait pertinente. J’y adhère totalement. Il y a des vérités qu’il faudrait asséner à tous à l’école et dans les médias publics (à condition qu’ils aient été préalablement remis au propre idéologiquement parlant). Je dit bien “asséner” comme l’ont fait, de leur côté, les déconstructivistes de tout poil pendant une cinquantaine de décennies.
Merci pour ces rappels. Très justes.
J’ajoute deux remarques.
1. Il y a une dimension psychologique dans la décolonisation. La dette infinie créée par le don de la civilisation à ces peuples a fini par leur devenir insupportable. On finit toujours par s’éloigner de ceux à qui on doit tout.
2. Bien qu’on ne puisse parler de colonisation, la situation en Nlle-Calédonie peut apporter un éclairage supplémentaire. Lorsque les “nouveaux venus” ne parviennent/cherchent pas à créer une élite autochtone, une bourgeoisie locale, la greffe ne prend pas. Les autochtones, en même temps qu’ils découvrent un autre type de pouvoir (celui des affaires ou celui de l’administration, peu importe) comprennent aussi qu’ils en restent écartés. Qu’ils sont peuple et resteront peuple [Onfray : le peuple, ce sont les gens sur lequel le pouvoir s’exerce]. Cela aussi est insupportable.
Pour info : https://www.lalibre.be/debats/opinions/2023/02/07/pourquoi-le-congo-belge-etait-une-colonie-modele-E7ZSRE2QM5C3XPWSFZGQ7KBWPI/
L idée de colonialisme sert à des états corrompus a s affranchir de leur gabegie pour la rejetter sur un bouc emissaire, avec l appui des grands frères russo chinois
En occident elle permet à la gauche de se refaire une virginité a peu frais alors qu elle y a participé tres activement
Que de bien vielles tactiques politiciennes…….
Je suis d’ accord avec la plupart de ce qui est dit par l’ auteur: exception faite au rôle que les Portugais ont eu 500 ans plutôt que tous les autres peuples, notamment en Afrique !
J’ai en effet à peine parlé des Portugais qui ont commencé avant les autres, puis se sont fait souvent éliminer par d’autres Européens. Ils se sont souvent fondus dans la population locale et on trouve un peu partout des « indigènes » ayant un nom de famille portugais.
Et bien sûr, ils nous ont laissé le Brésil, mais l’article ne parle que de l’Afrique
bonjour, pour aller plus loin : https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/esclavage-et-racisme-arabo-musulmans-entre-histoire-et-prejuges,7349
“Se sont mariés à une française” ? En dehors de l’épiphénomène Senghor, c’est plutôt l’inverse que j’ai pu constater lors de mes années d’enfance ( 1955 _ 63 ) au Congo : les mâles blancs partaient souvent en célibataires, et rentraient avec des petits enfants “café au lait”, qu’ils décident de les ramener en France, éventuellement sans la mère si pas très “sortable”, ou de laisser la smala sur place (si une légitime les attendait en métropole) , moyennant compensation financière..