La Chine est-elle un monstre totalitaire prêt à conquérir le monde ? Ou bien ses politiques étrangères et intérieures sont-elles le résultat d’un intérêt personnel rationnel, comme celui de tout un chacun ? Un nouveau livre offre quelques espoirs pour éviter une confrontation entre les États-Unis et la Chine.
Les relations entre les États-Unis et la Chine peuvent-elles éviter le bord du gouffre ?
Article original de l’Acton institute.
Peu après son accession à la présidence, Donald Trump a invité son homologue chinois, Xi Jinping, à une visite festive à Mar-a-Lago, en Floride. Ce sommet semblait être le début d’une belle amitié. Cependant, trois ans plus tard, Donald Trump a fait de l’hostilité à la République populaire de Chine (RPC) et, plus particulièrement, au Parti communiste chinois (PCC), la pièce maîtresse de sa campagne de réélection.
Aujourd’hui, Démocrates et Républicains ne s’accordent guère sur autre chose que la terrible menace que représente Pékin. En réponse, ils adoptent avidement les politiques chinoises, notamment le protectionnisme, la politique industrielle, les contrôles technologiques et les interdictions en ligne. Les responsables politiques américains parlent régulièrement de contenir la RPC et de se préparer à une nouvelle guerre froide. Et la lutte pourrait s’intensifier. Le point d’ignition international le plus important pourrait être Taïwan.
Pourtant, les sinologues s’affrontent sur la signification des dernières proclamations politiques d’une civilisation vieille de plusieurs milliers d’années. Quelles sont les ambitions de Xi, du PCC et de l’État chinois ? Quel est le degré de dangerosité de la RPC ? Les universitaires américains sont beaucoup moins sûrs que les hommes politiques.
C’est dans ce contexte que s’inscrivent l’économiste Ryan M. Yonk et le juriste prospectif Ethan Yang, avec leur nouvel ouvrage intitulé The China Dilemma : Rethinking US-China Relations Through Public Choice Theory (Le dilemme de la Chine : repenser les relations entre les États-Unis et la Chine grâce à la théorie du choix public).
Alors que Washington affronte la Chine dans les domaines du commerce, de la technologie, de la finance, de la diplomatie et de la géopolitique, les auteurs craignent qu’« il semble y avoir une incompréhension bipartisane des motivations qui sous-tendent les politiques chinoises. » La plupart des gens traitent la RPC et les autres pays comme des « acteurs singuliers », mais « les relations internationales ne nous apprennent pas grand-chose sur ce qui motive les dirigeants politiques à prendre position et sur le rôle que jouent les événements intérieurs en Chine. »
Il s’agit là d’un point de vue important. Yonk et Yang reconnaissent que la culture, l’idéologie et la stratégie affectent le comportement national. Toutefois, ces facteurs « ne permettent pas d’expliquer les politiques individuelles ». Pour cela, insistent-ils, il faut se tourner vers « l’économie et l’intérêt personnel rationnel », qui s’appliquent à la gouvernance chinoise tout autant qu’à la gouvernance américaine. En effet, les auteurs estiment que « le fait de considérer le comportement politique chinois sous l’angle des choix publics peut considérablement enrichir le débat en cours sur les relations sino-américaines et les affaires intérieures chinoises. »
À proprement parler, cette approche est politiquement neutre. Toutefois, le fait de se concentrer sur les incitations intérieures de la RPC plutôt que sur les objectifs étrangers diminue probablement la menace à laquelle l’Amérique est confrontée. Néanmoins, Yonk et Yang espèrent que leur analyse fournira « une conversation plus sobre et plus complète sur la Chine ».
L’économie des choix publics a valu à James Buchanan le prix Nobel d’économie en 1986. À la base, elle enseigne que les acteurs publics, comme leurs homologues privés, répondent à des incitations économiques. Yonk et Yang affirment « que la compréhension des incitations en jeu à l’intérieur d’un pays peut grandement aider à comprendre comment il agit sur la scène internationale. »
Par exemple, les auteurs évaluent les antécédents des principaux dirigeants de la RPC et affirment que « les individus les plus puissants du PCC agissent de manière rationnelle et dans leur propre intérêt ». Il en va de même aujourd’hui, où « les développements politiques sont étroitement conçus pour réaffirmer le pouvoir de l’État et utiliser la force politique brute pour obtenir les résultats souhaités dans l’économie ». Les défis que la Chine lance à l’Occident ne se limitent pas à « la mise en œuvre d’un grand projet visant à soutenir le socialisme à la chinoise et à saper les valeurs occidentales ». En évaluant les intérêts servis, on peut à la fois prédire la direction prise par le Parti et « élaborer des politiques plus efficaces pour affronter la Chine ».
Les auteurs font une analyse similaire concernant le pouvoir croissant de Xi.
Même aujourd’hui, il existe des preuves de l’opposition à ses politiques. Si tel est le cas, écrivent Yonk et Yang, « le fait que Xi ait pu convaincre des responsables au plus haut niveau de le soutenir démontre non seulement qu’il dispose d’un capital politique considérable, mais suggère également que l’époque pourrait nécessiter une telle action ».
En d’autres termes, son autorité repose au moins en partie sur le consentement d’autres personnes qui souhaitent qu’il réaffirme le contrôle du parti et assure la stabilité du leadership.
En ce qui concerne la politique étrangère, les auteurs estiment que :
« La Chine n’agit pas comme une entité unique et maléfique sur l’échiquier mondial. Comme tous les pays, elle est dirigée par des individus rationnels et intéressés qui prennent leurs décisions dans le contexte structurel qu’ils occupent. »
Ainsi, « les actions du gouvernement chinois sont logiquement axées sur les préoccupations intérieures d’abord, et sur les affaires étrangères ensuite ».
Bien entendu, les États-Unis et d’autres États amis peuvent toujours ne pas apprécier les résultats politiques qui en découlent. Toutefois, le contexte national dans lequel s’inscrivent les politiques de la RPC est probablement très différent de celui de l’Occident.
Par exemple, Yonk et Yang affirment que la Chine « ne peut être comprise à travers le prisme de l’ordre mondial libéral », que « les dirigeants chinois ne sont pas un monolithe » et que « les citoyens chinois sont généralement satisfaits du PCC ».
Ces facteurs, selon eux, affectent la perception de la menace, de l’autorité et de la légitimité. Cela ne justifie pas les politiques chinoises odieuses passées et présentes, affirment Yonk et Yang, mais « il est essentiel de considérer comment le PCC évalue les coûts et les avantages alors que le régime tente activement de construire un argumentaire de longue date pour justifier son droit à gouverner toute la Chine ».
En effet, les causes intérieures sont susceptibles de déboucher sur des objectifs étrangers moins ambitieux que la « conquête du monde » ou autre. Les responsables chinois souhaitent probablement que leur pays occupe une position similaire à celle de l’Amérique dans le monde, en se fondant sur l’intérêt et non sur l’idéologie.
Yonk et Yang expliquent :
« Si, ou quand, la Chine acquiert la puissance militaire nécessaire pour imposer ses propres intérêts à l’étranger, ce ne sera pas parce que le politburo a conçu un grand projet de conquête du monde. Ce sera plutôt parce que la Chine ressent le besoin de protéger les routes commerciales ».
Même si des controverses comme celle de Taïwan resteront difficiles à désamorcer, il est nécessaire de se concentrer sur l’intérêt autant que sur l’idéologie. En définitive, insistent les auteurs, « la stratégie géopolitique de la Chine suit un modèle rationnel, opportuniste et pragmatique ».
Il est évident qu’il ne faut pas se contenter de traiter avec un État autoritaire aussi puissant. Mao Zedong a fait preuve de pragmatisme en se tournant vers les États-Unis pour faire contrepoids à l’Union soviétique. La Chine de l’après-Mao a accueilli favorablement l’engagement de l’Occident en dépit des conséquences perturbatrices. Pourtant, l’idéologie a également poussé Mao à mener des politiques extrêmement destructrices, telles que le Grand Bond en avant. Xi Jinping semble encore plus pragmatique que Mao, rejetant tout ce qui pourrait ressembler au chaos catastrophique de la révolution culturelle, tout en dissimulant ses actions sous une rhétorique communiste.
Pourtant, Yonk et Yang concluent :
« L’objectif de l’une ou l’autre des parties n’est pas principalement la domination du monde, mais une bataille pour l’influence ».
Dans ce cas, les Américains peuvent se détendre un peu. La concurrence stratégique est inévitable, mais elle peut être gérée. « Ce qu’il faut retenir de ce livre, c’est que les dirigeants chinois réagissent aux incitations et ont des priorités rationnelles ».
Les relations entre les États-Unis et la Chine resteront compliquées, souvent tortueuses et parfois dangereuses. Mais l’utilisation des connaissances de l’économie des choix publics pourrait contribuer à maintenir des relations généralement stables et pacifiques. Et c’est peut-être le mieux que nous puissions espérer dans les jours à venir.


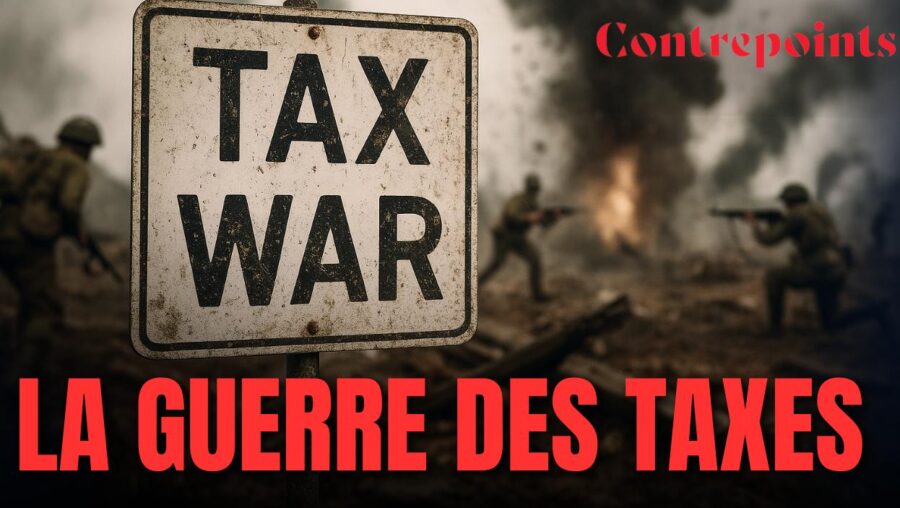


Cet article ne m’a pas beaucoup éclairé. Que Xi et Poutine pensent agir dans leur intérêt personnel, d’accord, mais on s’en doutait. Mais qu’est-ce que leur intérêt personnel, à part rester au pouvoir ? Quelle est l’articulation entre cette intérêt et Taïwan ou l’Ukraine ? Ca peut jouer dans les deux sens.