Par Chloé
Un article de Trop Libre
« La paix va nous rendre l’espérance, la foi en l’avenir et la possibilité d’une vie meilleure pour nous et nos enfants », disait Juan Manuel Santos, le président de la République de Colombie lors de la ratification, le 26 septembre 2016, d’un accord de paix historique signé après 4 ans de pourparlers entre le gouvernement de Colombie et la guérilla des FARCS, mettant fin à 52 ans de conflit armé.
Qui sont les FARCS ?
Les Forces Armées Révolutionnaires de Colombie (FARCS) représentaient la principale guérilla du pays. Nées des révoltes paysannes des années 1930, elles ont été véritablement fondées en 1964. De tendance guévaristes, elles luttaient pour défendre les intérêts du peuple contre les riches propriétaires terriens.
La guérilla marxiste a toujours tenté de prendre le pouvoir par les armes et la violence en Colombie, puisant ses ressources du trafic de cocaïne qu’elle organisait. À partir de 1990, le combat s’intensifie : enlèvements fréquents, rançons élevées, assassinats courants…
Les FARCS sèment la terreur dans toute la Colombie. En 2001, Alvaro Uribe, alors président de la République lance donc une véritable chasse aux sorcières et décide de répondre en utilisant les mêmes moyens pour les vaincre : la lutte armée.
Un accord de paix qui fait débat
Après 4 ans de pourparlers menés à la Havane par Raul Castro, les FARCS ont enfin accepté de déposer les armes. Mais l’accord de paix ratifié par l’actuel président Juan Manuel Santos est loin de faire l’unanimité en Colombie.
Effectivement, si l’accord prévoit la reddition totale des FARCS ainsi que leur désarmement, il leur offre également la possibilité d’être élu tant au Sénat qu’à l’Assemblée Nationale, et ce dès les élections législatives de 2018.
Grâce à l’accord négocié par Santos en 2012, deux ans après son arrivée au pouvoir, l’organisation paramilitaire bénéficiait en outre d’une amnistie : les guérilleros qui se soumettaient à la justice échappaient ainsi à la prison et écopaient de peines allégées. Pour de nombreux Colombiens, cette mesure a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.
De nombreuses voix se sont élevées lors d’un référendum mené en octobre dernier pour dénoncer un accord niant les souffrances endurées par les milliers de victimes, et oubliant les 60 000 disparus et les 260 000 morts.
Jugé trop laxiste, cet accord était considéré comme « insupportable » compte tenu de l’hostilité que voue une importante partie de la population aux FARCS. Devant l’ampleur que prenait l’affaire, le président Santos a dû accepter de retoquer son accord.
Prix Nobel de la paix pour Juan Manuel Santos
Néanmoins, malgré une ratification houleuse, Santos a reçu le 10 décembre 2016 le Prix Nobel de la paix, pour l’investissement et les efforts qu’il a mis dans la conquête de la paix en Colombie.
Pour le Comité Nobel, le président représente un rempart solide contre l’enlisement du processus de négociation. La paix n’est pourtant pas complète : il reste sur le territoire andin une autre guérilla moins connue mais tout aussi active qui refuse pour l’instant de s’avouer vaincue.
L’ELN, même objectif, résultats différents
Depuis 3 ans déjà à Quito, se tiennent des négociations entre l’Armée de libération nationale (ELN) et Bogotá. Cette guérilla regroupe encore 1500 hommes environ et semble être indéboulonnable.
Les cinq derniers présidents colombiens ont tous essayé de négocier avec elle, sans succès. Après avoir conclu un accord avec les FARCS, le président va tout tenter pour faire de même avec l’ELN. Il resterait dans les annales du pays comme celui qui a su mettre un terme à plus d’un demi-siècle de violence.
Les négociations s’avèrent cependant plus difficiles : il faut s’attendre à ce que l’ELN tente d’obtenir davantage que les FARCS et joue sur la fin du mandat de Santos, en 2018. Le temps sera donc le meilleur ennemi du président nobélisé.
Paix impossible ?
D’aucuns en Colombie se demandent si leur pays connaîtra jamais la paix. C’est le cas du ministre de la Défense et de la sécurité civile, Rafael Pardo, qui met le gouvernement en garde et l’invite à ne pas se réjouir trop vite.
Tant que la feuille de coca sera produite et vendue, le trafic de cocaïne existera. Il faut, selon lui, que l’État aide les paysans à se tourner vers une autre production à cultiver. Avec la production de coca, il existera toujours un risque de voir éclater une guérilla en Colombie.
La paix ne tient donc qu’à un fil.
—
Sur le web



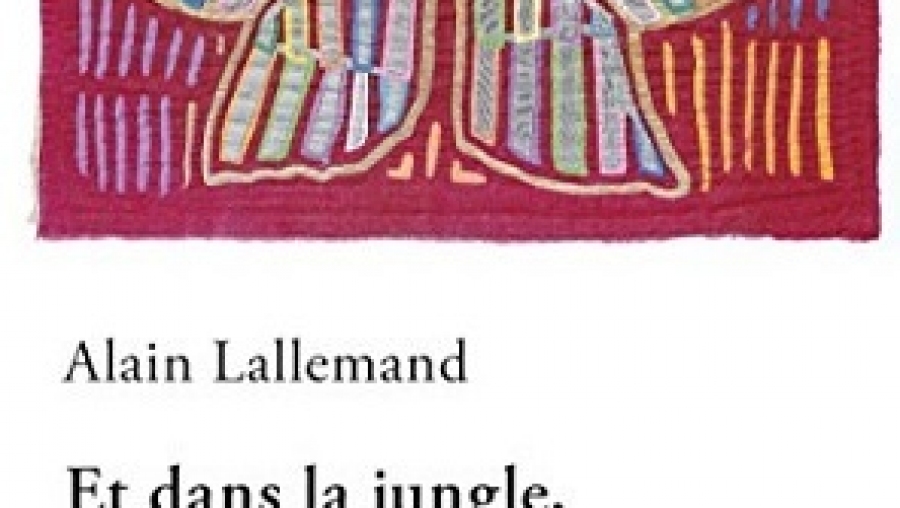
Exact car ces guérillas ne sont en fait qu’un prétexte pour trafiquer de la cocaïne!
Historiquement ces guerillas ne se sont pas formées pour s’enrichir dans le trafic de drogues.
Cependant, c’est en ayant rendu la drogue illégale que ces organisations s’enrichissent et ont le pouvoir qui leur permet de tenir tête à la justice et de s’en sortir impunément. Avec l’argent du trafic ces guérillas ainsi que les autres organisations mafieuses se procurent les armes qui créent toutes cette violence et leur permet également de corrompre les agents de l’état à tous les niveaux (policiers, juristes, politiciens).
Malheureusement, au nom d’une morale soi-disant supérieure qui sait ce qui est bon pour vous, les États combattent (en gaspillant des milliards) la contre-bande en créant encore davantage de violence dans une lutte qu’ils ne peuvent pas remporter. La demande pour ces substances ne diminue pas. Rendre tout marché souterrain ne fait qu’augmenter les marges des producteurs, car la compétition est plus faible.
Pour tout Colombien, voir des criminels se soustraire à la justice est insupportable, on peut dire que l’État a failli à ses missions régaliennes.
Mais personne pour penser à une solutions libérale, où celui qui s’enrichit n’est pas celui qui est le plus violent. Continuons donc à pourchasser la drogue de manière hypocrite, on a bien vu où ca nous a mené…