Par Jean Sénié.
Un article de Trop Libre
 On attribue à André Malraux la prophétie selon laquelle « Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas ».
On attribue à André Malraux la prophétie selon laquelle « Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas ».
Peu importe la véracité de l’énoncé ou encore celle de l’attribution, cette proclamation insiste sur un fait qui nous frappe au quotidien, la permanence du fait religieux, voire dans le cas de l’Islam, son émergence. C’est justement à ce rapport entre modernité et religion que Philippe d’Iribarne a consacré ses derniers travaux. Son dernier livre traite des relations entre chrétiens et Modernes.
Partant de l’apparente inadéquation entre les deux, le chercheur défend la thèse, qui peut paraître initialement paradoxale, d’une complémentarité bénéfique entre les chrétiens et le projet moderne. Ce dernier s’enrichit de l’apport réflexif du christianisme, tout comme celui-là gagne à écouter les réquisits modernes dans ce qu’ils ont de meilleur. L’auteur y voit, d’ailleurs, la source d’un salutaire ressourcement pour les deux.
Identité chrétienne et identité moderne
L’auteur mène un double travail dans cet ouvrage.
D’une part, il entend montrer, sinon les apories, du moins les problèmes que soulèvent chacune des deux conceptions du monde, livrées à elles-mêmes.
D’autre part, il argumente en disant que celles-ci, par un travail dialectique, s’aident mutuellement pour proposer une identité en quelque sorte épurée, qui répondrait davantage au moment historique que nous vivons.
Du côté du christianisme, l’auteur déplore tout autant que celui-ci fasse l’objet d’une dilution, se transformant en une morale altruiste, qu’il devienne l’étendard d’un repli identitaire. À travers une lecture personnelle du Nouveau Testament, l’auteur propose de rétablir ce qui constitue le caractère révolutionnaire du message chrétien, à savoir son attention aux faibles, aux pauvres, aux laissés-pour-compte. C’est le message d’amour et de charité que retient Philippe d’Iribarne. Cela s’opère au détriment de ce qu’il condamne comme une sclérose dogmatique. Il retrouve les élans post-vatican II d’une critique du magistère. Il appelle alors une « démarche de vérité » qui ferait primer le message évangélique et son trait essentiel, l’attention portée à l’autre.
Du côté du moderne, l’auteur se revendique du projet des Lumières et de « la sortie de l’homme hors de l’état de minorité où il se maintient par sa propre faute » comme l’énonce Kant dans son opuscule Réponse à la question : qu’est-ce que les Lumières ? Ce travail critique, vis-à-vis des institutions, des vérités dogmatiques, des discours préétablis constitue un acquis indépassable pour Philippe d’Iribarne.
En revanche, le projet moderne fait l’objet d’une double remise en cause.
D’une part, il s’est fondé sur l’idée d’un homme abstrait, universel, sans racine, alors qu’en réalité il reflétait la culture occidentale. Le culte d’un homme universel aurait ainsi caché l’enracinement culturel de cette vision.
D’autre part, cette vision repose sur une conception utopique voulant construire une société meilleure. De manière classique, le chercheur revient sur des textes de Rousseau, de Sieyès ou encore de Marx pour définir ce constructivisme social et la religion du progrès qu’il a entraînée.
Or, l’argument principal du livre est que ces deux identités qui, prises individuellement se trouvent dans une situation difficile, peuvent s’entraider pour surmonter les faillites de leur projets respectifs. La critique apportée par la modernité doit permettre de sortir le christianisme de son complexe obsidional et, notamment, de son repli derrière des certitudes dogmatiques.
Le christianisme doit rappeler que derrière l’Homme, il y a des hommes et que parmi ceux-ci tous ne trouvent pas leur place dans le projet conçu par la modernité.
Philippe d’Iribarne écrit ainsi de très belles pages sur la question que posent les trisomiques et sur le fait que « leur différence et leur humanité ne sont jamais appréhendées simultanément ». C’est cette double exigence qui, bien que le cheminement de l’un vers l’autre s’annonce douloureux, doit permettre de proposer une conception du monde plus apaisée pour les hommes d’aujourd’hui.
Le mélange des ordres
La réflexion de Philippe d’Iribarne s’inscrit à la suite d’œuvres qui étudient les rapports entre religion et modernité, à commencer par celle de Marcel Gauchet, de Pierre Manent, ou encore de Rémi Brague. Pourtant, la façon dont le chercheur pose le problème n’est pas sans soulever en retour des interrogations.
Tout d’abord, l’auteur expédie bien rapidement le rapport, complexe il est vrai, entre christianisme, droit naturel et libéralisme politique. À cet égard, on peut déplorer l’absence de référence aux travaux de Philippe Nemo et de Jacques Rollet, et notamment au libéralisme des valeurs que défend ce dernier.
De toute façon, l’ouvrage fait trop vite du christianisme un adversaire du libéralisme et de la mondialisation, en dépit des travaux et des réflexions qui abondent sur le sujet. Ainsi, le livre de Philippe d’Iribarne déçoit en ce qu’il laisse de côté ce dossier qui constitue tout de même une des questions cruciales du rapport entre christianisme et modernité. Il se focalise sur la question des libertés démocratiques, abordée d’ailleurs en suivant les travaux de Marcel Gauchet, au détriment des autres libertés.
Ensuite, le traitement de l’institution ecclésiale n’est pas sans poser problème. Bien que ce ne soit pas là son sujet, la proposition de revenir au message évangélique destiné à dépasser l’institution est une option ecclésiologique qui s’éloigne de la constitution dogmatique sur l’Église Lumen Gentium et des positions conciliaires.
On se demande toujours s’il n’y a pas dans de tels appels la volonté de promouvoir un christianisme light, de se concentrer sur une partie du message évangélique et, finalement, de le poser comme une des formes possibles de salut. C’est malheureusement oublier que le christianisme est porteur d’une vérité, à savoir son message de salut pour tous les hommes qui y croient.
Le livre soulève donc une question passionnante sur un sujet important. Si on le lit avec plaisir, on peut néanmoins regretter qu’il traite un peu trop vite des enjeux qu’il aborde, en dépit de leur complexité et de leur difficulté.
- Philippe D’Iribarne, Chrétien et moderne, juin 2016, 240 pages.
—

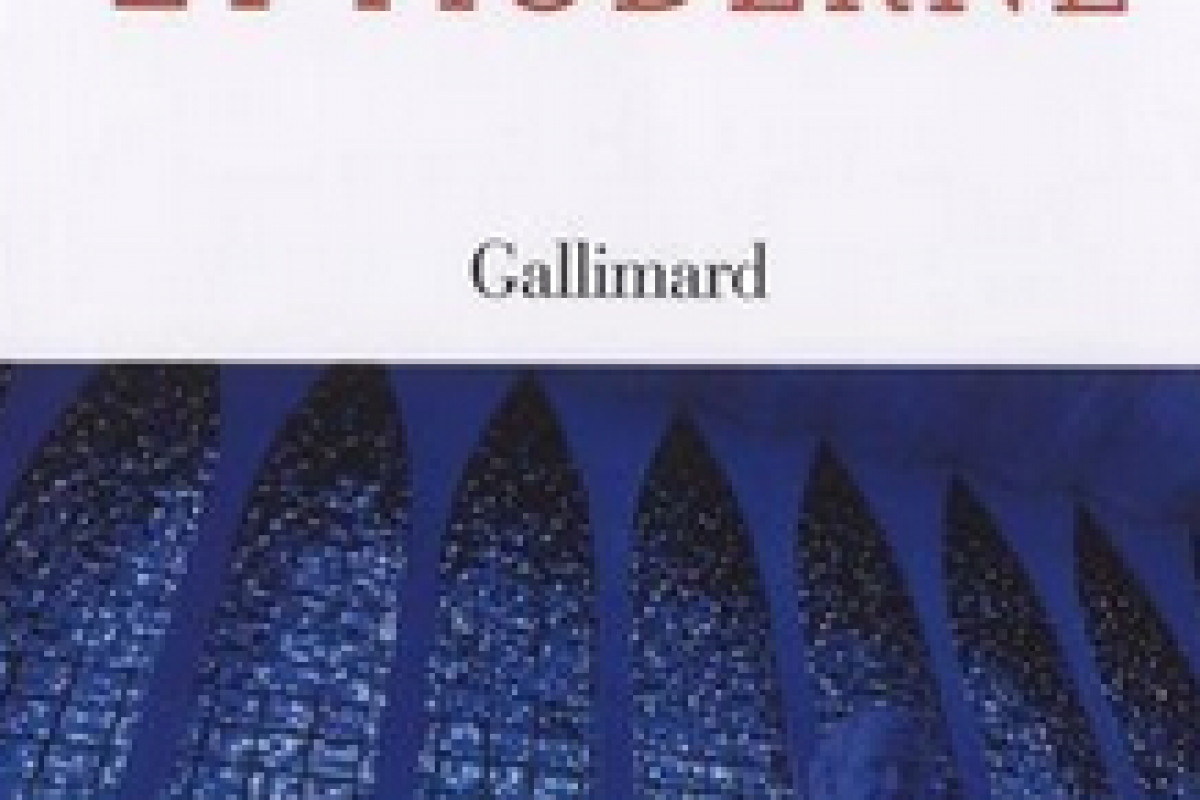
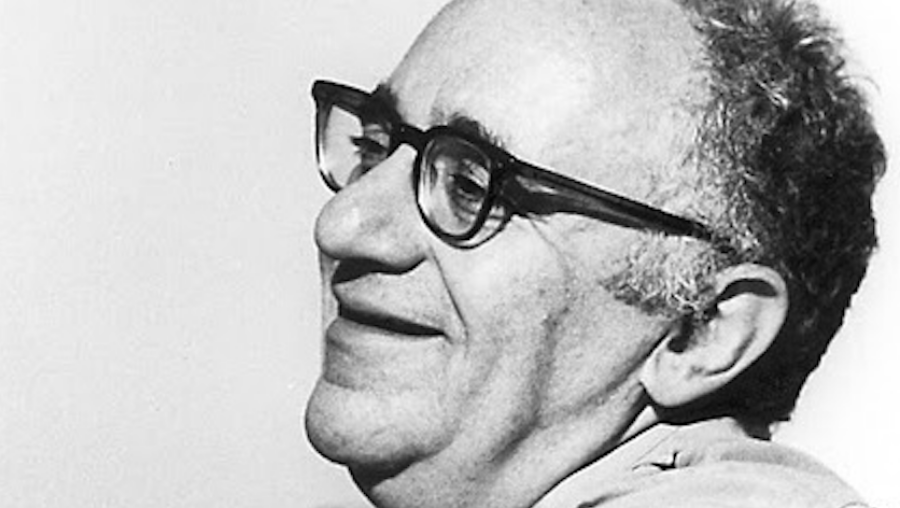


“le caractère révolutionnaire du message chrétien, à savoir son attention aux faibles, aux pauvres, aux laissés-pour-compte.”
Il est intéressant d’étudier la modification de la vision de la société chrétienne envers le pauvre. De moyen privilégié de se rapprocher du message du Christ du fait de l’attention que le privilégié devait avoir envers lui, le pauvre est devenu un agent du désordre dans la société. Ce tournant a eu lieu au 16eme siècle et c’est amplifié par la suite, la société toujours chrétienne catholique a fini par exclure et même criminaliser le pauvre, le vagabond.
Je précise que ce n’est pas le fait de la doctrine de l’église mais bien de tous les changements sociaux de l’époque, c’est toute la société en mouvement qui a rejeté le pauvre pas l’église.
Simplement on peut voir là comment une société qui se définissait d’abord comme chrétienne peut “oublier” le cœur de ce qui lui a donné sa spécificité. Cela doit se retrouver ailleurs, ne dit on pas que l’arbre pourri toujours par le cœur…