Par Eugène Aballo.
Un article de Libre Afrique
Investi Président de la République le 06 avril 2016, Patrice Talon a été élu au terme du second tour de la présidentielle du 20 mars 2016, avec environ 65% des suffrages exprimés. Depuis 1990 année où le Bénin s’est engagé sur la voie de la démocratie et de l’État de droit, c’est la quatrième alternance au sommet de l’État et la énième fois qu’une élection au Bénin est jugée crédible et transparente par la communauté nationale et internationale.
Aux origines du socle démocratique
Pour comprendre l’ancrage de la culture démocratique au Bénin, il faut jeter un regard vers le passé. Entre 1963 et 1972, la vie politique du Bénin a été rythmée par des coups d’État répétitifs qui avaient valu au pays le triste surnom d’Enfant malade de l’Afrique. Mais, lorsque le 26 octobre 1972, Mathieu Kérékou, alors commandant dans l’armée béninoise, prend la tête d’un gouvernement militaire révolutionnaire, il met un terme définitif à l’instabilité politique qui régnait et à la décevante expérience de la présidence tournante, le triumvirat instauré avec Hubert Maga, Justin Tométin Ahomadégbé et Sourou Migan Apithy.
Cependant, l’avènement du parti unique à tendance marxisante, le Parti de la Révolution Populaire du Bénin (PRPB) a conduit à deux décennies de déviance autocratique et totalitaire qui vont aboutir à un enlisement total du pays. Ainsi, la conjoncture de nombreux facteurs a entraîné des grèves généralisées dans tous les secteurs de la vie économique et sociale ainsi que le soulèvement du peuple opprimé, ce qui a conduit les forces vives de la nation à réclamer du gouvernement militaire une conférence dont les recommandations resteront souveraines : la Conférence de février 1990.
Émergence d’un régime politique de type nouveau
Cette dernière constitue à ce jour le socle de la démocratie béninoise, l’ancre du nouveau navire qui s’appelle le Bénin. En effet, ce fut cet événement qui marqua le début d’une nouvelle ère, celle du renouveau démocratique. À travers elle, le peuple béninois avait décidé de résolument se tourner vers la recherche d’un idéal politique pouvant lui permettre de s’engager sur la voie du développement. Petit à petit, elle s’est consolidée autour du multipartisme, la liberté d’expression et d’opinion, le respect de la trilogie de séparation des pouvoirs (législatif, judiciaire, exécutif). L’exercice du pouvoir démocratique au Bénin est encore relativement récent. Et si de nombreux Béninois voient à travers la dernière élection une volonté populaire et une pression manifeste et soutenue, de multiples facteurs ont concouru à cette réussite.
En effet, plusieurs dispositions de la loi N 2013-06 du 25 novembre 2013 portant Code électoral en République du Bénin ont favorisé la transparence, notamment, le déploiement d’observateurs et de brigades anti fraudes, le dépouillement public, et le transport sécurisé des documents électoraux. Les opérateurs de réseaux de téléphonie mobile ont assuré la continuité du service permettant ainsi une parfaite coordination des opérations et la diffusion instantanée des résultats de postes de votes via les réseaux sociaux. Le principal atout déterminant semble être le dialogue qui a été permanent. L’accompagnement des leaders d’opinion tels que la Conférence Épiscopale, les dignitaires des religions endogènes à rapprocher et concilier les positions dès que des situations susceptibles de conduire à l’impasse pointaient à l’horizon ont été salutaires.
Des exploits mais aussi des ratés
Le rôle de la société civile organisée en plate-forme plusieurs mois avant la période électorale a mis en œuvre un programme de sensibilisation de la population à préserver la paix, la cohésion sociale et l’unité nationale tout au long du processus. Les Organisations de la Société Civile ont en réalité encouragé et exhorté les populations des quartiers et des hameaux à s’intéresser au scrutin et à surveiller tout le processus afin que soit fidèlement transcrits dans les documents électoraux les résultats issus des urnes par poste de vote. Quant aux médias, ils ont été à la fois des lanceurs d’alertes et des éveilleurs de conscience grâce à l’encadrement de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication. La presse, y compris les médias de service public, dont le rôle est de donner la parole à tous, a tant bien que mal joué sa partition, en instaurant un débat d’idées, et ce en dépit des invectives. Ils ont été nombreux à boycotter des meetings de candidats tenant des discours incendiaires. De nombreux reportages ont permis d’appréhender des réseaux de distribution de cartes d’électeurs aux étrangers, des votes de mineurs.
Tout cela témoigne, s’il en est encore besoin, d’une maturité du peuple béninois dont les choix et les options semblent s’inscrire dans la consolidation de la démocratie. Néanmoins, la démocratie béninoise traîne beaucoup de tares dans son fonctionnement, et la réussite d’une élection ne constitue pas un gage de solidité de cette démocratie. L’incapacité de la classe politique à s’organiser autour d’idéaux et la transhumance politique restent à ce jour les principaux goulots d’étranglements qu’il faille déboucher pour permettre à la démocratie béninoise de porter la promesse des fleurs. En 25 ans de pratique démocratique, l’émiettement du champ politique, l’absence de règles claires régulant le comportement des élus dans les institutions de contre- pouvoir, l’absence de reddition des comptes et la corruption noircissent l’éclat de cette démocratie.
Un exemple à implémenter ?
Le Bénin pourrait servir de modèle ou de laboratoire pour l’Afrique noire francophone au regard des échecs que l’on connait actuellement au Congo, au Burundi, au Niger et au Tchad. Il faudrait toutefois maintenir la veille citoyenne et le contrôle de l’action publique. La consolidation et le renforcement de la démocratie passent par la maturité du peuple et la conscience qu’il a de l’impact de l’action politique sur sa vie quotidienne. Chaque peuple ayant son histoire et ses réalités, il sera utile de s’inspirer de l’expérience béninoise, dans ses principes généraux, mais chaque pays doit trouver son propre modèle.
—



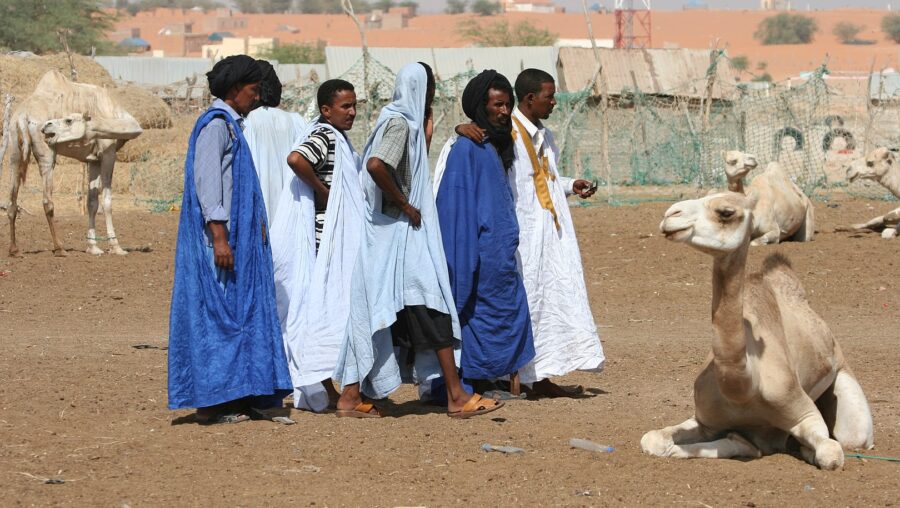


Laisser un commentaire
Créer un compte