Compagnon de route des Physiocrates dans leur lutte contre les règlements, les prohibitions et les préjugés anti-économiques, Paul Boësnier de l’Orme (1724-1793) a été un économiste utile, estimé en son siècle, mais très rapidement oublié. Il a souffert, paradoxalement, de n’être tout à la fois pas assez et trop physiocrate. Sans rejoindre les membres de l’école de Quesnay, il avait adopté la grande partie de leurs idées libérales : il fut dès lors accusé par les physiocrates (à l’instar également de Condillac) de ne pas être « pur », de s’éloigner parfois de la vraie doctrine ; il fut parallèlement très critiqué par les anti-physiocrates partisans de l’interventionnisme, qui le rangeaient indistinctement avec les « libéraux ». Malgré cela, son œuvre est remplie d’enseignements dignes d’être médités, comme son chapitre sur la concurrence.

Paul Boësnier de l’Orme, De l’Esprit du Gouvernement économique, Paris, 1775, p.84-89
CHAPITRE XIII.
De la Concurrence.
Il n’y a qu’une véritable valeur relative des denrées ; c’est celle que déterminent les circonstances naturelles du Commerce. Il n’est point de vraie propriété, là où le gouvernement peut changer ou altérer cette valeur, par des lois particulières.
La valeur relative des différentes productions de la terre et des ouvrages de l’industrie, ne peut s’établir et se connaître que par la plus libre concurrence.
Cette concurrence doit s’exercer entre toutes les classes, entre tous les individus, et dans toutes les espèces d’échanges.
Cette concurrence générale peut seule procurer l’expression juste des rapports qui existent entre les différentes denrées, et les besoins relatifs que la société a des unes ou des autres.
Cette concurrence seule peut établir ces justes rapports, en raison de l’abondance de ces denrées diverses.
Cette concurrence est donc le seul moyen d’assurer réellement la propriété et la jouissance à qui elles appartiennent : seule, elle peut donc fixer une juste part de salaire et de récompense, à chaque travail particulier, en raison de son utilité, et animer toutes les parties de l’État par une égale émulation.
Cette concurrence une fois mise en action, tout tend sans cesse à la plus grande perfection et en même temps à la plus grande économie : les Arts s’accroissent et se multiplient par l’épargne de frais que nécessite cette concurrence : et l’on peut dire en quelque sorte, qu’elle les fait subsister les uns aux dépens des autres.
C’est par la variété infinie des travaux auxquels s’étend cette concurrence, que la subsistance du peuple devient ordinairement si modique, et ne représente que l’absolu nécessaire dans les grandes sociétés.
Si ceux qui gouvernent pouvaient apprendre par-là, combien cette subsistance est sacrée, combien il est essentiel qu’elle ne soit, au moins, jamais restreinte que par les lois naturelles du Commerce ; le sort du peuple serait toujours tout ce qu’il peut être de mieux, laborieux mais tranquille.
Il est maintenant facile de concevoir que, si une cause quelconque, étrangère ou forcée, vient à altérer directement ou indirectement la valeur naturelle d’un seul des objets du Commerce ; l’ordre naturel de la société, de la circulation et de la propriété, sera troublé, tant que subsistera cette cause.
Qu’une loi vienne à gêner ou à favoriser, particulièrement la culture des vignes ou des terres labourables, le commerce des vins ou des blés ; alors ces denrées ne peuvent plus jouir de leur vraie valeur relativement aux autres productions, relativement aux autres travaux de la société ; l’équilibre naturel du Commerce est dérangé : le droit de propriété reçoit une atteinte réelle : les terres de l’État ne sont plus cultivées suivant leurs qualités naturelles, propres à telles ou telles productions, mais suivant la faveur particulière accordée à telle ou telle denrée : alors on pourra voir les plaines faites pour porter des grains, plantées en vignes, et les coteaux propres à porter des vignes, presque partout en friche.
Que l’on vienne à donner des encouragements particuliers à telle ou telle Manufacture, ou que l’on en gêne particulièrement le commerce et l’exploitation ; les ouvrages de cette Manufacture ne jouiront plus de leur valeur naturelle : l’on ne pourra jamais savoir de quelle utilité cette Manufacture peut être réellement, en comparaison des autres : on ne favorisera, on ne gênera jamais une espèce de travail, qu’aux dépens, d’un autre, et en nuisant également à tous.
Enfin si les productions de la terre n’obtiennent pas toute la valeur qu’elles doivent avoir, comparativement aux ouvrages d’industrie, les Propriétaires des fonds ne retireront plus un revenu et une jouissance proportionnée de leurs avances et de leurs travaux : ils ne seront donc plus suffisamment encouragés à améliorer leurs terres : conséquemment les terres ne donneront plus la même quantité de productions : et bientôt la plupart des Agents de l’industrie et du commerce, ne retrouvant plus la même quantité de subsistance, ni de matière première pour leurs ouvrages, éprouveront les mêmes inconvénients.
Pareillement, si les autres classes de la société sont forcées d’acheter à trop haut prix les denrées des Propriétaires, si le prix du travail n’est pas proportionné au prix de ces denrées ; ces autres classes ne trouvant plus un intérêt suffisant à employer ainsi leurs travaux et leurs avances, renonceront à leurs entreprises, ou ne pourront même plus rien entreprendre : alors les productions de la terre, ne pouvant plus être mises en œuvre, ni commercées ; elles ne procureront aucune jouissance, aucune utilité réelle aux Propriétaires. Encore une fois tout se tient.
Concluons donc, que pour entretenir la circulation, que pour soutenir l’abondance constante des productions de la terre et de l’industrie, il est indispensable de laisser établir, par la concurrence, la proportion naturelle, qui, dans chaque pays doit exister, non seulement entre la valeur de ses productions entre elles, mais encore entre ses productions et les ouvrages de son industrie.
C’est ainsi, et ce n’est qu’ainsi, que toutes les classes de la société, et tous les individus de la société, trouveront un intérêt égal à l’accroissement du produit général du territoire de l’État, et aux progrès de l’industrie nationale.
—

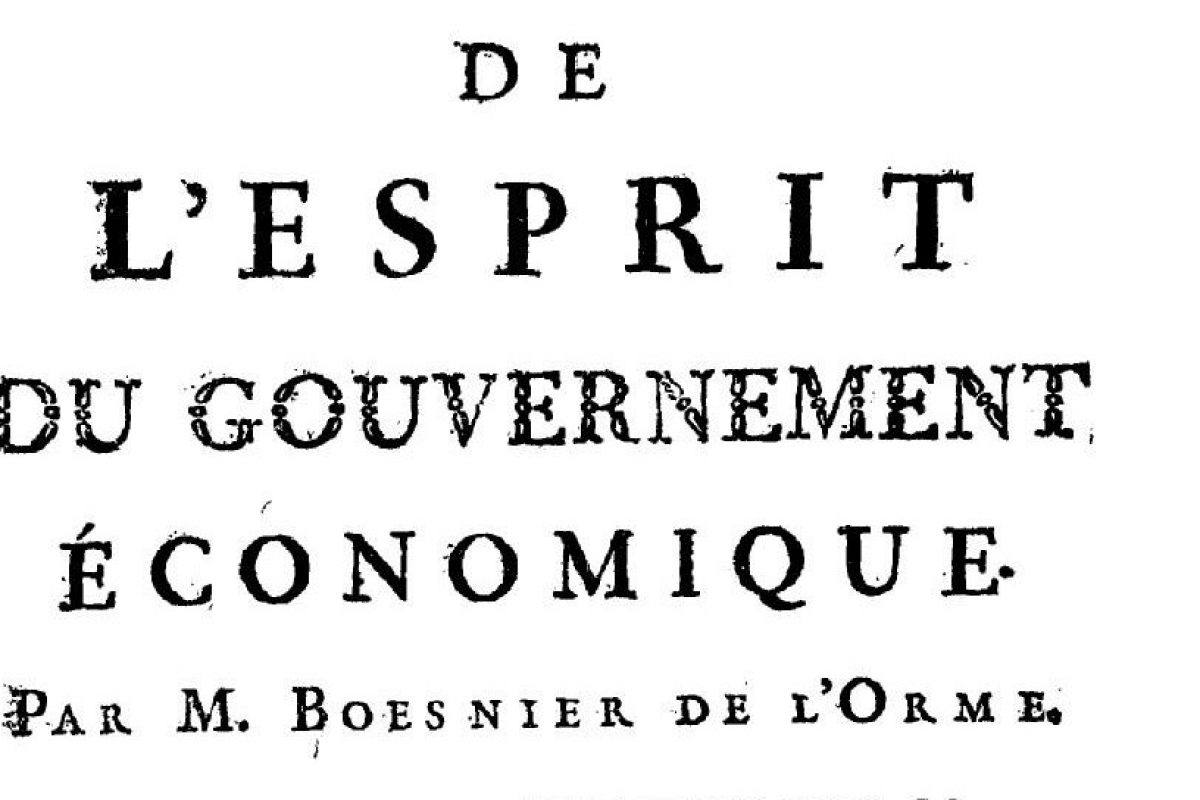



Laisser un commentaire
Créer un compte