Par Francis Richard.
 “Certaines grandes œuvres de la littérature occidentale ont pénétré l’inconscient collectif au point de s’y imprimer durablement, au point d’y prendre racine, contribuant par là même à faire de nous ce que nous sommes.” écrit Éric Werner dans son essai, Le temps d’Antigone.
“Certaines grandes œuvres de la littérature occidentale ont pénétré l’inconscient collectif au point de s’y imprimer durablement, au point d’y prendre racine, contribuant par là même à faire de nous ce que nous sommes.” écrit Éric Werner dans son essai, Le temps d’Antigone.
Au nombre de ces œuvres, il y a justement l’Antigone de Sophocle : “Tout le monde, naturellement, n’est pas amené à devenir Antigone. Mais cette possibilité là (devenir Antigone) est inscrite en nous, nous n’avons donc pas à l’inventer, tout au plus, peut-être, à la (re)découvrir, à l’exhumer.”
Alors Eric Werner (re)découvre, exhume cette œuvre mythique. Et il faut reconnaître que sa (re)découverte, son exhumation, la fait apparaître sous un jour on ne peut plus moderne. Quoi de neuf ? Sophocle, vingt-cinq siècles plus tard…
On sait (ou on ne sait pas) que, dans cette pièceCréon s’oppose à ce que soit donnée une sépulture à Polynice qui s’est mis du côté des envahisseurs de Thèbes : celui qui contreviendra à cette loi sera puni de mort.
Antigone brave l’interdit de Créon, parce que cette loi personnelle s’oppose aux lois non écrites et inébranlables des dieux, lois qui “ne datent ni d’aujourd’hui, ni d’hier”, qui sont “éternelles”. Ce qui fait penser inévitablement à ces innombrables lois humaines fabriquées au gré des circonstances, et qui s’opposent aux droits naturels…
Selon Eric Werner la phrase peut-être la plus importante de la pièce est celle que dit le chœur au tout début : “Les combats d’hier sont finis ; il faut les oublier.” Ce que, justement, Créon ne veut pas. Il veut aller jusqu’au bout de sa vengeance, quitte à offenser les dieux, quitte à en assumer les conséquences funestes.
Antigone est une pièce sur la guerre et sur les limites à lui donner : Créon ne veut pas admettre qu’il y ait des limites à la guerre et il refuse cette première limite qu’est le respect dû aux morts, que les dieux commandent, fussent-ils des ennemis. Cette absence de limites est caractéristique de sa démesure, de
De prime abord, Créon et Antigone semblent, l’un comme l’autre, n’écouter qu’eux-mêmes, mais, en réalité, Antigone se distingue de Créon, parce qu’elle écoute en elle quelqu’un d’autre que les autres. Ce quelqu’un d’autre, Eric Werner l’appelle Dieu, et ce “n’est pas une instance externe, mais bien interne”, contrairement à la représentation usuelle.
Pour Eric Werner, Sophocle appartient au camp humaniste – “il croit en l’homme, il a confiance en l’homme” -, mais “il est nécessaire, dans l’intérêt même de l’humain, que l’humain s’articule au divin, car, à défaut, l’humain a toute chance de virer à l’inhumain”. Antigone personnifie ce dépassement de l’opposition entre raison et religion.
Pour Sophocle, qui doit beaucoup à Héraclite, l’homme est un être en mouvement, ce qui est bien. Ce qui le met en mouvement, ce sont ses affects, “l’amour, l’espoir, le plaisir pris à l’audace”, mais pour que cette autonomie conduise à choisir le bon chemin, comme Antigone, il faut qu’elle adhère aux lois non écrites, sinon elle conduit à errer, comme Créon.
Dans Antigone, trois personnages sont des archétypes : Créon, ou l’autonomie sans Dieu, Tirésias, ou Dieu sans l’autonomie, et . Ce sont des archétypes qui se retrouveront plus tard dans la parabole évangélique du fils prodigue, où les deux fils représentent deux extrêmes, Dieu sans l’autonomie pour l’aîné et
Une autre façon de décrire ces trois possibilités d’autonomie est de dire que le progressiste est l’impie qui recherche le mouvement pour le mouvement, le traditionaliste le pieux qui s’oppose à tout mouvement, et le défenseur du mouvement respectueux des lois non écrites celui qui, de fait, défend la civilisation, où se réconcilie deinotès et justice des dieux.
Ces grandes lignes de l’essai d’Éric Werner sont bien sûr réductrices des raisonnements qui le sous-tendent, dont certains lui sont propres et dont d’autres s’appuient, de manière critique, par exemple sur l’autre pièce de Sophocle, où ne subsistent plus que les deux premiers archétypes ; ou sur les réflexions de Georges Steiner dans son livre Les Antigones ; ou sur les points de vue opposés d’Ernst Jünger et de Martin Heidegger.
Selon Éric Werner, au XXe siècle, nous serions entrés dans la post-civilisation, dans une ère de démesure. Les hommes auraient fini par succomber à leur tentation innée de la démesure, qui serait devenue idéologique et avancerait masquée. Et les Antigones – “il y a bien des manières d’être Antigone” – seraient “le petit nombre”…
Eric Werner fait sienne la vision de Naomi Klein qui, “dans le contexte de l’après-guerre froide et du redéploiement néolibéral consécutif à la chute du mur de Berlin” parle de “capitalisme du désastre” – “qu’on pourrait aussi qualifier de jusqu’au-boutiste”, qui se caractériserait par l’élimination “de tout ce qui ferait obstacle aux lois du marché”, et où le mouvement pour le mouvement prendrait “la forme de la croissance pour la croissance”.
Il est dommage qu’Éric Werner fasse sienne une telle vision caricaturale, idéologique. Car peut-on encore parler de libéralisme dans ce qu’il décrit, et même de capitalisme ? Quand il reproche à Heidegger d’avoir “un problème de noms” – pour Heidegger, “la dikè [la Justice] n’est que l’autre nom de l’hybris [la démesure]” – ne peut-on pas lui faire un reproche analogue ?
Le libéralisme authentique ne repose-t-il pas sur les postulats fondateurs que sont :
- la liberté des échanges, de la concurrence et du travail (ce qui suppose le respect des contrats)
- la non-intervention de l’État limité dans l’activité économique (tout le contraire de ce qui se passe aujourd’hui où l’État démesuré ne connaît plus de limites)
- la primauté de la propriété privée (y compris la propriété de soi, ce qui suppose la non-agression physique et matérielle) et de la responsabilité individuelle (ce qui suppose de réparer les dommages commis à autrui)
C’est-à-dire sur autant de limites, de règles de juste conduite pour reprendre l’expression de Friedrich Hayek ?
Mario Vargas Llosa ne dit-il pas que le terme de néolibéralisme a été « conçu pour dévaluer sémantiquement la doctrine du libéralisme » ?
- Éric Werner, Le temps d’Antigone, 160 pages, Xenia (à paraître).
—

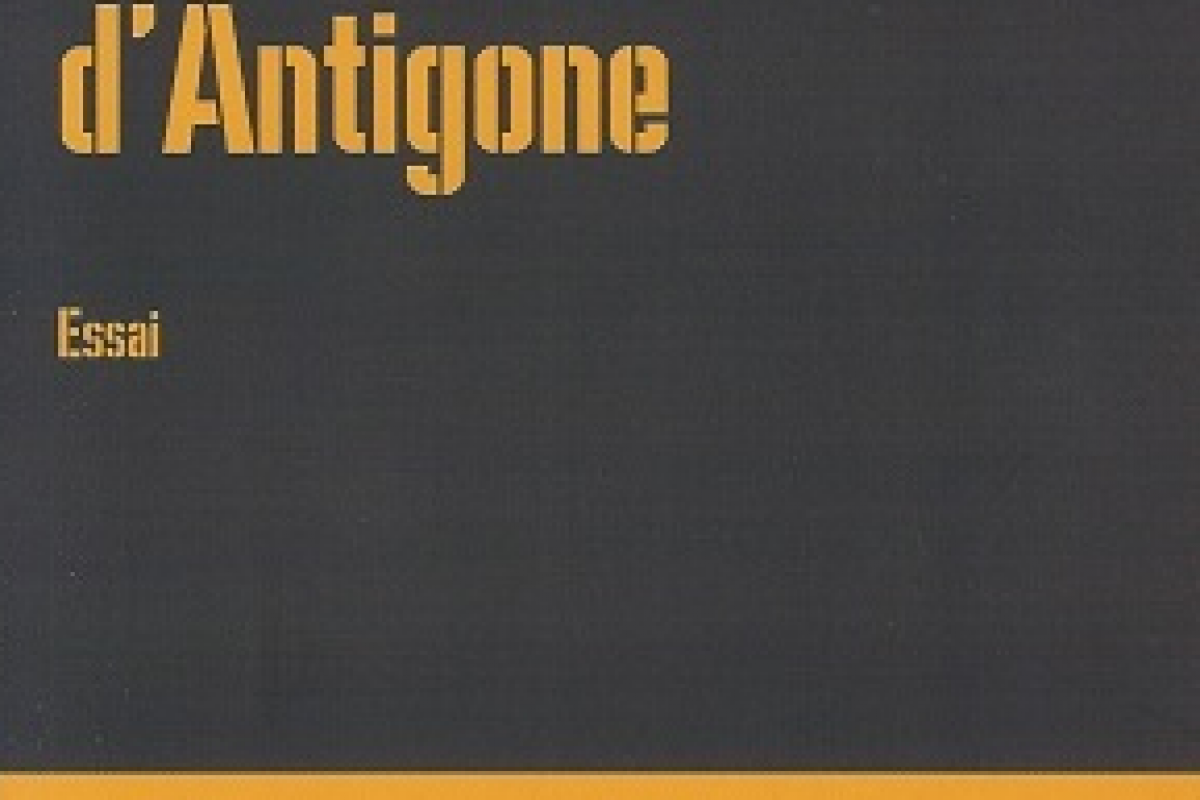
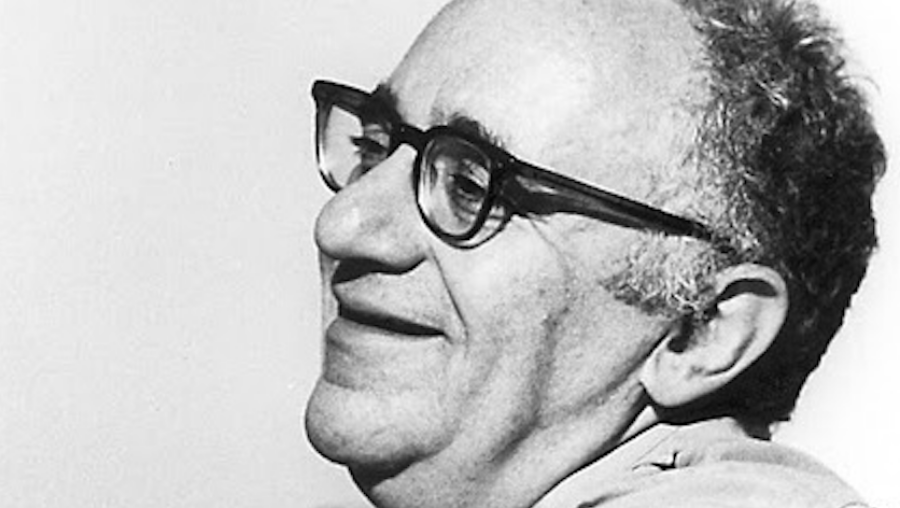


Sans remettre en cause la lecture que vous évoquez d’Antigone, il y a un autre point de vue qui fait toute la richesse de ce texte : c’est de voir Créon, engagé par sa responsabilité : Ayant décrété une loi, il ne peut pas accepter qu’on y déroge, ni, lui-même s’y soustraire, même pour un membre de sa famille; alors qu’Antigone refuse toute responsabilité pour préserver sa liberté. Les deux personnages sont pris à les propres pièges. Aucun n’est tout blancs ou tout noir.