Par Olivier Ezratty.

Dans cette troisième partie d’une série d’articles sur l’évitement de l’uberisation, nous nous penchons sur trois autres phénomènes qui accompagnent les innovations de rupture après avoir traité des insatisfactions clients et de la défragmentation des marchés et des baisses de prix :
- Les bouleversements de l’équilibre produit et service liés à des économies d’échelle pour un sens et à la commoditisation des produits dans l’autre sens.
- La numérisation des savoirs qui est en train de bouleverser de nouveaux métiers protégés jusqu’à présent et notamment ceux de la santé qui vont probablement être confrontés à d’importants bouleversements.
- Le transfert du travail chez le client, qui génère une réduction des coûts apparents et crée une spirale déflationniste, en particulier dans l’économie du savoir et des contenus.
Comme les phénomènes précédents, ceux-ci peuvent s’additionner dans les mouvements de migration de valeur.
Bouleversements de l’équilibre produit et service
De nombreuses disruptions se sont manifestées sous la forme d’un rééquilibrage dans un sens ou l’autre entre produits et services dans un domaine d’activité.
Le glissement du mix vers le produit intervient quand le produit est un modèle plus scalable que le service. Dans ce cas, la R&D de création du produit est amortie par sa vente en volume. C’était le cas de l’industrie du logiciel à ses débuts. Ce genre de migration se manifeste avec tous les outils qui permettent de “faire soi-même” (do it yourself) : créer un site web avec des templates (qui évitent l’agence de communication), la PAO qui permettait en théorie de se passer de maquettiste, le SEO / SEM réalisé avec des outils d’analytics en ligne ainsi que dans les places de marché où tout le travail est réalisé par le logiciel et par les acteurs d’un marché biface (vendeurs-acheteurs). C’est ici le royaume de l’automatisation et du self-service.

J’ai croisé par hasard un exemple de migration vers le produit au détour d’un hôtel à Las Vegas avant ma visite du CES 2015. Dans le Bally’s se trouvait un étrange système d’Aquamassage. Il s’agit d’un système de massage de l’ensemble du corps qui s’appuie sur l’envoi de jets d’eaux à ceci près que l’on reste sec grâce à une paroi en caoutchouc entre les jets d’eau et le client. Le positionnement ? Un massage sans masseur ni masseuse, et on peut en plus rester habillé. Sans que le numérique soit en cause, on est ici bien face à un produit qui peut remplacer un service. L’Aquamassage n’a pas pour autant remplacé toutes les masseuses et masseurs. L’une des raisons est le coût probablement non négligeable du système de massage. Dans le numérique, les logiciels “scalent” mieux du fait de coûts marginaux quasiment nuls et leur prix est généralement assez bas, facilitant la transformation de services en produits.
A contrario, des disruptions peuvent intervenir dans l’autre sens, du produit vers le service. Elles interviennent dans le cas où les produits se commoditisent et que leur prix baisse sans que la complexité de leur mise en œuvre baisse pour autant. C’est arrivé avec le marché des PC d’entreprises, autant desktop que serveurs, ce qui a amené les grands constructeurs (IBM, HP, Dell) à réorienter une bonne part de leur activité dans les services, qui génèrent de meilleures marges. L’activité de construction a été en grande partie délaissée aux constructeurs asiatiques comme Lenovo qui savent faire du produit mais pas du service. Dans le même temps, IBM a poursuivi son activité d’édition de logiciels qui générait les meilleures marges. En se focalisant sur les services et les logiciels, elle a simplement délaissé l’activité qui générait les marges les plus faibles, dans le business du matériel de commodité (PC, serveurs Intel). Dans les années 1980/1990, les marges dans le matériel et notamment les mainframes et les mini (AS400) étaient très élevées, un peu comme le sont celles d’Apple aujourd’hui.
Le processus de collaboration dans la R&D logicielle mise en œuvre pour la création de logiciels open source a aussi entraîné une migration de ce genre. Le passage est plus facile à accepter pour les constructeurs que pour les éditeurs de logiciels. La raison est simple : la marge d’un constructeur est moins bonne en général que celle d’une société de service. Donc passer du premier au second permet d’aller dans le bon sens. Alors que la marge d’un éditeur de logiciel est généralement supérieure à celle d’une société de service. Passer du logiciel au service fait baisser les économies d’échelle et la marge.
Les constructeurs automobiles seront peut-être amenés à appliquer le scénario produit vers service, avec l’avènement des voitures à conduite automatique. Celles-ci seront de plus en plus proposées sous forme de service à la demande, au détriment des voitures que l’on possède.
Les logiciels en cloud sont un cas particulier. Ce sont des produits vendus comme du service, sous forme d’abonnement. Le modèle de distribution est scalable tout comme le produit et le revenu sont récurrents, comme le sont habituellement les activités de services. Uber fonctionne sur un mode identique : c’est un service fourni via du logiciel avec un modèle très scalable.
La même transformation est en cours avec la transition de la vente de CD de musique et de DVD de films vers leur diffusion sous forme dématérialisée. Cela a permis à Apple de s’imposer avec iTunes, surtout dans la musique, et à Netflix de faire de même dans la vidéo. Le dernier a réussi à gérer une transition en passant de la location de DVD ‘physiques’ au streaming vidéo. Le second l’a fait plus discrètement, en supprimant progressivement les lecteurs de DVD/CD de ses Macintosh, surtout les laptops comme le Macbook Air.
Comment se préparer ? Il faut anticiper la commoditisation des catégories de produits dans lesquelles on exerce son activité et envisager de déplacer le centre de gravité de son activité vers des activités moins standardisées et si possible à meilleures marges, ou alors vers des métiers adjacents aux siens qui permettent de survivre dans de meilleures conditions.
Numérisation des savoirs
La numérisation des savoirs sous forme de contenus en ligne, voire de systèmes d’intelligence plus ou moins artificielle va transformer de nombreux marchés. C’est un cas de migration d’activités de services soit vers des produits soit vers des services, soit une combinaison des deux.
Ici, ce sont des métiers et des professions libérales ou des TPE qui sont menacés plus que de grandes entreprises. Toute forme d’automatisation a comme conséquence de réduire la quantité de travail nécessaire pour produire un service donné. Elle génère des économies d’échelle qui concentrent la valeur sur un petit nombre d’acteurs au détriment d’un grand nombre d’intervenants.
Les métiers touchés par ce phénomène en devenir sont notamment ceux de la santé, du droit et de l’enseignement. Jean-Michel Billaut l’a très bien exposé dans certains de ses articles ainsi que dans une intervention au Hub Institute Prediction Day de janvier 2015.
Certains métiers des agences de presse et du journalisme sont menacés avec l’apparition relativement récente de générateurs automatiques d’articles voire de vidéos pour les news. Ces mêmes agences de presse avaient été créées elles-mêmes pour défragmenter le marché de presse par la mutualisation d’une partie des moyens de production de contenus.
Prenons le cas des médecins généralistes. Si on analyse le processus de prise de rendez-vous, de la visite et de ce qui suit, on peut anticiper qu’une grande partie des étapes et tâches vont être progressivement grignotées par de nouveaux produits et services.
La première révolution provient des capteurs permettant aux patients de faire leur propre autodiagnostic. Ils sont généralement reliés aux smartphones : les thermomètres connectés, les tensiomètres connectés (ci-dessous à gauche, celui de Withings), les stéthoscopes connectés (celui de Thinklabs), les otoscopes (à sa droite, le CellScope OTO qui est relié à un service de prise de rendez-vous en cas de problème), le Skin Scan pour scanner un mélanome, les échographes portables (le MobiUS SP1 de MobiSante), les optiques permettant de transformer un iPhone en ophtalmoscope (comme le D-Eye, modulo le besoin d’utiliser des gouttes pour élargir la pupille) ou encore les capteurs de glycémie implantables pour les diabétiques et pré-diabétiques.
D’autres systèmes d’autodiagnostic ne manqueront pas d’apparaître, à plus ou moins long terme : des dérivés de ce prototype de détecteur de maladies infectieuses pour smartphones (ci-dessous), divers systèmes d’analyse biologique (sang, urine) existants ou à venir dans la lignée des “labs on a chip” et même des straps d’analyse de la sueur (chez la startup Electrozyme). À plus long terme, on pourra avaler des nanoparticules pour détecter des cellules malignes, un domaine dans lequel Google planche actuellement ainsi que la startup Bikanta pour détecter les cancers du sein avec des nanoparticules de diamant fluorescentes (que l’on ne sera pas pour autant tenté de prendre à tous les petits déjeuners…).
Tous ces capteurs disparates seront un jour intégrés et miniaturisés. Des projets dans ce sens sont déjà lancés comme ceux qui candidatent au Qualcomm Tricorder XPrize, un concours étalé sur plus de deux ans et doté de $10m de financements.
Plusieurs sociétés ont déjà créé des stations de télémédecine permettant aux patients de capter de nombreux paramètres tels que le HealthSpot, la Lifeclinic Higi Station ou la Consult-Station du français H4D. Elles fonctionnent en liaison avec un médecin à distance installé dans un centre d’appel ou chez lui.
Diverses formes de médecine préventive se mettent également en place. La plus simple consiste à s’inciter soi-même via un tracker à avoir une activité physique régulière. On peut aussi surveiller la qualité de ce que l’on mange avec le Scio ou le TellSpec. D’autres formes plus complexes interviendront le jour où le séquençage d’ADN sera généralisé avec une exploitation fine des résultats dans le cloud.
Mais pour un grand nombre de pathologies standards, des services en ligne sont ou seront capables d’intégrer les informations issues de ces divers capteurs et d’identifier l’origine de symptômes comme DocteurClic, ou encore Google qui s’apprête à lancer un moteur de recherche dédié aux pathologies de santé. Certains de ces outils seront capables d’analyser les images générées par les capteurs cités plus haut. Des prescriptions pourront être faites, éventuellement vérifiées par des systèmes experts à la Watson, ou par des docteurs à distance. Puis le cas échéant, les médicaments pourront être livrés par correspondance dans les heures suivantes.
Dans le cas où une visite chez un médecin devra avoir lieu, des services de prise de rendez-vous en ligne trouveront le médecin disponible le plus rapidement et le plus proche. Très souvent, celui-ci prescrit des examens de laboratoire et d’imagerie (IRM, radio, scintigraphie, doppler). Aujourd’hui, ces examens d’imagerie sont réalisés un par un. Et dans les bilans de santé, on se contente d’analyser le sang et l’urine.
Pourtant, un examen des os, des poumons, des corps mous et du système sanguin sont utiles pour détecter à l’avance l’émergence de nombreuses pathologies (tumeurs, maladies cardio-vasculaires). On utilise pour l’instant des tomographes mono-fonctions tels que l’lAquilion LB de Toshiba et le General Electric Revolution CT (rayons X). Ils reconstituent un corps humain en 3D avec toutes ses composantes. Pourquoi n’existe-t-il pas un scanner pouvant associer dans un seul appareil toutes les technologies de tomographie (rayons X, IRM, …) permettant d’identifier toutes les pathologies en un seul examen ? À l’origine, c’est surtout parce que les métiers sont très cloisonnés. C’est aussi lié au coût élevé de ces engins. Mais on commence à en voir apparaître, comme ces dispositifs capables de cartographier le cerveau avec précision.
Le cloisonnement des métiers de santé et des spécialistes bloque aussi une bonne part des innovations du secteur. Sans compter les déboires – en France – du fameux dossier médical mal partagé et en place pour moins d’un demi-million de personnes. Cette médecine en pièces détachées est amenée à se transformer. Elle le fera sous l’impulsion d’un mélange d’uberisation (intermédiation pour trouver un médecin), de nestification (une partie de l’activité des médecins remplacée par des outils d’autodiagnostics), le tout finalisé par une défragmentation pouvant provenir aussi bien des professions de santé que par un acteur externe. On retombe sur le point de la défragmentation abordé dans le second article.
Les médecins ne disparaîtront pas pour autant. On fera plus appel à eux à distance, notamment dans les zones mal couvertes. On fera toujours appel aux métiers où l’intervention humaine sera nécessaire, notamment les dentistes, ophtalmologues, kinés et chirurgiens.
Que devraient faire ces professionnels pour éviter de se faire ainsi désintermédier ? Aujourd’hui, ils résistent plus par conservatisme que par le sens de l’innovation. C’est notamment le cas du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens qui empêche par voie juridique la startup de Montpellier 1001Pharmacies de se développer pour faciliter l’accès aux médicaments.
Le bon sens serait que les métiers de santé prennent en compte les évolutions technologiques pour faire évoluer la valeur ajoutée qu’ils apportent, pour faire réduire les coûts de santé qui augmentent sans cesse et pour rendre celle-ci accessible au plus grand nombre. Ils doivent aussi adopter des outils qui simplifient la vie de leurs patients ou clients. Là encore, défragmentation et mutualisation seraient les bienvenues. Si les métiers de santé continuent d’avancer en ordre dispersé, ils se feront à coup sûr à la fois uberiser et nestifier violemment un jour ou l’autre.
L’autre leçon de l’histoire est qu’il faut évidemment encourager le développement de startups et PME innovantes dans le secteur des techniques médicales, et notamment accompagner leur développement international. Cela passe par un encouragement des praticiens à s’y impliquer d’une manière ou d’une autre. Il m’arrive de croiser des entrepreneurs dans ce secteur, notamment chez Scientipôle Initiative, et ils sont très souvent eux-mêmes issus des métiers de santé ou bien ont des praticiens dans leur équipe de fondateurs ou d’investisseurs.
Les métiers du droit ne seront pas aussi bien protégés que les médecins et spécialistes de la santé. Ils risquent d’être plus amplement numérisés même si le droit est souvent complexe et ambigu, surtout en France. On voit déjà des services en ligne qui apparaissent pour faciliter la création de contrats standards dans les PME (Captain Contrat) et les procédures juridiques des particuliers (demanderjustice.com). Ce n’est qu’un début car ces services se focalisent sur des tâches relativement simples. Mais à terme, ils se sophistiqueront et seront capables de traiter une part de plus en plus importante des questions juridiques des entreprises et des particuliers.
Comme pour les contenus (musique, presse écrite, etc), il n’y aura pas 36 solutions pour les professionnels : il leur faudra s’adapter et exploiter tous ces outils pour être plus efficaces, ou bien… disparaître, ou enfin, devoir se focaliser sur des marchés de niche à très forte valeur ajoutée.
Transfert du travail chez le client
Le numérique et l’Internet ont déclenché une autre migration de valeur phénoménale : le transfert du travail chez le client, mais pas forcément la valeur économique associée, qui est le plus souvent conservée par l’agrégateur.
On la retrouve dans tous ces services en ligne dont la valeur provient des données des utilisateurs, fournies soit explicitement (l’User Generated Content) soit implicitement (les données de parcours dans les sites, ses recherches, ses achats, ses déplacements, ses relations). Dans l’UGC, le travail est transféré vers le client mais pas la valeur économique qui reste chez celui qui l’agrège. Google fait payer la publicité via les AdWords mais ne rémunère pas les développeurs et éditeurs qui créent des liens entre les sites web, servant à générer le PageRank. Ce sont des tâches élémentaires trop petites et dispersées pour justifier une rémunération traditionnelle. Dans la même veine, Facebook ne rémunère pas les producteurs des vidéos qui sont relayées dans son réseau social.
La presse écrite fonctionne maintenant sur ce modèle en agrégeant de plus en plus du rédactionnel qui provient de contributeurs non journalistes et non rémunérés. Tous ces contributeurs sont motivés par la visibilité générée par la diffusion de leur contenu dans les sites médias. Cela repose sur l’égo et la promesse d’une notoriété éventuellement monétisable par la suite. C’est un circuit de dupes car à part celui qui est en haut de la pyramide, tous les autres se font avoir dans le système avec un travail qui n’est pas rémunéré à sa juste valeur, ce d’autant plus qu’il est extrêmement fragmenté plus on descend dans le bas de la pyramide d’agrégation.
Ici, les premiers “uberisés” sont les contributeurs qui tombent collectivement dans le piège de la création de contributions non rémunérées. Tombent ensuite ceux qui ont l’habitude de vivre de leur travail de création. L’Internet a ainsi permis la création d’un inventaire de contenus dans tout un tas de domaines. Les contenus sont abondants et leur commoditisation en a baissé la valeur faciale. Il est difficile de lutter contre ce phénomène autrement qu’en se différenciant. L’UGC a aussi déporté la valeur du produit (le contenu) vers le service (conseil, conférences, etc).
Le transfert de valeur vers l’individu prend d’autres formes avec des produits qui permettent aux consommateurs de produire eux-mêmes des biens de consommation courante : les outils pour la cuisine qui permettent de préparer des plats en lieu et place des plats cuisinés industriels (comme le Cookeo de Moulinex dans le groupe Seb), la Picobrew vu au CES 2015 qui permet de produire de la bière chez soi, le SodaStream qui sert à produire ses boissons gazeuses aromatisées, les panneaux photovoltaïques pour produire sa propre électricité ou les outils d’autodiagnostic dans le domaine de la santé ou encore de l’automobile.
L’impression 3D pourrait générer le même genre de migration avec un déport de la valeur chez les utilisateurs, capables d’imprimer leurs propres pièces détachées. Nous n’y sommes pas encore dans la pratique car les objets imprimables chez soi ne sont pas encore assez nombreux et le coût et la facilité de mise en œuvre des imprimantes 3D pas adaptés aux besoins actuels.
Le do-it-yourself transfère la valeur du produit vers l’outil qui créé le produit et le consommable associé. L’arbitrage des consommateurs s’appuie sur un équilibre variable entre temps (que cela prend de faire soi-même contre acheter du tout prêt), argent (le prix du tout prêt vs celui du fait-maison) et la valeur émotionnelle (le plaisir de faire soi-même vs celui d’obtenir une satisfaction immédiate dans l’achat du tout prêt).
Certaines entreprises n’ont pas compris que le marché demandait plus de “do it yourself”. J’en ai fait l’amère expérience avec la marque hi-fi Denon. Il se trouve que j’utilise un amplificateur de cette marque dont un bug empêche le bon fonctionnement. Pour le corriger, il faudrait y installer une mise à jour du firmware via une liaison série RS-232C. Or, il est impossible de télécharger ce firmware en ligne. Quand on demande ce firmware à Denon, ils indiquent qu’il faut apporter l’amplificateur dans un centre de réparation agréé. Non seulement, cela coûterait sûrement quelques centaines d’euros, mais cela prendrait du temps, ne serait-ce que pour débrancher et rebrancher sans se tromper les nombreux câbles qui arrivent dans l’amplificateur. Je peux vous dire que je suis plus qu’insatisfait par la marque en question et qu’il va leur en coûter cher à l’avenir !
On peut mettre ici l’économie du partage ainsi que l’intermédiation de services où la plateforme d’échange ne produit rien, mais met en relation des prestataires qui ont du temps et pas d’argent avec des clients qui ont de l’argent mais pas de temps. Dans l’histoire, seul l’intégrateur a un modèle “scalable”, basé sur du logiciel et du cloud. Tout du moins, une fois qu’il a réussi à créer un inventaire de clients et de prestataires de taille critique. Le modèle est scalable seulement pour l’agrégateur car sa valeur ajoutée passe par du logiciel tandis que tout ce qui est manuel – et donc peu scalable – est réalisé par les offreurs et demandeurs de services.
Dans le cas des terminaux permettant de faire ses courses en hypermarchés et d’enregistrer soi-même le prix des produits acquis, le client là encore fait le travail de la caissière avec l’impression de mieux contrôler ses achats et de gagner du temps en évitant la queue à la caisse en sortie.
Le comble sont les banques qui ont transféré une partie du travail de leurs agences vers leurs clients via leurs services en ligne et qui font payer ce self-service (3,5€ par mois chez LCL…). Ce transfert réduit dans la pratique le besoin de ressources dans les agences et permet de réaliser des économies. Cela les oblige à modifier les services et compétences des équipes dans les agences dont les effectifs ont par ailleurs régulièrement baissé ces dernières années.
Le financement participatif est une autre forme de travail non rémunéré qui remplace un travail qui l’est. Il relève d’une approche voisine de transfert du travail : l’intelligence des foules permet de prendre la décision de financer l’amorçage de startups quand des investisseurs en capital ne sont pas à même de prendre ce risque. Et le financement participatif n’a rien à voir avec l’investissement en capital. Les “crowdfunders” d’Oculus Rift s’en sont plaints lorsque ce dernier a été acquis début 2014 pour $2B par Facebook. Ceux qui croyaient au Père Noël du Numérique et s’attendaient à recevoir des actions gratuites, qui n’étaient évidemment pas prévues au moment de la levée de fonds Kickstarter.
Des entreprises traditionnelles ont appris à s’appuyer sur la créativité de leurs clients. C’est le cas de l’approche d’innovation ouverte de LEGO qui est bien documentée. La société qui était en déclin rapide il y a dix ans a été redressée alors même que ses brevets entraient dans le domaine public. Leur approche avait consisté à s’appuyer sur la créativité de ses utilisateurs au lieu de la protection de sa propriété intellectuelle. Ils ont notamment lancé leur version de l’UGC avec Design By Me, devenu un répertoire de modèles. Ils ont aussi adopté les canons du numérique avec leur Digital Designer, un logiciel de modélisation 3D de modèles LEGO.
C’est aussi la démarche d’Air France qui a fait travailler des “focus groups” pour améliorer ses plateaux repas. Dans ce cas de figure, l’entreprise génère plutôt de petites innovations incrémentales, qui ne changent pas trop la donne au niveau marché mais permettent d’améliorer graduellement la satisfaction clients.
Ces 10 dernières années, on ne compte plus le nombre de créations de startups et d’initiatives de moyennes et grandes entreprises qui s’appuient sur le modèle du travail gratuit du client. C’en est presque caricatural parfois tellement le procédé est grossier. En tant que consultant, je suis ainsi invité à participer à des groupes de travail par des sociétés privées qui veulent plancher sur tel ou tel sujet. Dans l’ancien temps, on commandait une mission de conseil ou une étude. Maintenant, on fait appel à de petites tranches de temps d’experts sans les rémunérer. Malheureusement, plein de professionnels tombent dans le panneau. Des services d’intermédiation se montent pour mettre en relation les “experts” et les “demandeurs”. Ils proposent du coaching facturé à l’heure voire à la demi-heure dans tout un tas de domaines. Cela conduit à un saucissonnage du travail qui le rend difficilement monétisable à grande échelle par les experts.
Le défi de ceux qui veulent faire appel au travail gratuit est que leurs cibles sont très sollicitées et ont un temps disponible limité. Celles qui font un travail de qualité ne souhaitent pas forcément le donner comme cela. Un équilibre se créée entre l’offre et la demande. Le plus souvent, c’est le client ou l’individu qui travaillent gratuitement qui se font massivement empapaouter. On évoque souvent l’intelligence des foules mais dans le cas présent, la foule se fait bien avoir par le système !
_________
Dans l’épisode suivant, nous examinons des cas de ratages de ruptures technologiques intervenus dans les industries numériques qui ne dépendaient pas forcément d’un phénomène d’uberisation. Nous tenterons d’identifier comment des relations avec les startups permettent ou pas d’éviter ces déboires.

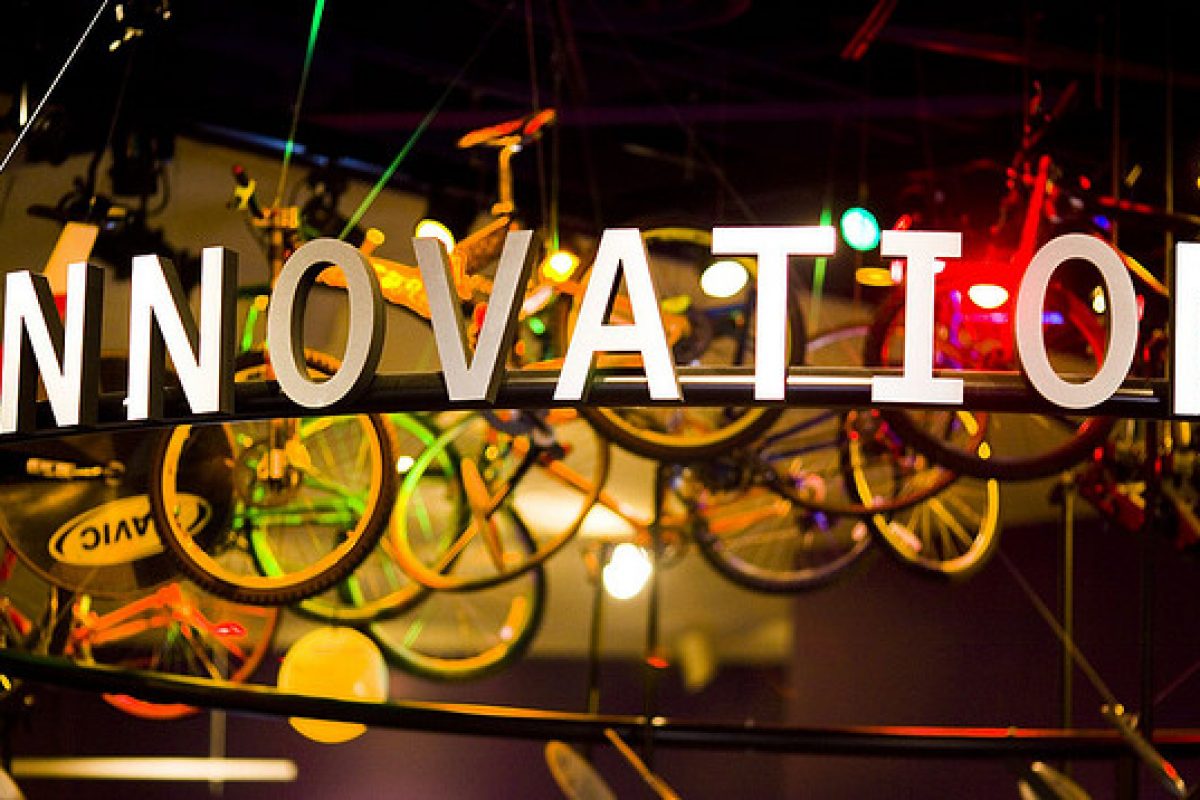






Article très intéressant, merci!
Par contre un massage habillé, pour des petites caresses sur la main ok, mais sinon c’est plus sympa non habillé…:)
Je m’interroge sur la véritable satisfaction du client dans cette évolution. J’ai le sentiment qu’elle est très relative, et largement biaisée dans les sondages de marketing qui se contentent de demander au client si les avantages du système lui plaisent sans lui évoquer les alternatives (par exemple le massage par une charmante personne à l’écoute de ses désirs). Au final, on a l’impression d’une promotion extraordinaire du pis-aller, par le biais du renchérissement et de la raréfaction du service de qualité. Ca ouvre sans aucun doute plein d’opportunités pour les créateurs d’entreprises, mais pas dans le cadre normal d’un marché où l’offre rencontrerait une demande existante au lieu de la mouler à ses propres intérêts : ça ne fonctionne que grâce aux marchés pervertis actuels (le parcours de soins, p.ex.) qui servent de repoussoirs.