Par Johan Rivalland.
 Voici un roman bien surprenant et original sur l’univers du livre et son devenir, à l’heure où celui-ci se dématérialise et tend à perdre de son attrait.
Voici un roman bien surprenant et original sur l’univers du livre et son devenir, à l’heure où celui-ci se dématérialise et tend à perdre de son attrait.
Ici, dans un temps futur dont on ne saurait dire s’il est très proche ou pas, il aurait plutôt vocation à retrouver justement toute sa matérialité et son pouvoir d’attraction ; mais pas au sens où on l’entend.
Le livre est, en effet, paré de tous les attributs de l’objet strictement matériel et purement dénué de toute signification profonde, que l’on exhibe ou collectionne banalement, de même que la musique ou les amis (auxquels on attache d’étonnantes utilités).
Une satire du monde médiatique
Un roman joyeusement délirant et à la fois inquiétant, tant il recèle, à travers des situations certes parfois complètement loufoques, de nombreuses vérités.
Une véritable satire du monde médiatique, ses codes, ses outrances. Les postures, mensonges, rivalités qui caractérisent ce petit monde, avec ses célébrités parfois éphémères. Le rôle difficile des animateurs de télévision, symboles de la superficialité et de la fausseté téléguidée, assis sur un siège éjectable et, de ce fait, amenés à se conformer à la bonne humeur ambiante et aux bonnes recettes de la société du spectacle, « n’ayant, par obligation, pas de sens critique ». Sans oublier la futilité des acteurs et autres stars ou artistes, premières victimes du monde des apparences.
Il n’est nullement question, ici, naturellement, de généraliser ou de stigmatiser telle ou telle catégorie de gens, dont certains peuvent d’ailleurs être fort respectables. Mais il s’agit plutôt, pour l’auteur, de dénoncer les dangers de la société actuelle et les risques de dérives. Par le moyen de l’humour ; car ce roman en contient beaucoup.
On croit voir, ça et là, des références subtiles à des personnages connus ou célébrités médiatiques qu’il peut nous sembler reconnaître à travers certaines descriptions ou parfois consonances du nom, sans que ce soit établi par l’auteur, ou même forcément totalement intentionnel. Davantage, peut-être, un méli-mélo de différents personnages ou caractères auxquels on peut penser à l’évocation de certaines descriptions.
Au final, de manière différente de ce que l’on pouvait entrevoir dans une société du type de celle de Fahrenheit 451, on retrouve ici la sensation que l’on offre au spectateur un prêt-à-penser, ou plutôt à se conformer, lui aussi, en se basant sur des codes et comparaisons artificiels et stéréotypes sans véritables fondements. Une forme de voyeurisme exacerbé.
Roman d’anticipation ?
Rythmé, constitué en phrases courtes et chapitres très courts (deux à quatre pages en moyenne), ce roman jouit d’un style résolument léger en apparence, descriptif et factuel dans son essence, mais en réalité incisif, plein de sous-entendus et d’une ironie évidente, qui ne laissent à aucun moment place à l’ennui.
Très efficace, en somme, pour délivrer un message de fond sans complaisance et reflet parfait du monde médiatique dans lequel nous sommes plongés, avec tous ses travers grandissants. Une sorte de roman d’anticipation, où ce qui apparaît de premier abord surréaliste ne fait que grossir des traits caractéristiques déjà bien présents au sein d’un système dont l’inclinaison de la pente, hélas, ne laisse guère de doute.
Quant au contenu des livres, dans cette histoire, plus personne ne s’y intéresse véritablement. La plupart des auteurs ne font qu’y compiler, pour l’essentiel, des passages entiers d’auteurs plus anciens (on verra là, sans doute, quelques autres allusions), que de toute façon plus personne ne lit. Ce qui leur apporte toute légitimité à recopier des textes ou ouvrages entiers, sans forcément qu’il y ait de véritable cohérence. Les progrès techniques (tout à fait authentiques, d’ailleurs) permettent en outre à l’intelligence artificielle de prendre le relais de l’humain pour se charger du contenu, ce qui rend même tout effort inutile.
Seule la couverture compte, ses couleurs, l’épaisseur et l’allure du livre, son poids, son harmonie apparente avec l’auteur ; toutes choses en réalité fruit du travail de l’éditeur, lui aussi rompu aux meilleures méthodes du marketing médiatique de l’époque. Et pour un produit qui se veut forcément éphémère, le passé n’étant pas recyclable.
Extrait
« Ah, il était bien fini le temps où les livres servaient à répartir les gens sur une échelle. Plus personne à présent n’avait lu de livres. C’était la démocratie. Par le passé, les écrivains avaient été habiles à créer leur petit système, où les gens qui avaient lu des livres étaient les meilleurs et ceux qui n’avaient rien lu, les médiocres. A cette époque-là on pouvait dégoiser, s’étirer, prendre le thé et quasiment se déshabiller devant les caméras simplement parce qu’on avait dans la tête quelques centaines de livres.
Oui, ce temps était révolu. A présent, les choses étaient plus honnêtes : les personnes qui étaient posées devant les caméras avaient quelque chose de plus solide à montrer : une robe, une nouvelle poitrine, une médaille d’or, un tableau de statistiques, un grand-père incestueux, une erreur de chirurgie esthétique. Elles ne venaient pas pour faire des combats de coqs et de petits chefs. Elles venaient simplement montrer. Ensuite, pour être agréable, on pouvait les faire parler de leur quotidien ou des choses qui naissaient instantanément dans leurs esprits.
Les gens du passé étaient de pauvres gens. Ils ne voyaient pas la réalité en face. Ils s’enfermaient dans des carcans de mots écrits ou dits par des personnes qui n’étaient plus que des os blanchis. Il fallait s’échiner des années et des années avant d’avoir suffisamment de stocks dans la tête pour se sentir capable de s’exprimer pour les caméras. Et l’exercice était ardu : savoir ouvrir ses tiroirs au bon moment pour en sortir les bonnes citations ; ne pas faire de fautes de grammaire ; ne pas mélanger les concepts ; ne pas juger selon son bon sens ou ce que l’on avait sous les yeux, mais faire appel aux os de Ni-Psé ou de Ali Strore, qui savaient tout mieux que tout le monde : cela n’était pas à portée du premier venu.
Par bonheur, oui, ce temps était révolu. Jenna s’en réjouissait. Elle n’aurait pas pu être écrivaine à une telle époque. A présent, elle n’avait pas besoin d’emporter une valisette mentale dans les émissions et de la remplir anxieusement à grand renfort de livres. Il lui suffisait d’être présente avec son bon grain de jugeotte. De plus, avoir de la jugeotte n’était pas vraiment nécessaire. Il se trouvait quantité de people, d’acteurs, d’actrices et de sportifs disant n’importe quoi à n’importe quel moment devant les caméras. Ils étaient même les chouchous du public. Le public s’y connaissait. Le public avait de l’affection pour les caractères francs.
Le mari de Jenna, dans cette catégorie, était très très fort. Il était le champion des livres sans concepts. Il avait réussi à oublier tous les livres qu’il avait encore dû lire à l’école, du temps de l’ancien système. À présent, son cerveau était en flux direct avec la mémoire vive. Jenna n’avait aucune idée de ce qu’il y avait dans ses livres, mais elle était sûre qu’ils brûlaient comme des rivières de jeune lave qui n’était pas aveuglante. »
Un monde d’uniformité
Ce roman de Noëlle Revaz est une critique également de notre monde d’immédiateté, dont les tablettes numériques en constituent un reflet.
« Il y avait de cela longtemps, à leur sortie de l’école, Eden Fels et Jenna Fortuni avaient été des jeunes gens cultivés. Du moins avaient-ils fait des efforts en ce sens. À présent, tout cela était démodé et Jenna n’était plus cultivée. Comme tout le monde, elle avait toujours sur elle son écran, sur lequel elle pouvait à tout moment vérifier ce qu’elle avançait et grâce auquel, en deux minutes, elle en savait dix fois plus que le prix Moebel. Le mari de Jenna non plus ne savait rien du tout, à part composer des œuvres d’art, ce qui était bien l’unique chose qui ne serait jamais obtenue d’un écran et par conséquent la seule activité qui en valait la peine.
Les écrans, de l’avis de Jenna et de son mari, étaient une excellente chose. De la sorte il n’était plus besoin de perdre son temps à se bourrer la tête et les nerfs avec des concepts. Tout était à présent partout. Tout était donné sur-le-champ. Il n’y avait qu’à s’épanouir et profiter de la vie. »
Même les sorties ou dîners entre amis deviennent impossibles.
« Il était devenu trop pénible de relancer les discussions. Elles mouraient sans cesse. Les convives vérifiaient chaque mot sur leurs écrans ».
Même le cv de l’auteur et sa biographie non autorisée lui sont opposés par un convive inconnu, à l’occasion d’un dîner, se basant davantage sur ces éléments que sur le véritable intérêt d’une conversation (d’où l’intérêt des « listes d’amis », mais je ne vous en dis pas plus…).
Je ne vous ai présenté là que le tout début.
Le livre recèle de nombreuses autres surprises (même s’il souffre peut-être d’un peu de longueurs au bout d’un moment)… que je vous laisse la joie de découvrir.
- Noëlle Revaz, L’infini livre, ZOE Éditions, août 2014, 322 pages.



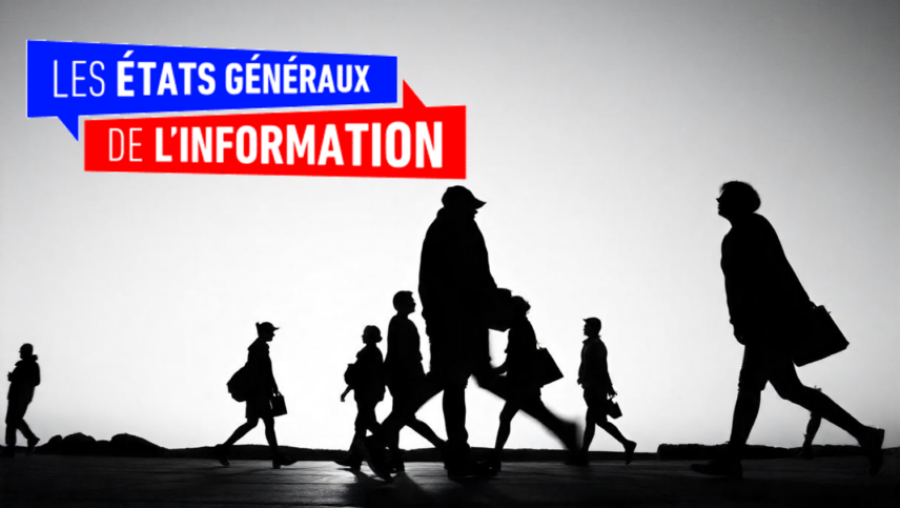

Laisser un commentaire
Créer un compte