L’individualisme défendu par le libéralisme exige de l’État de laisser faire et de laisser être. Il lui demande une abstention de sa part pour que les personnes soient et fassent ce qu’elles estiment le mieux pour leur vie. L’État ne doit ni définir ni concéder l’identité, mais seulement la reconnaître.
La plupart des gens sont d’autres personnes. Leurs pensées sont les opinions des autres, leurs vies sont des imitations, leurs passions une citation. — Oscar Wilde
Si j’avais à choisir entre trahir mon pays et trahir mon ami, j’espère que j’aurais les tripes de trahir mon pays. — Edward Morgan Forster
Nous pouvons vivre ensemble sans être d’accord sur les valeurs. — Kwame Anthony Appiah
Ubi bene ibi patria. — Cicéron
À Istanbul, on peut voir Michal Elia Kamal chanter en hébreu dans la populeuse avenue İstiklal. Cette Israélienne est accompagnée du guitariste français Julien Demarque et d’un joueur de santour, le turc Mete Ciftci. Elle sait ce que multiculturalisme veut dire. Non pas parce que son groupe, Light in Babylon, correspond au cliché que l’on accole généralement à la World music, mais parce que la question de l’identité s’est présentée très tôt à cette fille de parents iraniens réfugiés en Israël, qui fuyaient la république islamique. Quand un jour, les services sociaux israéliens insistèrent pour que la jeune Michal soit élevée en hébreu à la maison. Et que la famille abandonne définitivement les us et coutumes persanes afin d’assurer au maximum son intégration. Ce qui choqua fort les parents, très fiers de leur culture millénaire. Même si leur fille avait déjà remplacé le tapis mural de sa chambre par des posters de chanteurs en vogue. Ou aurait volontiers échangé la traditionnelle cuisine maternelle contre un hamburger ou des escalopes viennoises, qu’elle voyait avec envie dans la boîte à manger de ses camarades d’école.
À partir de quand considère-t-on que l’on est intégré dans une société ? Quelles conditions faut-il remplir pour être pleinement accepté dans une communauté ? En 1990, le conservateur britannique Lord Tebbit proposa bien le fameux « test du cricket » : on ne peut être accepté comme Anglais qu’à condition de supporter l’Angleterre au jeu de cricket. Mais cette « preuve » n’induit-elle pas un schéma d’exclusion ? N’impose-t-elle pas une exigence non nécessaire et injuste aux immigrants, rendant l’intégration plus difficile à atteindre ? Pour reprendre la question que se posait Kwame Anthony Appiah dans son livre Pour un nouveau cosmopolitisme : comment pouvons-nous vivre ensemble ? Comment pouvons-nous doter les esprits et les cœurs, qui se sont si longtemps développés au sein de groupes différenciés, de notions et d’institutions qui leur permettront de cohabiter paisiblement dans un contexte de globalisation et d’enchevêtrement sans précédent de gens, de peuples et de pays ?
Cette réflexion remonte au cosmopolitisme des stoïciens, bien que cette notion ait surtout connu son apogée chez les philosophes des Lumières. Toutes les cultures possèdent, dans leur échelle de valeurs, suffisamment de points communs pour pouvoir entamer une conversation. La règle d’or est que nous devons respecter et prendre en compte les intérêts des autres, afin de trouver dans cette ouverture sur l’autre et le respect de ses valeurs une voie alternative à la différence essentialiste et au choc des cultures. Cependant, le cosmopolitisme d’antan et le multiculturalisme d’aujourd’hui ont toujours été marqués par une certaine appréhension voire un certain scepticisme. Actuellement, ces difficultés sont essentiellement liées à la persistance néfaste de l’idéologie nationaliste et à sa théorie fausse de l’identité.
Dans son livre de conversation avec Isaiah Berlin, En toutes libertés, Ramin Jahanbegloo demandait à ce dernier si le nationalisme était dangereux pour la démocratie. « Bien entendu, répondait le philosophe, il est dangereux pour tous. » Car dès que l’on invoque une autorité impersonnelle comme la nation, le chemin de l’oppression reste toujours ouvert. Les pays occidentaux – et probablement tous les pays – ont été plus libéraux dans leurs habitudes de consommation que dans leurs désirs politiques, ce qui fait que les gouvernements, au moment de justifier leur corruption ou leur mauvaise gestion, cèdent régulièrement aux sirènes du nationalisme.
La mystique du discours identitaire
Pour Elie Kedourie, l’un des plus perspicaces analystes de cette idéologie, celle-ci serait née comme doctrine déviante de la théorie kantienne de l’autodétermination de l’individu libre. Fichte, quant à lui, remplaça cette idée par la thèse de l’autodétermination des nations, entités qui donneraient à l’individu sa propre identité. Johann Gottfried von Herder compléta cette notion avec sa fervente défense des cultures et des langues comme fondement de la nation. Ernest Gellner, théoricien de la modernité, professeur et collègue de Kedourie à la London School of Economics, ironisait : « Les prophètes du nationalisme ne sont jamais montés en première division en matière de pensée. » Car il est vrai que le nationalisme a plus à voir avec l’instinct et la passion qu’avec l’intelligence. Sa force n’est pas dans les idées mais dans les croyances et dans les mythes. Pour cette raison, on le retrouve davantage aux côtés de la littérature et de la religion que de la philosophie ou la science politique. Et pour le comprendre, les poèmes, les romans et même les grammaires peuvent être plus utiles que les études historiques et sociologiques.
Comme l’explique Mario Vargas Llosa, le point de départ de toute doctrine nationaliste est un acte de foi et non pas une conception rationnelle et pragmatique de l’histoire et de la société. Un acte de foi collectiviste qui imprègne une entité mythique – la nation – d’attributs transcendants, capables de rester intangibles dans le temps, imperméables aux circonstances et aux changements historiques, préservant cohérence, homogénéité et unité de substance parmi ses individus et éléments constitutifs, bien que, dans la contingence, cette unité soit invisible et appartienne au domaine de la fiction. Friedrich Hayek écrivait dans La route de la servitude que les deux plus grands dangers pour la civilisation étaient le socialisme et le nationalisme. Avec le collectivisme, l’essentialisme métaphysique est l’ingrédient central du nationalisme. Pour cette doctrine, les individus n’existeraient pas séparés de la nation, placenta maternel qui déterminerait leur être. L’identité nationale – mot clé de la rhétorique nationaliste – leur donnerait socialement, culturellement et politiquement vie. Elle se manifesterait au travers d’eux dans la langue qu’ils parlent, les coutumes qu’ils suivent, les vicissitudes d’une histoire qu’ils partagent. Egalement dans certains cas, dans la religion, l’ethnie ou la race à laquelle ils appartiennent. Ou même la conformation du crâne et le groupe sanguin dont Dieu ou le hasard a bien voulu les doter.
Être nationaliste, c’est croire qu’on ne peut être soi-même de manière complète si on ne peut parler sa « langue nationale », transmettre les « traditions nationales » à ses enfants et sauvegarder, au travers de la politique, l’« identité nationale » du peuple auquel on appartiendrait. Dans sa meilleure version, le nationalisme défend l’idée que les individus ont besoin d’un foyer national pour prospérer et transmettre ce qui leur semblent être de quelque valeur. Dans sa pire version, il se transforme en prétexte xénophobe qui justifie le refus de partager son foyer avec quiconque diffère de nous, sous couvert d’incompatibilité identitaire.
Nous savons ce qu’est un État, ce qu’est une culture. Mais nous ne savons toujours pas exactement ce qu’est une nation. Un État et une culture ? Plusieurs États et une culture, à l’instar des pays européens ? Un État et plusieurs cultures, comme les États-Unis ou la Russie ? Le nationalisme essaie de se fonder sur quelque chose d’inévitable. Chaque personne reçoit une éducation, celle de la famille, de l’école, d’un groupe. Chaque personne a besoin d’être reconnue, d’appartenir, de partager un destin commun. Mais est-ce suffisant pour définir la nation, étymologiquement « ceux qui sont nés ensemble ». Contrairement aux croyances populaires et même académiques, le nationalisme n’a pas de racines si profondes dans la psychologie humaine. Ernest Gellner, dans Nations and Nationalism, montre que c’est le nationalisme qui engendre les nations, et non l’inverse. En effet, les nations ne constituent pas une version politique de la théorie des classes naturelles. Les États nationaux ne sont pas plus l’évident destin final des groupes ethniques ou culturels. Gellner rappelle que la grande majorité des groupes nationaux en puissance (on parle de plus de 8 000 langues sur Terre) ont renoncé à lutter pour que leurs cultures homogènes disposent du périmètre et de l’infrastructure nécessaires pour atteindre l’indépendance politique. Bien que présentée par ses thuriféraires comme une antique force, cachée et vivant en léthargie, le nationalisme ne serait que la conséquence de la nouvelle forme d’organisation sociale apparue au 19e siècle, dérivée de l’industrialisation et d’une division complexe du travail. Le nationalisme, produit typique de la société industrielle, utiliserait de manière sélective la préexistante prolifération de cultures au sein d’un pays et transformerait ces dernières de manière radicale et artificielle, en ressuscitant des langues mortes, en inventant des traditions et en restaurant des factices puretés parfaites. Pour Durkheim également, toutes les idéologies collectivistes, comme le nationalisme, résultent de la disparition des hiérarchies traditionnelles et des ordres de la vie sociale, suite à la centralisation et à la rationalisation bureaucratique que réclamait le progrès industriel.
Comme cette nation homogène, pure, culturelle et ethnique, et parfois religieuse n’existe pas, le nationalisme est obligé de la créer et de l’imposer dans la réalité. La seule façon de l’obtenir, c’est par la coercition. En partant de la mélancolie. L’écrivain et essayiste Jon Juaristi milita longtemps au sein du nationalisme basque. Il fut même membre du groupe terroriste ETA. Dans son livre El bucle melancólico, il décrit la mélancolie comme le regret de ce qui n’a pas existé, un état d’âme de féroce nostalgie de quelque chose de disparu, splendide, qui conjuguait bonheur et justice, beauté et vérité, santé et harmonie : le paradis perdu. Le fait que celui-ci – la nation – n’ait jamais été une réalité tangible n’est pas un obstacle pour les êtres humains. Dotés de ce terrible et formidable instrument qu’est l’imagination, ils finissent par le fabriquer. Ce que Juaristi appelle mélancolie, impulsion initiale dont se nourrit le nationalisme, Karl Popper le définissait comme la soumission à l’appel de la tribu, ou résistance enfouie dans les êtres humains à la responsabilité d’assumer les obligations et les risques de la liberté individuelle, de même que la stratégie de la fuir, sous couvert de catégories grégaires ou d’êtres collectifs (nation, race, classe ou religion).
Les nationalistes romantiques croyaient au mythe de l’unicité des cultures. Ils pensaient, avec Herder, que chaque langue donnait forme à une vision du monde absolument différente des autres. Les études de linguistique, de littérature et de folklore comparés ont rapidement détruit l’illusion de l’originalité. Le folklore est la plus universelle des manifestations de la culture. Les langues et les cultures particulières ne représentent que des variantes phénoméniques de structures profondes de l’esprit qui sont les mêmes sous toutes les latitudes. Toutes les cultures paysannes se ressemblent. L’identité paysanne est transversale. Elle traverse les frontières géographiques et linguistiques. De fait, aux origines du nationalisme, les paysans furent les plus rétifs à se laisser gagner par cette idéologie. On assistait fréquemment à des situations absurdes. Des intellectuels urbains de classe moyenne qui balbutiaient à peine les langues ou dialectes vernaculaires se déguisaient en paysans et partaient prononcer des harangues patriotiques dans des villages éloignés, devant une assistance indifférente, froide ou même remplie de rancœur. Le grand spécialiste de la paysannerie française Eugen Weber a démontré que la « nationalisation » des paysans constitue historiquement un phénomène très postérieur au triomphe du nationalisme. D’un autre côté, l’arrivée en masse de paysans dans les mouvements nationalistes était un indice sûr de la déstructuration des communautés rurales.
Aujourd’hui, le nationalisme n’est plus si univoque, ni orienté vers l’extrême-droite comme autrefois. Il est devenu un animal prolifique, protéiforme et insaisissable qui adopte des comportements divers et contradictoires. Une des plus grandes difficultés pour l’aborder réside dans le fait que cette doctrine protoplasmique se reproduit sous des apparences diverses, bien qu’à la racine cette diversité se rejoigne sur quelques traits, notamment en ce qui concerne l’identité et la différence. Le narcissisme différentiel du nationalisme est un problème de mauvaise foi. Les véritables différences qui séparent des groupes ethniques ou religieux, spécialement quand il existe des mariages mixtes, sont très souvent minimes. Les idéologues nationalistes tendent à exagérer ces différences mineures en différences importantes, afin de mobiliser leur peuple contre les autres. Ainsi, le nationalisme se transforme en une forme de kitsch, magnifiant toute petite particularité folklorique et niant toute similarité avec les autres cultures.
La raison plutôt que l’identité
Néanmoins, la question de l’idée d’identité reste entièrement posée. De fait, on peut difficilement mettre en doute son importance. C’est pourquoi on ne peut faire l’impasse sur le sujet, ni laisser le nationalisme monopoliser cette problématique. Bien entendu, l’identité la plus large que l’on puisse posséder est celle que nous partageons avec l’ensemble des êtres humains. La caractéristique commune permettant à tous ceux-ci de vivre ensemble est le Droit naturel. Mais il faut bien se rendre à l’évidence : nous vivons d’abord en groupe. Se posent donc plusieurs questions. Est-il nécessaire que notre identité soit précisément liée à un groupe ? Pourquoi pas plusieurs groupes ? Avec lesquels on s’identifierait alternativement ou simultanément, d’une manière ou d’une autre. Une sorte d’identité plurielle, selon le modèle analysé par le philosophe et prix Nobel d’économie Amartya Sen. Choisissons-nous notre identité ou la découvrons-nous au sein de l’identité du groupe ou d’une pseudo « identité nationale » ? Comment devons-nous prendre en compte les exigences d’autres personnes – pas seulement celles de notre groupe – pour déterminer ce qui serait un comportement acceptable ou raisonnable, au-delà de l’identité ?
Le fait de naître dans un pays ou au sein d’une culture particulière n’élimine pas la possibilité d’adopter une perspective ou une loyauté qui diffère grandement du gros de la population de ce pays ou de cette culture. Un individu peut se considérer Européen et non pas seulement Français. Ou Irlandais tout court et pas seulement catholique irlandais ou protestant irlandais. Ou à l’époque de l’Internationale socialiste, se définir comme ouvrier plutôt qu’allemand ou britannique. Ou pour une lesbienne milanaise, se sentir plus proche d’un habitant de San Francisco que d’un macho palermitain. Ou pour le fils d’un immigré marocain, ne ressentir aucune affinité particulière avec le Maroc ou la Belgique, mais s’identifier complètement avec les Bruxellois avec lesquels il vit au quotidien. Avec des définitions plurielles, les identités alternatives peuvent entrer en concurrence selon le contexte donné. De même, la relation d’une personne avec un pays ne doit pas nécessairement passer par la culture de la famille au sein de laquelle elle a grandi. Une personne peut décider de rechercher et définir son identité auprès de plus d’une des cultures préalablement définies, ou même auprès d’aucune.
À l’inverse, les conceptions nationaliste et communautariste font de l’identité commune une affaire de réalisation personnelle et non de choix, comme s’il s’agissait non pas de relations choisies, mais de lien qui serait découvert. Non pas un simple attribut, mais un élément constitutif de l’identité. Amartya Sen a réfuté cette vision identitaire dans son article « Reason Before Identity », publié en 1998 dans The Romanes Lecture à Oxford. Pour lui, les identités collectives ne peuvent pas être placées au-dessus des décisions individuelles et de la liberté personnelle pour définir une identité propre. En effet, il est difficile d’imaginer que nous ne pouvons pas réellement faire un choix substantiel parmi des identités alternatives, que nous ne faisons simplement que « découvrir » notre identité au travers de l’identité du groupe. Cela ne signifie pas que n’importe quel choix que nous faisons doit être définitif et permanent. Une oscillation entre divers choix est une qualité continue et précieuse. Le choix est possible et important dans la conduite individuelle et dans les décisions sociales. Même si nous n’en sommes pas toujours conscients.
Certes, les options réelles que nous avons par rapport à notre identité sont toujours limitées par notre aspect, nos circonstances, notre passé et l’histoire. Cependant, reconnaître cela n’équivaut pas à transformer l’identité en une affaire de découverte, ni admettre le primat du groupe sur l’individu. Dans la théorie économique des préférences du consommateur, l’existence d’un budget – qui est évidemment une limite – ne signifie pas que l’on ne puisse choisir, mais qu’il faut choisir en tenant compte de notre budget disponible. Le problème n’est pas si nous pouvons choisir n’importe quelle identité (ce qui serait absurde), mais si nous avons la possibilité de choisir entre des identités alternatives ou des combinaisons d’identités. Et, ce qui est plus important, si nous avons la liberté suffisante pour décider de la priorité à donner aux diverses identités que nous pouvons posséder simultanément.
La croyance selon laquelle nous n’avons pas le choix dans ce domaine n’est pas seulement fausse, mais peut également avoir des conséquences très pernicieuses. Si les possibilités de choix existent et que, malgré tout, on considère que ce n’est pas le cas, l’usage de la raison serait remplacé par une acception sans critique d’un comportement conformiste, même le moins désirable. De fait, les inégalités traditionnelles, comme le traitement des femmes dans les sociétés sexistes, survivent en grande mesure grâce au fait que les identités respectives, qui peuvent inclure des fonctions serviles, se transforment en affaire d’acceptation inconditionnelle et non d’analyse réfléchie. Peut-être serait-il utile de rappeler que nombre de lecteurs anglais de L’assujettissement des femmes de John Stuart Mill, publié en 1869, virent dans ce livre la preuve ultime de l’excentricité de ce dernier. Dans New and Old Wars: Organised Violence in a Global Era, Mary Kaldor explique que les politiques d’identité surgissent du vide créé par l’absence de projets futurs. À la différence de la politique des idées, qui est ouverte à tous et, par conséquent, tend à intégrer, ce type de politique d’identités est intrinsèquement excluant. Pire encore, nier la possibilité de choisir et le raisonnement dans l’identité peut conduire à la répression, à la violence, à la brutalité. C’est ainsi que Jonathan Glover, dans Humanity : A Moral History of the Twentieth Century, montre comment nombre des atrocités commises dans le monde sont le résultat de ce que les gens se sentent obligés d’agir d’une manière particulière, en accord avec l’identité qu’ils croient avoir. Ce qui inclut parfois de punir ceux qui appartiennent à un groupe qui maintient une relation hostile avec le leur.
Mais, rétorqueront les théoriciens nationalistes et communautaristes, comment pouvons-nous raisonner, si la manière dont nous pensons doit être indépendante de notre identité ? Nous ne pouvons réellement raisonner si nous n’établissons pas préalablement notre identité. Rien de plus faux pour Amartya Sen. Bien sûr, personne ne peut raisonner dans le vide. L’alternative à la « découverte » de son « identité nationale » n’est pas le choix à partir de positions non conditionnées par quelque identité que ce soit, mais réside dans la possibilité de choisir qui continue d’exister dans chaque position conditionnée que chacun occupe. Le choix ne peut certes pas se faire en effectuant un saut du néant vers quelque part. Mais il n’en découle pas pour autant que nous ne pouvons réfléchir qu’au sein d’une tradition culturelle particulière, avec une identité spécifique. Même si certaines attitudes et croyances culturelles peuvent influencer notre manière de penser, il est peu probable qu’elles la déterminent entièrement.
Nous touchons là aux fondements mêmes du libre arbitre et du libéralisme. Il est vrai que la culture au sein de laquelle nous naissons et grandissons peut laisser des traces durables dans nos perceptions et prédispositions. Cela ne signifie pas pour autant qu’une personne soit incapable de modifier ou même rejeter les associations préalables. Il est difficile d’accepter que nous ne pouvons pas réellement choisir entre diverses identités, que nous ne pouvons que « découvrir » une espèce d’identité fondamentale. Souvent, choisir est une opération implicite et obscure mais qui n’en est pas moins réelle. Par ailleurs, les identités que nous choisissons n’ont pas de raison d’être définitives ni permanentes. Nier la possibilité de choisir n’est pas seulement une erreur épistémologique. Cela peut également entraîner un échec moral et politique. Car ce serait abdiquer la responsabilité propre pour affronter la question socratique fondamentale « Comment dois-je vivre ? » Choisir est inévitablement associé à la responsabilité.
Diverses influences modèlent notre raisonnement. C’est pourquoi nous ne devons pas perdre la faculté de considérer d’autres manières de penser seulement parce que nous nous identifions avec un groupe particulier. L’influence n’est pas la même chose qu’une détermination complète. Les possibilités de choix subsistent malgré l’existence et l’importance des influences culturelles. En plus de reconnaître l’importance de la liberté individuelle, il faut tenir compte du fait que les cultures ne ressemblent en rien à un ensemble monolithique, exceptionnellement défini, de comportements et de croyances. Celles-ci n’ont pas de raison de ne comprendre qu’une série unique et définie d’attitudes et de croyances capables de façonner nos raisonnements. De fait, beaucoup de cultures possèdent des variations internes assez considérables, qui peuvent supporter nombre d’attitudes et de croyances différentes en leur sein. C’est bien là le danger le plus grand qui découle du nationalisme et du communautarisme, quand ceux-ci immergent la diversité d’une culture à l’intérieur d’une vision faussement uniforme, refusant aux membres de la communauté déjà installés ou aux nouveaux arrivés la liberté d’adopter leur propre point de vue et former leurs propres interprétations des contenus de leur culture.
Personne ne présuppose que parce qu’elle serait née française ou issue d’un milieu catholique ou d’une famille conservatrice ou aurait été éduquée dans une école religieuse privée, une personne devrait inévitablement penser et raisonner selon les attitudes et les croyances générales de ces groupes respectifs. Cependant, d’aucuns semblent percevoir les limites imposées par d’autres cultures comme si elles étaient plus obligatoires ou restrictives. Quelle preuve y a-t-il que les personnes nées dans une tradition non occidentale manqueraient d’aptitude pour développer une autre identité ? Quelle que soit l’importance de la perception de la communauté et de l’identité, on ne peut supposer que la possibilité du choix raisonné devrait être écartée à cause de leur influence. La possibilité de choisir existe. Celle de raisonner également. Rien n’enferme plus l’esprit qu’une fausse croyance en la privation inaltérable du libre arbitre et l’impossibilité du raisonnement.
Les différents groupes peuvent appartenir à la même catégorie et fonctionner selon le même type d’incorporation (comme la nationalité), ou bien appartenir à des catégories distinctes (classes sociales, genre, profession, etc.) Dans le premier cas, il existe une certaine rivalité quant à l’appartenance, mais pas dans le second. Négliger nos identités plurielles au profit d’une identité « principale » peut beaucoup appauvrir nos vies et notre sens pratique. Rejeter a priori d’autres cultures nous appauvrit en limitant nos identités possibles. Nous pouvons également posséder des identités plurielles même à l’intérieur de catégories qui rivalisent entre elles. Dans l’identité d’une personne, une nationalité rivalise en termes élémentaires avec une autre nationalité. Mais cela n’engendre pas forcément une situation conflictuelle, comme on peut le voir chez nombre de personnes possédant une double nationalité. La pluralité des identités rivales et non rivales non seulement n’est pas obligatoirement contradictoire, mais fait partie intégrante de la manière dont se perçoivent les immigrants et leurs familles.
Les théories et les politiques identitaires défendues par les nationalistes et les communautaristes démontrent leur absurdité et leur limitation en présupposant qu’une personne ne peut appartenir qu’à un seul groupe ou communauté préexistant qui la détermineraient. Tous les jours, l’expérience montre que l’on peut être allemande, féministe, végétarienne, romancière, conservatrice en matières fiscales, fanatique de jazz et londonienne. Ou Algérien, juif, ayant la double nationalité française, vivant dans l’État de Washington, homosexuel, ingénieur informatique, peintre et croyant dur comme fer à l’existence d’extra-terrestres. Ou même être musulman intégriste et djihadiste, et aimer les films de Robin Williams. Chacun de ces groupes donne à la personne une particularité susceptible de la différencier dans des contextes particuliers. Une personne appartiendra toujours à beaucoup de groupes. Et son identité sera toujours plus riche et complexe que celle de n’importe quel groupe auquel elle adhère volontairement ou non. Le supposé erroné d’une identité unique ne fait qu’ouvrir la voie à ce qu’Anthony Appiah appelle l’impérialisme de l’identité. Il n’y a pas de raison réelle pour se laisser enfermer dans une prison d’identités limitées, ou pour être coincé dans une contradiction imaginaire entre la richesse du passé et la liberté du présent. C’est pourquoi la conception alternative d’une société de personnes d’origines diverses, qui ont la liberté de choisir leur propre identité permettra d’éviter les nouvelles tyrannies qu’Appiah redoute.
Le multiculturalisme n’est pas un relativisme
Cependant, même après avoir concédé la reconnaissance due à l’identité plurielle et au choix d’identité, il faut considérer les réclamations des autres personnes qui ne partagent pas notre identité. Les exigences de justice, de morale et d’éthique n’adoptent pas la forme d’une identification avec toutes les personnes mais considèrent les intérêts et les réclamations de tout le monde sans attacher d’importance au fait de savoir si l’on s’identifie ou non. Dans l’empathie avec les autres, il existe deux usages distincts de l’identité. Le premier est un usage épistémologique, où l’on se met à la place des autres et on essaie de savoir ce qu’ils ressentent. Le second est un usage éthique, où l’on considère les autres comme étant égaux à nous. Le raisonnement centré sur l’identité peut occuper une place dans la pensée morale et politique. Mais il n’occupe pas tout l’espace de l’éthique rationnelle. Il est essentiel de reconnaître que les identités peuvent être plurielles et que les priorités que nous attribuons à nos identités diverses nous concernent, mais aussi que l’inclusion morale et politique dépasse le domaine de l’identité. C’est pourquoi il n’y a aucun conflit entre l’acceptation complète du fait que la population d’une société multiculturelle contemporaine comme la société française soit un mélange pluriethnique et la conviction de ce que les cultures traditionnelles française et occidentale garantissant les libertés fondamentales et les droits naturels de groupes différents puissent être considérés comme supérieures à toute autre chose qu’ont ou auraient pu apporter les immigrants. Car contrairement au nationalisme et au communautarisme, le multiculturalisme n’est pas un relativisme.
En effet, le multiculturalisme, loin d’être la caricature que veulent en faire ses opposants afin de plus facilement pouvoir le dénigrer, ne demande pas, suivant une sorte de stratégie écologiste, la conservation à tout prix de la diversité culturelle. Il ne lutte pas contre la disparition des cultures. De fait, l’histoire entière de l’émancipation humaine est la critique pratique de la conviction selon laquelle l’existence d’une société est une raison suffisante pour que celle-ci continue d’exister. Dans System der subjektiven öffentlichen Rechte, publié en 1892, le professeur de droit public autrichien Georg Jellinek analysait ce mode de pensée qu’il appelait le « pouvoir normatif du factuel ». Il faisait référence à la tendance chez l’être humain d’assigner une autorité normative à l’état des choses existant actuellement. Les êtres humains font cela, argumentait-il, parce que leur perception des choses est formée par les forces exercées par ces états des choses. Attrapés dans cette circularité herméneutique, ils ont très vite tendance à passer de l’observation de ce qui existe à la présomption que cet état des choses est normal. Et partant, qu’il doit être renforcé par une nécessité éthique. Cependant, on constate que dès qu’un changement ou un bouleversement se produit, les hommes s’adaptent très rapidement aux nouvelles circonstances, assignant à la nouvelle situation la même qualité normative qu’ils avaient perçue dans l’ordre des choses précédant. À l’opposé du nationalisme et du communautarisme, le multiculturalisme évite de confondre point de vue culturel et point de vue moral. La disparition d’une culture est, par définition, une perte culturelle, mais cela n’implique pas obligatoirement une perte morale, ni qu’il faille s’en attrister . Les sociétés esclavagistes, fascistes ou soviétiques ont disparu. Qui s’en plaindrait ?
Le multiculturalisme ne cautionne pas plus cette sorte de principe d’incommensurabilité qui ferait que l’on ne pourrait pas comparer les sociétés et les cultures, qu’il n’y aurait pas de forme de vie meilleure qu’une autre. Outre le problème épistémologique de récursivité qui nierait tout universalité à ce principe, l’histoire démontre empiriquement qu’il existe bien des sociétés supérieures à d’autres. Vouloir une société plus tolérante aux autres cultures ne nie pas ce fait. Le multiculturalisme rejette de même cet idéal démocratique dévoyé qui voudrait que toutes les opinions soient respectables et se vaillent. Outre le même problème de référencement circulaire qui induit des paradoxes logiques, il faut pointer la confusion : le multiculturalisme, à l’instar du libéralisme, exige de respecter les individus, pas leurs opinions.
Une autre approche des cultures que réfute le multiculturalisme est ce trait psychologisant qui voudrait protéger celles-ci afin de défendre la capacité des individus à se développer, considérant comme une agression envers les personnes la disparition d’une culture. Certes, on ne peut nier que les individus ont besoin de faire partie d’un groupe, de groupes, qui leur fournissent des modèles de comportement. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’il faille défendre à tout prix l’existence de tel ou tel groupement déterminant tel ou tel aspect de l’identité. Les bandes de hooligans sont de très bons pourvoyeurs d’identité forte. Faut-il, pour cette raison, les protéger envers et contre tout ? Ce qui importe, c’est d’assurer aux individus les conditions pour qu’ils puissent analyser de manière critique leur communauté. C’est pourquoi personne ne peut décemment prétendre qu’une femme musulmane qui abandonne l’islam bloquerait son développement personnel. Enfin, le multiculturalisme refuse de cautionner la vision conservatrice selon laquelle les cultures devraient faire l’objet d’une protection parce que toutes auraient une valeur en soi. Si cette position était vraie, il faudrait, par exemple, subsidier les religions qui perdent des fidèles, ou il serait juste de sacrifier les droits fondamentaux d’individus pour protéger des cultures qui empêchent les gens de cohabiter librement, ou qui pénalisent les femmes qui n’arrivent pas vierges au mariage. Cette vision abusivement anthropomorphique des sociétés est, bien sûr, moralement intenable et complètement fausse. Ce sont les gens qui souffrent, aiment et rêvent, pas les sociétés.
Laissez faire, laissez passer, laissez être
L’appartenance à un groupement humain doit se fonder sur la libre décision de s’organiser en suivant des processus abstraits et ouverts. La seule manière pour un libéral d’adhérer à l’idée de nation, c’est de se rappeler que celle-ci n’est pas la concrétisation déterministe d’une loi historique inexorable. Elle n’est qu’un processus évolutif qui se traduit par une libre association politique d’individus sur un territoire donné. Les frontières ne servent qu’à indiquer jusqu’où s’étend la juridiction de l’autorité en charge de protéger leurs droits naturels.
Dans son très beau film La vie des autres, Florian Henckel von Donnersmarck montre comment dans l’ex-RDA les gens n’étaient pas libres de réaliser leur vie, ni d’avoir des espaces de développement personnel, parce que l’État avait décidé qu’ils devaient être de bons citoyens socialistes. L’autorité avait décrété qu’ils ne pouvaient être différents. Ils ne pouvaient pas déterminer par eux-mêmes leur identité, ni avoir le droit de sentir et de s’exprimer comme ils le souhaitaient. Comme on le sait, le libéralisme ne se réduit pas au seul plan économique. La liberté qu’il défend est un principe éthique lié à la dignité de l’homme, qui assure à l’individu le droit d’être considéré comme une personne et non une chose, une fin et non un moyen. Le libéralisme politique se comprend comme la reconnaissance de citoyens qui collaborent à l’édification de la société avec l’aide de l’État, obligeant ce dernier à leur garantir un ensemble de libertés et de droits. Cela suppose une garantie qui s’exprime par une abstention de l’État. Non seulement le classique « Laissez faire, laissez passer » de Gournay, mais également un laissez être. L’individualisme défendu par le libéralisme exige de l’État de laisser faire et de laisser être. Il lui demande une abstention de sa part pour que les personnes soient et fassent ce qu’elles estiment le mieux pour leur vie.
Grâce à ce droit à être, chacun peut librement se construire. L’identité propre que défend le multiculturalisme suppose que l’État laisse les personnes être ce qu’elles veulent être. Ce dernier ne doit ni définir ni concéder l’identité, mais seulement la reconnaître. Et uniquement pour des raisons utilitaires, de registre ou d’identification. Identifier, de manière bureaucratique, n’est pas la même chose qu’octroyer une identité. Car l’État ne fait là que reconnaître une identité politique. Cette dernière, sous le principe général de l’isonomie défendu par le libéralisme, est simple et univoque, contrairement aux sociétés d’Ancien Régime caractérisées par le privilège, où les identités étaient complexes. Dans la société traditionnelle, l’individu se dissolvait dans un faisceau complexe et pluriel de traits distinctifs, tous pertinents à l’heure d’établir obligations et droits, des traits liés à l’appartenance (à une famille déterminée, à un clan, à un statut social, à une confession religieuse), à l’origine ou la résidence et même à la biologie (âge, sexe, état de santé ou pigmentation de la peau). En faisant appel aux arguments philosophiques, ethnologiques, linguistique ou culturels pour définir l’identité, le discours identitaire représente donc une dangereuse régression intellectuelle et politique. C’est pourquoi nationalisme et communautarisme doivent être intellectuellement et politiquement combattus, de toutes les manières possibles, sans complexe, en défense de la liberté.
Le libéralisme est la doctrine qui exalte le plus le principe de liberté. Cela conduit évidemment à un autre principe : la reconnaissance de la valeur de la différence. Si on défend la liberté, ce n’est pas pour que nous soyons tous égaux quant à nos identités. Nous devons être égaux en droit, mais pas sur ce que nous sommes. Nous sommes tous différents ! La liberté suppose donc de faire valoir la différence, l’identité que chacun ressent et exprime. Le problème n’est pas de connaître l’identité pour mieux la conserver mais de garantir la diversité qui se manifeste, parmi nous, par des identités, à la fois sensibles, imprécises et mouvantes. Car, d’une façon ou d’une autre, nous sommes condamnés à la diversité, constante de la vie sociale. Le multiculturalisme, en accord avec l’isonomie, est donc cette voie de la liberté qui permet à un ensemble d’individus de s’octroyer mutuellement des droits et des libertés, sans tenir compte de l’origine, de la couleur de peau ou de l’essence historique. Michal Elia Kamal sait cela. Comme elle sait que les ayatollahs iraniens ne sont ni plus ni moins liberticides que ceux qui prétendent enfermer l’individu dans une identité nationale, ou rejeter celui qui ne se conformerait pas à cette chimère rétrograde. Espérons que Michal verra un jour des femmes chanter en public à Téhéran. Et nous, libéraux, de persévérer dans la voie du « projet suggestif de vie en commun », selon la formule d’Oterga y Gasset et du « plébiscite quotidien » selon les mots de Renan.
___
Lire aussi :
- La France n’appartient pas aux Français, José López Martínez
- Le nationalisme, une insulte à la raison, José López Martínez
- La mondialisation menace-t-elle notre identité ? Emmanuel Martin
- Le nationalisme et l’utopie, Mario Vargas Llosa
- Nations, fictions, Mario Vargas Llosa
Postface
Bosphore
- 2 cl de whisky
- 2 cl de raki
- 2 cl de triple sec
- 2 cl de jus de citron
Frapper les ingrédients dans un shaker avec des glaçons. Servir dans un verre à martini givré en retenant les glaçons. Décorer d’un zeste de citron.


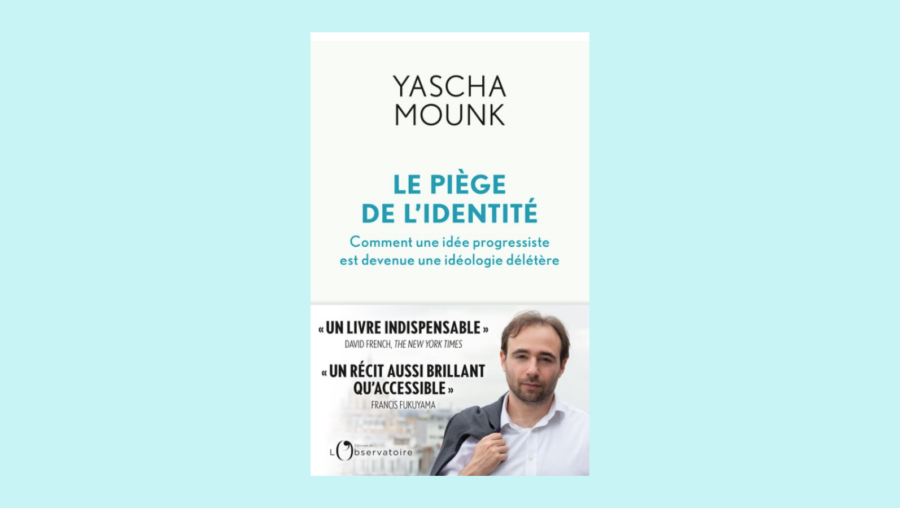

Laisser un commentaire
Créer un compte