Se rappeler d’où viennent les mots peut donner à sourire, et permettre de réfléchir. L’évocation de quelques termes parmi les plus importants de la terminologie fiscale, montre que jamais, il n’a été question, chez ceux qui au cours des siècles ont forgé le sens des mots, de rattacher l’idée d’ « impôt », à celui de « justice ». Tout, dans la terminologie, indique que l’impôt est une expression de la contrainte.
Par Thierry Afschrift, depuis Bruxelles, Belgique.
 Le sens des mots
Le sens des mots
Le sens des mots est rarement un effet du hasard. La manière dont un mot change de sens au cours de l’Histoire n’est pas anodine non plus.
Nous allons voir qu’à propos des mots « impôt », « contribution », et « imposture », et d’une grande partie du vocabulaire fiscal, les mots sont particulièrement révélateurs.
Dans sa signification d’aujourd’hui, le mot « impôt » est traditionnellement défini comme « un prélèvement obligatoire effectué par voie d’autorité par l’État, les Provinces, les communes, sur les ressources des personnes vivant sur leur territoire ou y possédant des intérêts pour être affecté aux services d’utilité générale ». La Cour de cassation de Belgique précise que l’impôt est perçu « sans contrepartie directe », laissant ainsi entendre qu’il pourrait comporter une contrepartie « indirecte ». Dans d’autres définitions, on précise tout simplement que l’impôt est dû « sans contrepartie ». Mais l’essentiel est qu’il s’agit d’une prérogative du Pouvoir : à la différence des sommes payées volontairement à l’État, à titre de redevances pour des prestations spécifiques, l’impôt est perçu par voie d’autorité.
Le mot « contribution » peut paraître à première vue exprimer l’idée d’une « participation » à une œuvre commune, par celui qui « contribue » à une dépense dans un intérêt collectif. On constate toutefois que les multiples termes utilisés par les États pour désigner les prélèvements obligatoires qu’ils pratiquent, sont purement et simplement des synonymes. La « contribution » ne se distingue pas plus de l’impôt, que les taxes, cotisations, droits, retenues, ou autres : les contributions sont simplement des impôts et la multiplicité des termes utilisés résulte sans doute de la tactique de communication utilisée par le pouvoir taxateur, qui peut parfois après avoir promis de ne pas augmenter des impôts, être en droit d’instaurer de nouvelles contributions ou cotisations…
Il est vrai que la définition la plus classique du mot « contribution » évoque, d’une manière qui plaît en général aux gouvernants, l’idée du partage de la dépense commune. On dira alors que la contribution est « ce que chacun donne pour sa part d’une dépense, d’une charge commune » ( ).
On ajoutera toutefois que suit en général une autre définition, dont la portée pour notre propos est fort différente, et que confirme l’étymologie. La contribution est un « tribut que paient les habitants d’un pays occupé par l’ennemi pour se garantir du pillage » ( ).
Quant à l’imposture, elle fait assurément moins partie du vocabulaire fiscal traditionnel, même si nous verrons que cela n’a pas toujours été le cas. Elle se dit de « certaines doctrines destinées à séduire les hommes, à faire secte » ( ).
Quelques observations quant à l’étymologie
Comme tous les États impérialistes antiques, Rome exigeait des populations qu’elle avait vaincues, le paiement du « tributum ». Ceux qui avaient échappé à la mort, aux pillages, et à l’esclavage, devaient payer à l’aerarium, le Trésor public romain, des sommes considérables, qui étaient affectées au paiement des dépenses publiques. C’était l’usage des civilisations antiques, et Rome ne faisait ainsi qu’imiter Alexandre le Grand et bien d’autres souverains, pour qui toute victoire impliquait de « lever des contributions » sur les vaincus. Nous verrons bientôt qu’il en a été ainsi depuis qu’existe la notion même d’État ( ) et sans doute que cette idée n’est guère absente de la fiscalité contemporaine. Et c’est bien sûr de ce « tributum », qui concrétise la soumission des peuples vaincus, qu’est issu le mot latin « cumtributio », qui est devenu en français « contribution ». Ce dernier mot est donc sans rapport avec la participation volontaire à des dépenses communes, mais est, à l’origine, un prélèvement imposé par la puissance victorieuse au peuple défait, pour éviter bien pire.
Quant au mot « fisc », il désignait, à l’origine un petit panier pour presser les raisins. Il désigna par la suite, au sens figuré, le Trésor privé de l’empereur, nourri par la… pression fiscale.
Il exista d’ailleurs à Rome un « fiscal » : il ne s’occupait pas des impôts, mais n’avait guère bonne réputation puisqu’il s’agissait d’un juge qui pratiquait la torture. Le terme est d’ailleurs resté, dans certains pays, comme l’Espagne, pour désigner les magistrats du ministère public.
Le fisc pouvait exiger (« exigere ») le paiement de l’impôt. Le mot « exigere », qui indique la fermeté, lui était, à Rome, strictement réservé. Littéralement, il voulait dire « pousser dehors » soit contraindre par la force à faire sortir un bien du patrimoine du contribuable.
Celui qui procédait matériellement à la perception, qui exigeait le paiement des impôts, était appelé « exactor ». Ce nom, réservé à l’origine au collecteur des impôts, a connu une évolution significative : celui qui exerçait la fonction d’exactor a dû souvent se livrer à ce que nous appelons aujourd’hui des exactions, ce qui montre assurément que sa fonction n’était guère appréciée.
Il faut d’ailleurs dire que le mot « impôt » lui-même, dérive directement d’un terme qui, déjà, supposait l’usage de la force. L’impôt est en effet un dérivé du mot « imponere », qui veut dire, imposer. Aujourd’hui, imposer n’est pas seulement établir un impôt, au sens dérivé, mais, au sens propre, c’est forcer quelqu’un à faire quelque chose, en l’occurrence à payer.
Tout, décidément dans la terminologie, indique que l’impôt est une expression de la contrainte.
Le mot « impôt » a d’ailleurs des dérivés évocateurs, ce qui va nous amener à parler d’imposture. En France, le percepteur des impôts était à l’origine un « imposteur ». Ce terme, qui n’avait rien de péjoratif, était une appellation officielle. Nous savons qu’aujourd’hui, il désigne quelqu’un qui se comporte avec tromperie, et que l’imposture est le mot qui désigne la tromperie elle-même. Pour comble, l’imposteur est aussi le nom d’un poisson, également dénommé… filou.
Le rôle du fisc était naturellement de faire entrer de l’argent, ou des récoltes, dans le Trésor. L’expression de sa force résidait dans son pouvoir de « confiscare », c’est-à-dire de confisquer, soit un terme qui, jusqu’au XVème siècle, ne portait que sur le fait, pour l’État, de s’accaparer sans contrepartie des avoirs appartenant à un contribuable.
Cette évocation de quelques termes parmi les plus importants de la terminologie fiscale, montre que jamais, il n’a été question, chez ceux qui au cours des siècles ont forgé le sens des mots, de rattacher l’idée d’ « impôt », à celui de « justice ». Au contraire, les notions même d’impôt, de tribut, de contribution, et les termes qui désignent ceux qui avaient comme tâche de les lever, renvoient toujours aux notions de puissance et de contrainte.
—-
Extrait de la conférence, L’impôt, contribution ou imposture, de Thierry Afschrift.

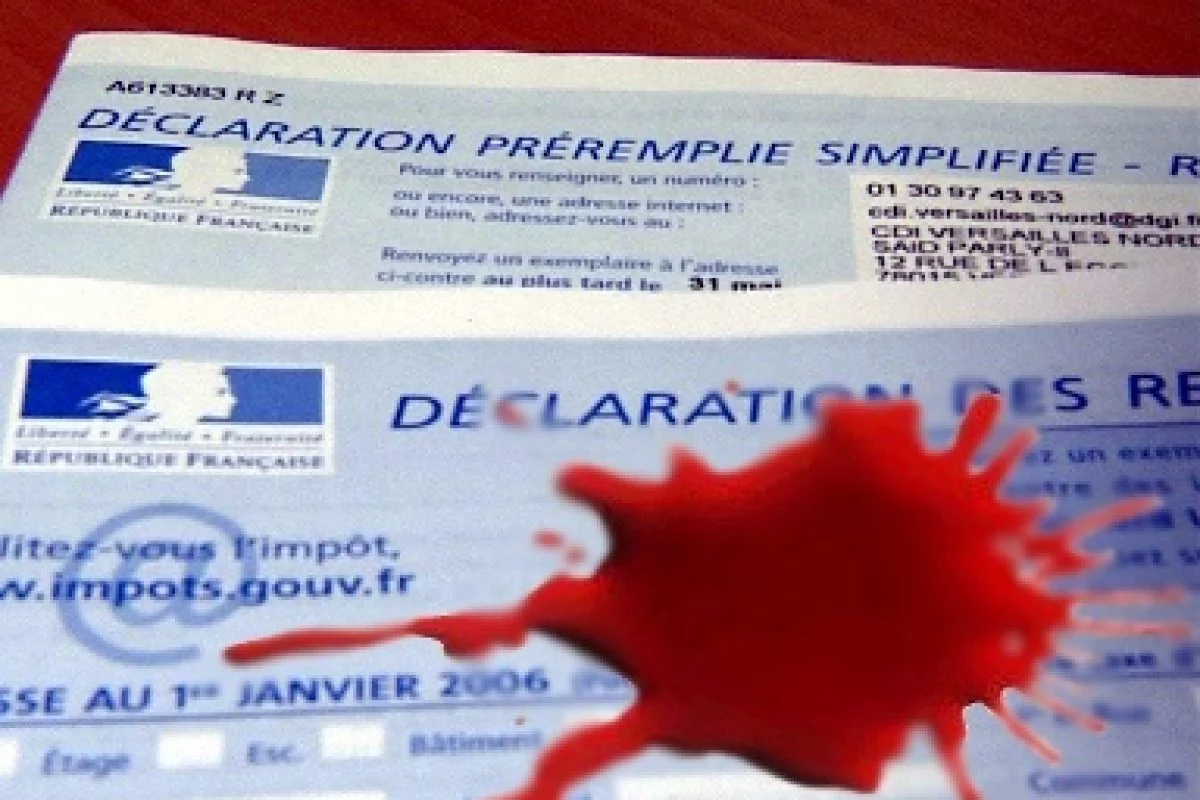



Étymologie de l’impôt http://t.co/LRx5xAme via @Contrepoints
Très intéressant, merci
Etymologie de l’impôt, amusant de voir le sens et l’origine des mots. http://t.co/nUwy0yZT
#etymologiedelimpot
“Étymologie de l’impôt” http://t.co/LkNS8Mbh
“Étymologie de l’impôt” http://t.co/YzyeXshC via @Contrepoints
RT @y_a_rien_a_voir: “Étymologie de l’impôt” http://t.co/YzyeXshC via @Contrepoints
“Étymologie de l’impôt” http://t.co/6zfTFfQA via @Contrepoints
RT @_h16: “Étymologie de l’impôt” http://t.co/LkNS8Mbh
RT @NickdeCusa: Etymologie de l’impôt, amusant de voir le sens et l’origine des mots. http://t.co/nUwy0yZT
#etymologiedelimpot
Excellent article!
Est ce que l’on appelle le Fisc Fucking ?
Articles très intéressants. Merci à leurs auteur !