Les professeurs émérites de sciences économiques de Paris II Panthéon – Assas font paraître la sixième édition d’un ouvrage devenu un classique : Économie Politique Contemporaine (De Boeck, Juillet 2024). Ce manuel, qui est cependant bien plus que cela, mérite largement son succès qui s’accroît au fil des éditions jusqu’à en faire le Graal pour ses auteurs, c’est-à-dire un classique.
S’agissant de la forme et de la présentation, l’ouvrage est simple, attrayant, facile à lire (un défaut pour les cuistres et les prétentieux) et très pédagogique. Les auteurs ne font pas mystère de leurs ambitions qui consistent à s’adresser tant au public cultivé qu’aux étudiants juristes et en sciences humaines, comme à ceux de sciences économiques, tout en séduisant « les chers collègues ». Le pari est tenu. Par un ingénieux système d’encadrés, à la mesure de ses goûts, objectifs et capacités, le lecteur peut déguster chacun des chapitres à la carte. L’astuce pédagogique du « Pour aller plus loin » fonctionne à plein, en particulier pour ceux désirant avoir une vue académique, robuste et sûre de l’analyse économique, mais mal à l’aise avec la formalisation mathématique.
Le plan peut évidemment se discuter. Il peut même dérouter. Mais il a l’irremplaçable vertu de la simplicité et d’une compréhension immédiate. Après un chapitre introductif sur les méthodes de l’analyse économique, trois parties scandent la lecture.
La première s’intéresse aux « Équilibres de marché » (chapitres 2 à 6), la seconde au « Performances économiques globales » (chapitre 7 à 14), pour déboucher enfin sur la troisième partie intitulée « Internalisations des économies » (chapitre 15 à 17).
Les partisans des termes plus traditionnels n’auront qu’à se dire que la première partie traite de la microéconomie, la seconde de la macroéconomie et la dernière de l’économie internationale.
Le style est simple et pourtant savant, compréhensible et pourtant très affuté. La présentation est aérée. Au-delà de la traditionnelle bibliographie, chaque chapitre est doté d’une webographie qui surprendra certains, mais qui se révèle fort utile. L’Index Rerum est particulièrement bien construit. Un Index Nominum serait le bienvenu. Tous les tics à la mode sont évités. De même, il ne s’agit pas d’un simple restylage cosmétique pour justifier une nouvelle édition. Il suffira de savoir que, disséminés et parsemés dans les trois parties, 26 nouveaux thèmes sont abordés, une sorte de record pour une nouvelle édition. On appréciera particulièrement les valeurs ajoutées sur l’économie comportementale, l’effet Cantillon, les cryptomonnaies, la loi de Barro, et dans le chapitre 13, les développements sur la démographie sont particulièrement heureux. Il est assez extraordinaire de constater que les manuels de science économique évincent désormais habituellement complètement le facteur central de la discipline : la science de l’action humaine (ce fut longtemps un cours prestigieux du cursus d’économie illustré par Alfred Sauvy, Luc Bourcier de Carbon, Daniel Villey et tant d’autres.)
À lire aussi :
La roche Tarpéienne est effectivement proche du Capitole : l’exemple emblématique de Charles Bedaux
S’agissant du fond, certains reprocheront à l’ouvrage d’être mainstream, sans particulière originalité, et de s’en tenir à l’état de l’art. Pour faire trop simple la facture néoclassique de l’ouvrage serait son principal défaut. Outre qu’il s’agit d’un manuel dont la fonction est justement de donner en un moment donné l’état de la discipline et les discussions en cours, ce défaut supposé est sa grande qualité. Cet ouvrage est le contraire d’un tract militant déguisé sous un habit académique. À l’éthique de conviction, les auteurs donnent la primauté à la Libido Sciendi. Tout au long des chapitres, l’ouvrage cherche à expliquer, non à endoctriner. Les auteurs pratiquent la démarche académique et savante, et non la persuasion sous des dehors faussement objectifs enchâssés dans des formules prétentieuses et ampoulées.
Bref, pour emprunter à la sociologie, nos deux auteurs sont du côté de Raymond Boudon et évincent les discours tant militants que moralisants et accusatoires à la Pierre Bourdieu. Il serait cocasse de leur reprocher une démarche adossée sur l’individualisme méthodologique pour expliquer les choix humains, alors qu’en dehors de la France, la quasi-totalité de la profession fait sienne cette démarche méthodologique qui, à dire vrai, commande et induit, infère et explique tous les autres développements. On ne va pas reprocher à un physicien ou à un chimiste de s’insérer dans la science normale d’un moment. Au fond, ce que certains reprocheraient à nos auteurs est de connaître leur discipline, de s’en faire le reflet et l’écho. Ce n’est quand même pas leur faute si la planification impérative a lamentablement échoué, et que les solutions étatiques semblent comporter des défaillances que le temps qui passe s’est chargé de départager (nos auteurs cependant discutent abondamment de la question des « défaillances du marché ».)
Le pari implicite de la démarche méthodologique et scientifique de nos auteurs est de constater que nos choix ont pour origine des raisons, et même de bonnes raisons. Ce truisme élémentaire est contesté pour un seul motif, mais de taille. En raison de la subjectivité intrinsèque des goûts, les choix des uns ne sont pas ceux des autres. Les préférences des uns sont les rejets des autres, et inversement. Voilà pourquoi nous n’acceptons pas aisément que les choix soient rationnels, faute d’une information et d’une perception correcte sur les préférences et indifférences d’autrui.
À dire vrai, nous ne trouvons à ce parfait manuel, tant d’initiation pour les uns que d’approfondissement pour les autres, qu’un seul défaut. C’est de faire l’impasse, presque totale (à l’exception de quelques dizaines de lignes des pages 16 et 17) sur l’histoire de la pensée et des doctrines. Comment faire comprendre l’état d’avancement en un moment donné d’une discipline si on ne connaît ses fondations et fondements ? Autrement dit, si l’économie politique aujourd’hui partage un ensemble de résultats et de convictions, c’est certes parce que les faits sont ce qu’ils sont, mais que tout autant les auteurs, les écoles, les courants ont théorisé petit à petit et progressivement les concepts, les explications et les raisons qui font que les choses sont ce qu’elles sont. Que ce résultat soit satisfaisant ou pas, juste ou non, ce n’est pas de la tâche de l’économiste prioritairement d’y répondre, mais il aurait tort de laisser au philosophe le monopole du jugement moral. Il peut également et doit participer aux débats sur les buts et les fins de la discipline qui est en réalité la science de l’action de l’individu.
Un bel ouvrage à mettre entre toutes les mains, une dépense faible pour un fort retour sur investissement.
À lire aussi :
Ayn Rand : un cauchemar pour collectivistes et déconstructivistes




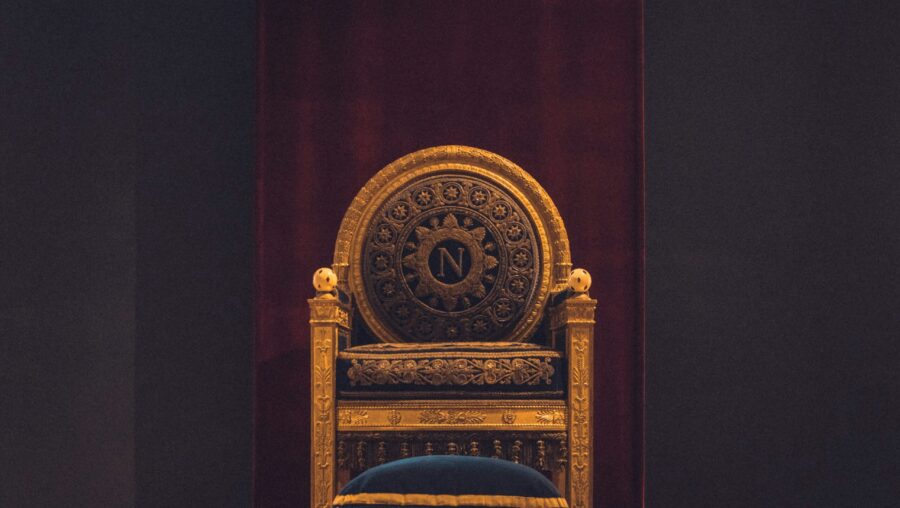
Laisser un commentaire
Créer un compte