Par Alan S. Rome
Un article de Quillette.
L’historien des idées Samuel Moyn, professeur de droit et d’histoire à Yale, est devenu un explorateur influent de notre époque idéologique. Personnage public érudit et intelligent, Moyn est un penseur de plus en plus important de la gauche américaine contemporaine, toujours intéressant et provocateur, que l’on soit d’accord ou non avec ses positions. Sa vaste érudition défie la spécialisation étroite de l’académie, et il fait preuve d’une honnêteté rafraîchissante quant à ses propres convictions socialistes.
Certains de ses ouvrages précédents, tels que The Last Utopia (2010) et Not Enough (2018), affirmaient que les doctrines des droits de l’Homme étaient historiquement contingentes et insuffisantes pour servir de base à la politique. Bien que les exigences minimalistes des droits de l’Homme les aient laissés debout après l’effondrement de tous les autres projets idéologiques utopiques, Moyn estime que ce succès s’est fait au détriment de solutions plus authentiques ou radicales à nos problèmes.
Le nouveau livre de Samuel Moyn, Liberalism Against Itself, approfondit cette critique en s’intéressant au « libéralisme de guerre froide », un terme souvent péjoratif désignant la forme particulière de libéralisme qui a dominé le discours politique américain dans les années 1940 et 1950, au plus fort des tensions entre l’Occident et le bloc communiste.
En ouverture de son livre, Moyn déclare que « le libéralisme de guerre froide a été une catastrophe pour le libéralisme ». En réagissant de manière excessive à la menace soviétique, Moyn estime que les libéraux ont adopté ce que la philosophe Judith Shklar appelle un « libéralisme de la peur ». Obsédés par les dangers de la tyrannie, ils ont abandonné leurs positions progressistes antérieures au profit d’un repli appauvri et défensif sur l’antitotalitarisme et l’anticommunisme.
C’est ainsi que les libéraux de guerre froide se sont préoccupés de la liberté au détriment d’un engagement plus positif en faveur de la maîtrise de la nature humaine et de la société.
Ayant grandi « en présence de l’État le plus égalitaire et le plus émancipateur que les libéraux aient jamais construit », les libéraux de guerre froide auraient échoué à défendre un État providence progressiste. Et en discréditant les alternatives, ils ont « créé les conditions, non pas d’une liberté et d’une égalité universelles, mais des vagues d’ennemis qu’ils ne cessent de trouver aux portes – ou déjà à l’intérieur », en particulier le néoconservatisme et le néolibéralisme.
Le libéralisme, nous dit-on, doit donc être revitalisé en retrouvant les aspects les plus riches de sa tradition antérieure à la guerre froide.
Comme l’a fait remarquer Moyn lors d’une interview l’année dernière :
« Mon principal objectif en tant qu’historien des idées est vraiment de documenter les épisodes de forclusion, et d’utiliser l’histoire comme un outil pour ouvrir l’espace des possibilités intellectuelles et politiques ».
Liberalism Against Itself retrace avec perspicacité les interactions entre la pensée politique, les groupes, les contextes et les influences dans l’histoire de certaines idées. Malheureusement, l’érudition de Moyn est compromise par son projet politique sous-jacent.
Le livre est divisé en six chapitres, chacun traitant d’une figure emblématique de la guerre froide, et chaque individu fournit une lentille à travers laquelle explorer une limitation particulière du libéralisme de guerre froide.
C’est avec Judith Shklar que Moyn se montre le plus sympathique, s’en remettant à son analyse du mouvement et articulant même son récit autour d’elle.
Il s’appuie sur son analyse de la manière dont les Lumières, « centrées sur l’action et l’émancipation », en sont venues à être redoutées par les libéraux comme la source de projets totalitaires.
Selon cette grille de lecture, les libéraux ont trahi leurs propres origines en permettant à l’Union soviétique « d’hériter exclusivement des Lumières dans sa propre présentation ».
À l’inverse, Moyn utilise Isaiah Berlin pour montrer comment les libéraux se sont méfiés du « romantisme », même s’il a été « la source première » du « perfectionnisme moderne », le seul récit convaincant de la « vie la plus élevée » de l’agence créative ou de l’auto-fabrication.
Karl Popper est à son tour critiqué pour son attaque contre la notion de progrès historique.
Alors que le libéralisme du XIXe siècle s’était apparemment « construit sur le terrain de l’optimisme providentialiste concernant la perfectibilité et le progrès », les libéraux de guerre froide sont devenus sceptiques quant à la possibilité de trouver un sens au processus historique.
En revanche, la néoconservatrice Gertrude Himmelfarb et le critique littéraire Lionel Trilling sont critiqués pour avoir contribué à populariser, respectivement, les croyances religieuses et psychanalytiques dans la pensée libérale, croyances qui mettent l’accent sur les limites inhérentes aux efforts humains.
Enfin, bien qu’elle ne soit pas réellement libérale, Hannah Arendt fait l’objet du traitement le plus partial. Moyn la présente comme une représentante de l’hypocrisie prétendument raciste du libéralisme de guerre froide pour avoir soutenu le sionisme, alors même qu’elle craignait que les mouvements de décolonisation n’ouvrent « une voie vers le servage et la terreur ». Ce chapitre introduit également l’un des sous-thèmes les plus intéressants du livre, à savoir l’exploration du fait que nombre de ces libéraux de guerre froide étaient des exilés juifs européens (bien que les conclusions de Moyn soient désapprouvées).
L’analyse de Moyn s’attarde sur la manière dont ces penseurs ont construit de manière créative leur propre tradition, en particulier la canonisation et l’anti-canonisation de leurs héros et de leurs « vilains ».
Cependant, tout au long de son analyse, Moyn est engagé dans son propre processus de canonisation et d’anti-canonisation. Le libéralisme, après tout, est éminement complexe à définir. Moyn hésite entre ce qu’il appelle une définition nominaliste (considérer les gens comme des libéraux s’ils s’identifient comme tels) et une définition contextualiste (identifier une liste de traits caractéristiques de la pensée libérale qui s’appliqueraient à des personnages indépendamment des descripteurs qu’ils ont eux-mêmes adoptés).
Cette équivoque, bien qu’inévitable à un certain niveau, permet à Moyn d’inclure et d’exclure commodément des personnalités de la vraie tradition libérale, comme l’exige son argument. Ainsi, Arendt est considérée comme un « compagnon de route », au même titre que Hegel, la tradition socialiste au sens large, et même Marx. La plupart des néoconservateurs, des straussiens, des « fatalistes chrétiens » ou des « pessimistes romantiques » sont en revanche exclus. Comme on pouvait s’y attendre, les critères d’inclusion de Moyn tendent à pencher vers la gauche.
Un simple recalibrage des frontières du libéralisme tracerait une histoire très différente, de même qu’un cadre temporel plus large.
Liberalism Against Itself affirme que les libéraux de guerre froide ont rompu avec les racines de leur propre tradition. Pourtant, les racines supposées que Moyn identifie ne remontent souvent qu’à la période immédiatement précédente.
En fait, les racines du libéralisme se trouvent au début de la période moderne. Ce n’est qu’en y revenant que l’on peut explorer de manière adéquate ce qui est essentiel ou accidentel dans sa tradition, et identifier les présupposés philosophiques fondamentaux qui représentent ses véritables enjeux et le distinguent des autres traditions politiques – la négation de la transcendance, la séparation de la volonté et de la raison, la recherche d’un régime philosophiquement neutre, ou l’amplification de la liberté et de l’égalité en tant que principes primordiaux.
Mais l’analyse de Moyn sur les périodes antérieures est trop superficielle.
Dans un ouvrage qui prétend aborder la pensée libérale dans toute sa complexité, il a une compréhension remarquablement peu sophistiquée des Lumières en tant que mouvement ayant soutenu sans ambiguïté son propre socialisme.
Sa lecture des figures antérieures, telles que Rousseau et Alexis de Tocqueville, aplatit leurs contours. Il n’a pas non plus de temps à consacrer aux importantes conceptions républicaines et chrétiennes de la vertu dans la pensée libérale, ni aux arguments anglophones du scepticisme prudent et de l’intérêt personnel éclairé d’Adam Smith et des fondateurs américains.
Tout au long de sa carrière, Moyn a été davantage attiré par les récits de discontinuité – les ruptures – que par les continuités. Sa déconstruction de la tradition s’inspire de ses convictions politiques, soulignant que le supposé statu quo est en réalité nouveau, contingent, et le produit de l’action individuelle, et donc facilement modifiable. Mais cette affirmation se fait au détriment d’une compréhension holistique.
La limite la plus fondamentale du projet de Moyn, cependant, est une limite de l’histoire des idées elle-même.
Cette discipline s’attache à contextualiser les penseurs et à retracer leurs influences et leurs déterminations, mais ce faisant, elle a une fâcheuse tendance à les reléguer dans le passé. S’ils sont traités comme de simples produits de leur époque, il n’est pas nécessaire de s’engager dans leurs arguments, d’évaluer la véracité de leurs revendications philosophiques, historiques ou sociales, ni d’apprendre quoi que ce soit d’eux. En l’absence d’un véritable dialogue, les critiques de Moyn se résument généralement au fait que les libéraux de la guerre froide sont trop conservateurs à son goût. Un véritable dialogue avec ces personnalités n’est pas possible car leur conservatisme représente un rejet des hypothèses philosophiques fondamentales de Moyn.
C’est particulièrement vrai en ce qui concerne sa conception des idées, qu’il considère comme des entités flottantes et toutes-puissantes pouvant être imposées au monde sans aucune résistance de la part des réalités sous-jacentes.
Il affirme, par exemple, que les libéraux « ont payé un lourd tribut » pour leur prétendu scepticisme à l’égard du progrès historique, car « si l’histoire n’est pas un progrès, elle n’a pas de sens ».
Cette affirmation – qui rappelle un peu celle de Merleau-Ponty selon laquelle « si le marxisme est faux, il n’y a pas de raison dans l’histoire » – est contestable en soi. Mais même si elle était vraie, le fait de souhaiter quelque chose n’en fait pas une réalité. Le progrès historique existe ou n’existe pas ; ses implications politiques sont secondaires. Les lamentations de Moyn sur les conséquences conservatrices des doctrines chrétiennes ou freudiennes ne constituent pas non plus une réfutation de leurs affirmations. Mais parce qu’il souhaite qu’il n’y ait pas de limites à l’effort humain, il rejette l’existence de ces limites.
Moyn ne s’intéresse donc pas à la politique en tant que telle – l’art désordonné du possible et du compromis. Il ne s’intéresse qu’à son propre type d’utopisme. Il s’occupe d’abstractions de haut niveau et ne s’intéresse pas aux contradictions entre ses désirs et la réalité.
Il a par exemple affirmé, qu’il était un hégélien de gauche qui croyait en « une sorte d’étatisme émancipateur par l’institutionnalisation d’une communauté libre d’égaux qui sont des agents créatifs … qui n’est pas du tout bureaucratique ou technocratique ».
Si l’on met de côté la nécessité supposée d’un État interventionniste pour la réalisation de vérités et de valeurs supérieures, on ne voit pas très bien comment on peut avoir un tel État qui ne soit « pas du tout bureaucratique ou technocratique ».
Plus important encore, Moyn pense que ses opposants politiques sont responsables de tous les maux du monde.
Les socialistes n’ont apparemment jamais été en mesure d’appliquer pleinement leur programme, mais la droite l’a fait. Son mantra est donc « pas assez », et il ne consacre aucun temps à réfléchir au fait que certains des problèmes actuels pourraient en fait avoir été engendrés par la gauche elle-même.
Il ne fait pas non plus allusion au fait que, jusqu’à la pandémie de covid, les dernières décennies « néolibérales » avaient vu un déclin sans précédent des taux de pauvreté dans le monde.
Aucun de ces points n’est décisif, bien sûr, mais un projet politique sérieux devrait au moins les aborder, ainsi que d’autres faits de base et vérités dérangeantes.
Comme l’a fait remarquer Raymond Aron, un libéral de guerre froide :
« La philosophie politique ne peut ignorer la réalité : on ne peut être socialiste sans étudier l’économie politique et sans se faire une idée de ce que le socialisme signifie réellement ».
En effet, l’impatience de Moyn à l’égard de la réalité économique et historique l’amène à faire des affirmations politiquement et moralement imprudentes.
Il suggère à un moment donné que la croyance des libéraux de guerre froide selon laquelle « les objectifs à long terme ne peuvent jamais justifier les crimes à court terme » équivaut à nier tout rôle au « progrès collectif dans l’histoire ». L’implication de ce point de vue est que le progrès collectif nécessiterait la commission de crimes. Il établit des équivalences moralement obtuses entre les régimes coloniaux et totalitaires. Il méprise les craintes concernant les résultats des mouvements anticoloniaux, même si nombre de ces mouvements se sont révélés tout aussi violents et répressifs que les libéraux le craignaient. Il regrette que les libéraux n’aient pas essayé de répandre la liberté (d’une manière non impériale, bien sûr). Et il est généralement dédaigneux de la menace de tyrannie que beaucoup, y compris Tocqueville, ont identifié comme une possibilité toujours présente dans les démocraties de masse.
Dans une tribune du New York Times de l’année dernière, Moyn et son coauteur suggèrent que le Congrès pourrait simplement défier la Constitution en adoptant une loi sur le Congrès pour « parvenir à un ordre plus démocratique » dans lequel « la structure de base du gouvernement, comme l’élection du président à la majorité ou la limitation des juges à des mandats fixes, serait décidée par l’électorat actuel, par opposition à un électorat issu d’un passé brumeux ».
Il n’est pas certain que nous soyons censés prendre au sérieux cette proposition de lancer un coup d’État au nom de la démocratie, mais le résultat inévitable serait la guerre civile ou la tyrannie.
Liberalism Against Itself pourrait susciter des discussions salutaires sur l’absence de vision de notre classe politique, à la recherche d’une politique rationnelle et efficace allant au-delà des politiques réactionnaires ou identitaires qui sèment la discorde.
Le livre de Moyn identifie correctement de nombreuses limites du libéralisme. Mais la réponse à nos problèmes contemporains ne réside pas dans un nouveau radicalisme qui abandonne imprudemment la prudence et la modération politiques au profit de projets utopiques. Ceux d’entre nous qui ne sont pas hégéliens n’ont pas le luxe de supposer qu’ils connaissent toutes les réponses.
Contrairement à la complaisance de nombre de leurs contemporains radicaux (qui ont trop souvent cédé à l’attrait de régimes autoritaires brutaux), les meilleurs libéraux de guerre froide ont abordé le monde avec une vision politique modeste, humaine et sage. Comme l’a récemment écrit Joshua Cherniss, des personnalités telles que Raymond Aron étaient admirables, non pas tant pour les positions particulières qu’elles adoptaient que pour leur horreur de l’impitoyable et leur attrait pour la vérité, la complexité et l’incertitude. Malgré tous leurs défauts, ces libéraux de guerre froide sont mieux équipés que Samuel Moyn pour nous guider en ces temps troublés.
—


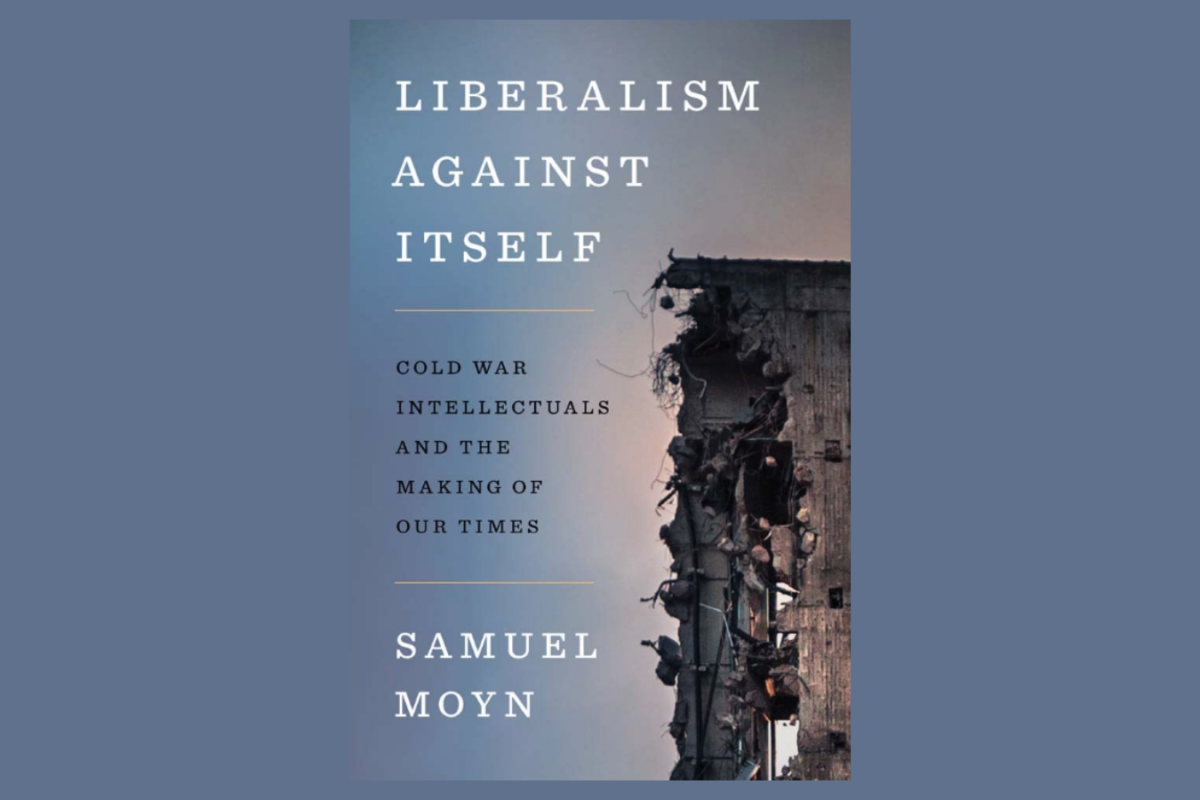
Les Lumières ont engendré, entre autres, la DDHC. Point d’orgue de l’émancipation de l’individu face à l’absolutisme du Pouvoir.
Marx compagnon de route du libéralisme, comme le prétendrait Moyn ?
Das Kapital propose l’émancipation de l’individu ouvrier face à l’Etat bourgeois et capitaliste, et in fine la disparition de l’Etat.
Un lecteur naïf pourrait donc répondre oui.
Or rien n’est plus faux.
Les Lumières ont posé les conditions de la démocratie.
Le marxisme n’a amené que violence et despotisme. Notamment parce que, à la différence des Lumières, qui ne personnifiait pas le Pouvoir, son sous-bassement idéologique dressait une classe contre une autre.
On peut jauger la dangerosité d’une idéologie politique à sa propension à définir un bouc-émissaire. La fin est écrite depuis le début de l’Humanité, depuis les premiers sacrifices : le bain de sang.
Le contraire du libéralisme.
«Les Lumières ont posé les conditions de la démocratie.
Le marxisme n’a amené que violence et despotisme.»
Le monde est en effet tellement plus simple à comprendre réduit en morceaux distincts.
Je n’ai pas l’impression que les penseurs d’aujourd’hui façonnent le monde plus que d’autres bien qu’ils y participent. Pour les Lumières ce fut sans doute pareil.
Concernant le marxisme, bien plus tardif que les Lumières, il serait donc un aveu d’échec de ces derniers.
Pour moi, en règle générale, lorsqu’on utilise des points de références idéologiques et catégoriques pour expliquer les choses, on est soi-même perdu dans l’idéologie mais on a l’illusion du contraire.
Les commentaires sont fermés.