Par Etienne Smith.
Comment expliquer les récents accès de violence politique au Sénégal, pays tant vanté par le passé pour sa supposée « exception démocratique » ?
Ces dernières années, les crises politiques se répètent et se ressemblent : une dizaine de morts en janvier-février 2012 après l’annonce de la candidature du président sortant Abdoulaye Wade à un troisième mandat ; 14 morts en mars 2021 suite à l’arrestation de l’opposant Ousmane Sonko ; 4 morts en juillet 2022 lors des manifestations contre l’invalidation des candidats des listes d’opposition aux législatives ; enfin, 23 morts début juin 2023 après la condamnation du même Ousmane Sonko pour « corruption de la jeunesse ».
Cette dernière crise a particulièrement marqué les esprits. Pourtant, ses ingrédients étaient bien connus depuis longtemps…
Usure du pouvoir et tentation autoritaire
En 2012, Abdoulaye Wade s’était porté candidat à sa propre succession alors qu’il avait déjà effectué deux mandats présidentiels, ce qui avait entraîné une sérieuse crise politico-constitutionnelle. Il avait alors été vaincu au second tour par son ancien Premier ministre Macky Sall. La victoire de ce dernier, pour un mandat de sept ans, avait engendré de grands espoirs : le nouveau chef de l’État, voulait-on croire, allait mettre en œuvre une transformation institutionnelle qui éviterait qu’une telle situation ne se répète.
L’optimisme démocratique n’a pas duré : à chaque étape, le président Sall a semblé privilégier le rapport de force.
Plutôt qu’appliquer les propositions des Assises nationales de 2009 pour une réforme en profondeur des institutions, qu’il a signées, il mène à la hâte une révision constitutionnelle en 2016. Celle-ci réduit la durée du mandat présidentiel à cinq ans, mais ne prend pas à bras-le-corps le problème principal identifié depuis longtemps, à savoir l’hyperprésidentialisme du système politique sénégalais, produit de son histoire depuis le coup de force de Senghor en 1962.
En 2019, l’instauration d’un système de parrainages pour les candidatures à l’élection présidentielle – qui en soi n’a rien d’antidémocratique, mais qui a été mis en place sans concertation et compte parmi les plus stricts d’Afrique ou d’Europe – entrave sérieusement le pluralisme des élections.
Surtout, l’élimination judiciaire préalable des deux opposants les plus importants, le fils de l’ancien président Karim Wade et le maire de Dakar Khalifa Sall, emprisonnés puis libérés mais devenus inéligibles, confirme la volonté du pouvoir de n’organiser que des élections sans danger.
C’est dans ce contexte que Sall est réélu en 2019 pour un second mandat, de cinq ans cette fois. La suppression surprise du poste de Premier ministre au lendemain de l’élection, pour éviter toute concurrence politique possible et renforcer toujours plus les pouvoirs présidentiels, avant la réinstauration de la fonction en 2022, pose la question de la crédibilité des institutions. Dans les classements internationaux sur l’État de droit et la liberté de la presse, le Sénégal dégringole régulièrement.
Dans le même temps, les signes du déclin électoral de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar se multiplient durant le second mandat, alors même qu’elle ne cesse de coopter des opposants, tant du camp libéral de l’ex-président Abdoulaye Wade que des rangs socialistes. En janvier 2022, l’opposition remporte la majorité des grandes villes aux municipales. Six mois plus tard, lors des législatives, le pouvoir évite de peu une cohabitation avec la coalition d’opposition Yewwi Askan Wi, qui regroupe notamment les soutiens d’Ousmane Sonko, de Khalifa Sall et de Karim Wade.
Tout pouvoir n’a-t-il pas l’opposition qu’il mérite ?
Plus que l’usure inexorable, et finalement très classique, du pouvoir, c’est la persécution au long cours de l’opposition qui a conduit la direction actuelle du pays dans l’impasse. Cette stratégie jusqu’au-boutiste s’est peut-être retournée aujourd’hui contre ses initiateurs.
En 2019 déjà, le pouvoir n’avait pas lésiné sur les moyens, au point de faire appel à une officine israélienne produisant des fake news. Diverses rumeurs infondées circulent alors sur les réseaux sociaux afin de décrédibiliser Ousmane Sonko.
Ce dernier, qui n’était alors qu’un opposant parmi d’autres, détonnait déjà dans le champ politique par la modernité de ses campagnes et de ses levées de fonds en ligne, et par la capacité de son parti, les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), à mobiliser une bonne partie de la jeunesse urbaine et estudiantine, mais aussi au-delà, dans les classes populaires et la diaspora.
Inspecteur des impôts, radié de la fonction publique par un décret de Macky Sall en 2016 suite à ses sorties médiatiques sur des scandales financiers présumés, puis élu député en 2017, Sonko, né en 1974, se distingue par un discours intransigeant axé sur la lutte contre la corruption, le souverainisme et un nationalisme mâtiné de conservatisme religieux. Il obtient un score encourageant de 15 % à la présidentielle de 2019.
En janvier 2021, le pouvoir menace une première fois de dissoudre le Pastef au prétexte d’une levée de fonds en ligne ayant permis au parti de récolter environ 200 000 euros. Le mois suivant, une plainte est déposée contre Ousmane Sonko pour viols répétés et menaces de mort par une employée de salon de massage, Adji Sarr. C’est le coup d’envoi de « l’affaire Ousmane Sonko », qui tient en otage le Sénégal depuis lors.
Sonko radicalise alors son discours et lance l’épreuve de force avec la justice. Son arrestation en mars 2021 dans le cadre de cette enquête provoque la première grande série d’émeutes, dont la répression fera 14 morts.
Face à la réaction de ses partisans, le pouvoir est contraint de le libérer. Sonko ne peut plus quitter le territoire national et ses moindres faits et gestes sont scrutés… ce qui ne l’empêche pas de se faire élire maire de Ziguinchor (la grande ville de Casamance) en mai 2022 et d’organiser de grands meetings pour démontrer sa popularité et s’en servir comme bouclier.
Après les scrutins de 2022, une autre plainte, pour diffamation cette fois, est déposée par un ministre, ancien chef de cabinet de Macky Sall. Elle aboutira en avril 2023 à une condamnation pour six mois de prison avec sursis, une amende considérable et le risque de l’inéligibilité pour Ousmane Sonko.
Mais c’est le procès Adji Sarr contre Ousmane Sonko qui attise la tension maximale. Le verdict de juin 2023, qui requalifie les faits en « corruption de la jeunesse », délit exhumé du Code pénal mais presque jamais utilisé, met le feu aux poudres en condamnant Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme. S’il reste pour l’instant en liberté, son arrestation semble imminente.
Alors qu’il sonne pour l’opinion comme un acquittement puisque les accusations de viols et menaces ne sont pas retenues, et qu’il semble crédibiliser les suspicions d’instrumentalisation de la justice et/ou de la plaignante, le verdict rend encore plus incertaine la possibilité pour Sonko de concourir à la prochaine présidentielle, prévue pour début 2024.
La mécanique infernale de la polarisation
La polarisation suscitée par cette affaire divise jusqu’au sein des familles. Elle synthétise de façon vertigineuse tout une série de clivages au Sénégal (rapports entre les générations, conceptions de la citoyenneté, rapports de genre, rapport au religieux, à la justice et aux forces de l’ordre, rapports de classe et inégalités sociales, etc.).
Chaque camp se rejette la responsabilité de la crise. Le pouvoir dénonce la mégalomanie d’un politicien qui entendrait se soustraire à la justice de son pays, et instrumentaliserait ses partisans pour se construire une immunité « populaire » à la Trump et défier les institutions. Pour leur part, Ousmane Sonko et ses partisans crient au complot, au harcèlement judiciaire et policier, et à la volonté de liquidation politique.
Souligner la responsabilité première et écrasante du pouvoir dans ce processus de polarisation n’exonère certes pas les outrances d’Ousmane Sonko, qui ont pu faire douter jusque dans ses rangs. Pour un prétendant à la magistrature suprême, les appels à la confrontation directe et violente passent mal auprès d’une part importante de l’opinion.
Les organisations féministes, ainsi que divers médias ou intellectuels rappellent ses discours misogynes et soulignent le hiatus entre l’image de rigueur morale qui était le fonds de commerce du leader du Pastef et la fréquentation nocturne d’un salon de massage et/ou de prostitution.
Mais le verdict aura aussi sans doute contribué à cimenter sa base, qui n’attend plus grand-chose des institutions. Les arrestations massives opérées parmi les membres du Pastef, y compris des élus (députés ou maires), combinées à des arrestations de nombreux journalistes, lient temporairement le destin du parti à la société civile, signe que la tentative visant à isoler le Pastef a largement échoué. Échec supplémentaire pour le pouvoir : les autres partis d’opposition ont plutôt apporté leur soutien à Ousmane Sonko.
Le recours documenté à des « nervis » – ces hommes de main prêts à tout –, en particulier dans le camp du pouvoir, là encore aussi vieux que l’existence des campagnes électorales, inquiète les organisations internationales et de défense des droits de l’homme, d’autant qu’il se généralise même hors des périodes électorales. Les attaques de maisons d’hommes politiques, du pouvoir comme de l’opposition, sont là aussi tout sauf nouvelles, mais à l’ère des réseaux sociaux leur retentissement est majeur.
Le Sénégal semble ainsi redécouvrir la part d’ombre de sa vie politique. Entre la tentation de la milicianisation chez certains soutiens du pouvoir en place, et celle de l’insurrection chez certains éléments du Pastef, l’impasse semblait totale début juin et l’affrontement de grande ampleur inévitable. Mais l’intensité des réactions dans les médias, la classe politique et la population signale un profond refus de la banalisation de la violence. L’examen de conscience général qu’a produit la crise pourrait redonner toute sa légitimité à un espace central, convaincu que ces deux polarités extrêmes mènent à l’impasse démocratique.
Certains faucons proches du pouvoir souhaitent « éradiquer » le Pastef, ce qui serait le moyen le plus sûr de conduire à davantage de radicalisation et à des lendemains encore plus incertains pour le Sénégal.
Ce parti joue un rôle important pour l’intégration politique des élites intermédiaires et d’une certaine jeunesse urbaine désenchantée. Le pouvoir aurait tout intérêt à l’inclure dans le jeu électoral, quitte à bousculer un peu l’entre-soi de la classe politique sénégalaise. Le « risque » serait bien moindre que son exclusion des rouages de la démocratie représentative. D’autant que pour Ousmane Sonko, l’épreuve électorale est peut-être plus redoutable que l’épreuve judiciaire qui lui est imposée actuellement : il lui faudra faire face à des contradicteurs, défendre la crédibilité économique et budgétaire d’un programme, aligner des potentielles équipes gouvernementales et des compétences, rassurer des potentiels alliés pour une coalition…
Les solutions sont connues
Certes, le Sénégal peut s’enorgueillir de deux alternances politiques réussies en 2000 et 2012. Mais ce que la légende dorée de l’exception démocratique sénégalaise ne signale pas, ce sont les conséquences de la présence des présidents sortants dans ces deux scrutins. Seule l’existence du second tour a permis leur défaite, par un « vote utile » ou « dégagiste ». Le président élu tend alors à prendre son élection pour un vaste soutien populaire à sa personne, et le réveil de l’impopularité n’en est que plus brutal.
La cristallisation d’un débat sur le troisième mandat, qui dans un pays normalement démocratique ne devrait même pas exister, souligne bien l’absence de consolidation institutionnelle de la démocratie. Le franchissement d’un véritable seuil qualitatif pour la démocratie au Sénégal serait donc qu’un président sortant ne se représente pas après ses deux mandats permis par la Constitution. Si Macky Sall entend marquer l’histoire politique de son pays, c’est en annonçant son départ qu’il pourra le faire.
La construction d’institutions politiques démocratiques fortes – et fortes parce que démocratiques – est essentielle pour la légitimité du pouvoir et la stabilité à long terme. Barack Obama ne disait pas autre chose en rappelant, en 2009, lors de sa visite au Ghana, cette vérité simple mais efficace : « L’Afrique n’a pas besoin d’hommes forts. Elle a besoin d’institutions fortes. »![]()
Etienne Smith, Maître de conférences, Sciences Po Bordeaux
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.
![]()




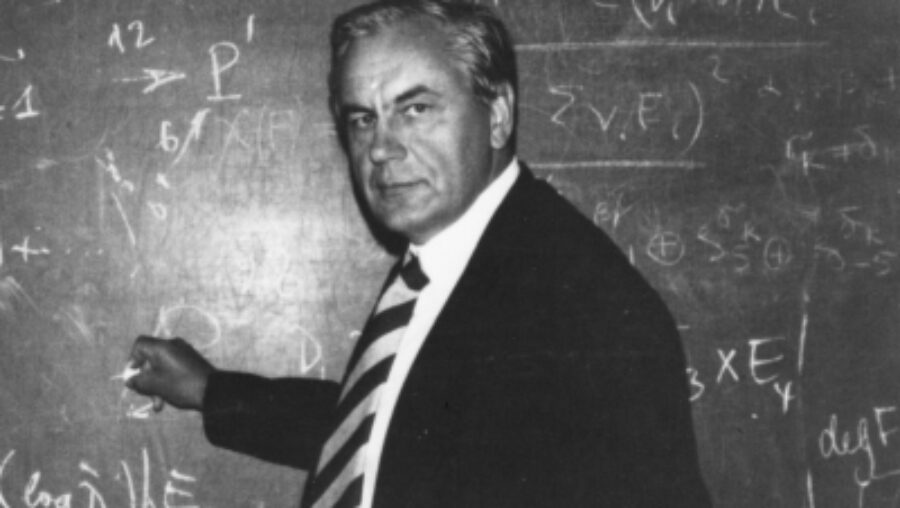
Laisser un commentaire
Créer un compte