Nous voilà, pour le troisième billet de cette série, dans une autre nécessité : celle de juger la compréhension de la loi de Say par des économistes qui ont précédé de peu Lord Keynes, qui a été un point de basculement dans la compréhension de l’économie des économistes classiques. Nous aborderons ici deux auteurs : Alfred Marshall et Frederick Lavington.
La compréhension de la loi de Say par le professeur de John Maynard Keynes
D’autres économistes, autres qu’Alfred Marshall, avaient une certaine vision de la Loi de Say, mais Marshall ayant été le professeur de Keynes, il me semblait opportun de soulever le fait que Keynes n’a pas pu recevoir une interprétation faussée de la loi de Say.
Dans le passage suivant, il est très clair que Marshall avait une approche cohérente de la loi de Say, permettant cependant d’expliquer des désorganisations commerciales, le chômage de masse, des erreurs dans la production, et ce à cause de la profonde division du travail qui caractérise l’économie et qui fait que le pouvoir d’achat des uns n’est pas automatiquement connecté au pouvoir d’achat des autres (et faisant que le pouvoir d’achat de certains producteurs est le pouvoir d’achat des autres producteurs).
« Mill a fait observer avec raison que : « Ce qui constitue les moyens de payer les marchandises, ce sont uniquement des marchandises. Les moyens qu’a chaque personne de payer les marchandises produites par les autres consistent dans les marchandises qu’elle possède elle-même. Tous les vendeurs sont inévitablement, et au sens même du mot, des acheteurs. Si nous pouvions doubler tout d’un coup les pouvoirs productifs du pays, nous doublerions en même temps l’offre de marchandises sur chaque marché; mais nous doublerions du même coup le pouvoir d’achat.
Chacun présenterait une demande double aussi bien qu’une offre double ; chacun serait capable d’acheter deux fois plus parce que chacun aurait deux fois plus à offrir en échange. Mais quoique des gens aient le pouvoir d’acheter, ils peuvent ne pas vouloir en user.
Car lorsque la confiance a été ébranlée par des faillites, A est impossible de trouver du capital pour fonder de nouvelles sociétés ou pour étendre les anciennes. Des projets relatifs à de nouvelles voies ferrées ne sont pas accueillis avec faveur, des navires restent inoccupés, et il n’y a pas d’ordres pour des navires nouveaux. C’est à peine s’il existe une demande pour les travaux de terrassement et il n’existe qu’une faible demande pour l’industrie du bâtiment et pour celle de la fabrication des machines. En un mot, il n’y a que peu d’occupation dans les industries. qui produisent des capitaux fixes.
Ceux dont l’aptitude et le capital sont spécialisés dans ces industries gagnent peu, et, par suite, achètent peu de produits des autres industries. Les autres industries, ne trouvant qu’un marché peu étendu pour leurs marchandises, produisent moins ; elles gagnent moins, et, par conséquent, elles achètent moins ; la diminution de la demande relative à leurs marchandises fait qu’elles-mêmes demandent moins aux autres industries. C’est ainsi que s’étend la désorganisation commerciale ; la désorganisation d’une branche jette le trouble dans les autres, et celles-ci réagissent sur la première et augmentent sa désorganisation. » Alfred Marshall, Principes d’économie politique, (French Edition) (p. 385). Édition du Kindle.
La mal-production de certains producteurs (c’est-à-dire, là où les producteurs ont produit trop ou trop peu par rapport à la demande de leurs consommateurs) entraîne la baisse de leur pouvoir d’achat, et en même temps, restreint le pouvoir d’achat des entrepreneurs d’autres secteurs (qui ne peuvent pas écouler leurs productions à cause des erreurs des premiers).
La confiance se déprécie, engendrant des effets récessifs, et le chômage de masse apparaît. Il n’y a pas de chocs externes ici. Les classiques avaient une véritable théorie du cycle, et tout n’allait pas bien dans le monde qu’ils décrivaient, à l’inverse de ce qu’ont prétendu Keynes et tous ceux qui lui ont succédé, jusqu’à certains économistes se qualifiant eux-mêmes de penseurs pré-keynésiens.
Frédérick Lavington, le Keynes des classiques ?
Frédérick Lavington écrit l’un des derniers comptes-rendus d’une théorie du cycle classique en 1926, avant l’heure de gloire de Keynes.
Sans user jamais du nom de la loi des débouchés de Jean-Baptiste Say, ou law of markets, Lavington nous offre cependant la grande vision des classiques qui, jamais, n’a sous-entendu que la loi de Say ne fonctionnait que là où il y avait pleine utilisation des ressources. C’est une déformation des classiques par Keynes, en plus des autres, qui laisse à penser que Keynes ne les a pas réellement compris. L’activité de chacun est l’activité de tous. Personne n’est réellement qu’un consommateur. Lavington fournit une vision classique, pas seulement micro-économique, mais aussi macro, et notamment en abordant les effets cumulatifs de ces élans d’optimiste et de pessimisme (qui peuvent grandement influencer par la conduite de la politique monétaire) :
« Lorsque chaque groupe de production sous le commandement d’un entrepreneur se spécialise dans la production d’une gamme étroite de marchandises, chacun doit vendre ses produits pour ceux des autres groupes ; en d’autres termes, la capacité de chacun à commercialiser ses propres produits dépend de la production par les autres groupes des marchandises avec lesquelles leurs produits sont achetés ; sa propre activité dépend de l’activité de tous les autres.
Cette dépendance mutuelle entre les entreprises commerciales est plus intime et plus profonde qu’il n’y paraît sans réflexion. Il est presque littéralement vrai que chaque groupe producteur constituant une industrie forme un marché pour les produits, non seulement des industries associées, mais de toutes les autres industries du pays. En effet, en général, les capitalistes, les entrepreneurs et les travailleurs qui forment ce groupe constituent un échantillon représentatif de l’ensemble de la communauté en tant que consommateur, et achètent donc, avec le produit de leurs propres activités, une fraction de la production de toutes les autres industries.
[…]
Dans une période de dépression générale, l’entreprise individuelle travaille à basse pression parce que les autres entreprises travaillent à basse pression. Chacune est inactive parce que le pouvoir général de consommer a chuté ; et le pouvoir général de consommer a chuté à cause et en proportion du déclin général de l’activité de production. L’inactivité de tous est la cause de l’inactivité de chacun. Aucun entrepreneur ne peut accroître sa production en toute sécurité tant que d’autres entrepreneurs ne peuvent accroître la leur en toute sécurité ; ou plus exactement et plus significativement, aucun entrepreneur ne peut accroître sa production en toute sécurité tant qu’il ne peut raisonnablement s’attendre à ce que les autres soient plus actifs au moment où sa production supplémentaire sera prête pour le marché. » Frederick Lavington, The Trade Cycle
On sait que Keynes n’a d’ailleurs jamais lu Lavington, comme le rappelle Hutt.
L’ouvrage n’a jamais été retrouvé au sein des différentes bibliothèques de Keynes, et selon toute vraisemblance, Keynes n’a pas dû le lire. Lavington aborde un certain nombre de thèmes, qu’on croit au combien keynésiens : le cycle des affaires, le rôle des anticipations des entrepreneurs, leur optimisme et leur pessimisme. Pour Hutt, Keynes n’aurait jamais écrit sa Théorie Générale si il avait lu auparavant Lavington, et pour Clower, Lavington était un anticipateur de Keynes, plus clair que ce dernier (alors que Lavington n’a rien fait d’autre que de formuler la théorie classique du cycle dans sa plus parfaite complétude, comme le rappelle Steven Kates).
De quoi faire relativiser la prestigieuse inventivité d’un économiste dont les idées continuent de dominer l’esprit d’un certain nombre de personnes en poste.



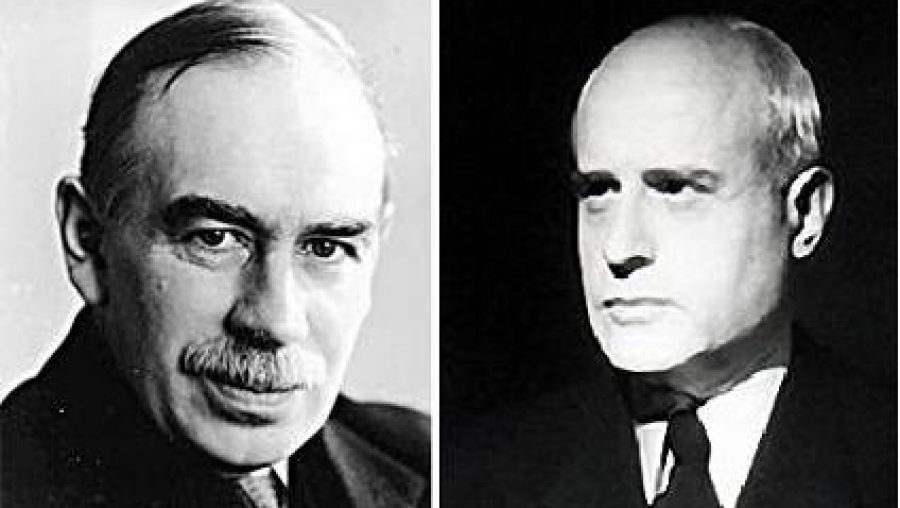
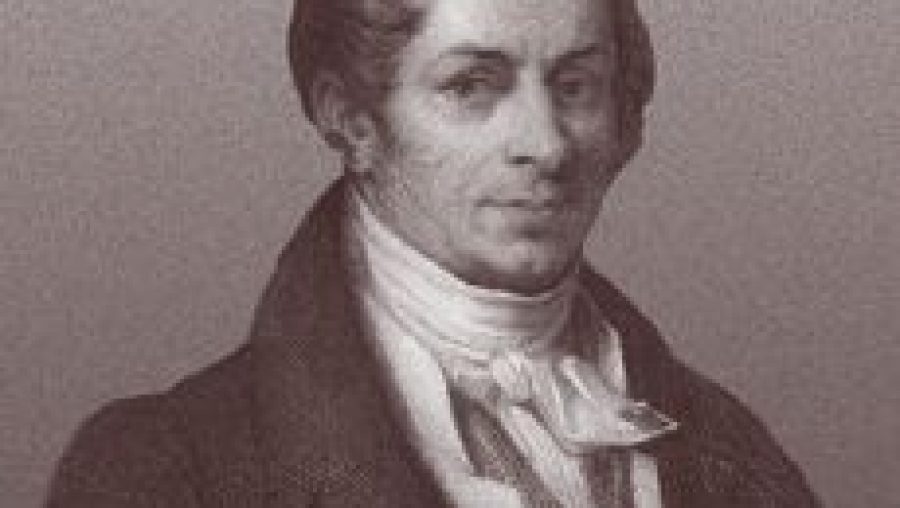
Laisser un commentaire
Créer un compte