Par Guillaume Nicoulaud.

Sous l’ancien régime, le système monétaire français est organisé autour de la livre tournois (lt), une unité de compte divisée en 20 sous (ou sols) de 12 deniers. Depuis la réforme de mai 1726, les pièces de référence sont le louis d’or qui a un cours légal de 24 lt et l’écu d’argent pour 6 lt.
À compter de la réforme de Calonne, le 30 octobre 1785, on taillera 32 louis d’or au marc avec un titre de 917 millièmes ce qui nous donne un louis de 7.649 g dont 7.014 g d’or fin et ramène la livre à 0.292 g d’or fin[1]. Par ailleurs, on taillera 8.3 écus d’argent au marc avec un titre de 917 millièmes ce qui fait un écu de 29.488 g dont 27.041 g d’argent pur, établit la valeur de la livre à 4.507 g d’argent fin et le rapport légal entre l’or et l’argent à 1 pour 15.42.
La réapparition du franc[2] date du 7 avril 1795, lorsque la loi du 18 germinal de l’an III débaptise la livre tournois pour la renommer « franc ». C’est une loi purement cosmétique qui vise à faire disparaître le nom de l’unité de compte royale et à officialiser le système décimal mais qui, concrètement, n’aura aucun effet. Les choses deviennent plus intéressantes le 15 août 1795, avec la loi du 28 thermidor de l’an III qui dispose que le franc vaut 5 g d’argent à 900 millièmes soit 4.5 g d’argent pur et frappe des pièces en conséquence. À ce stade, tout le monde comprend que le franc, mesuré à sa valeur en argent, vaut environ 0.15% de moins que la livre tournois.
Mais huit mois plus tard, le 14 avril 1796, la loi du 25 germinal de l’an IV fixe le cours de conversion légal à 5 fr pour 5 lt, 1 sou et 3 deniers soit, dans le système décimal, 1.0125 lt pour 1 fr. C’est-à-dire que le franc, au cours de conversion légal, vaut exactement 1.25% de plus que la livre tournois. En d’autres termes, en échangeant une livre 5 lt, 1 sou et 3 deniers contre 1 fr, vous échangiez 4.563 g d’argent fin contre 4.5 g — soit une perte de 63 milligrammes justifiée, entre autres choses, par l’érosion des vieilles pièces.
Enfin, la loi de germinal an XI (28 mars — 7 avril 1803) confirme la contrevaleur du franc en argent et instaure le bimétallisme : on taille 155 pièces de 20 fr-or au kilogramme — les fameux Napoléon — soit 322.5 mg par franc qui, avec un titre de 900 millièmes, fixe la valeur du franc désormais « germinal » à 290.25 mg de fin (et rétablit au passage la parité or/argent établie par Calonne en 1785).
Si le bimétallisme sera partiellement abandonné à partir de 1876, le franc germinal restera convertible contre 290.25 mg d’or fin jusqu’au 5 août 1914, date à laquelle la convertibilité est rompue — soit pendant plus de 111 ans. On croira, après-guerre, pouvoir rétablir le franc à son ancienne valeur mais cette illusion prendra définitivement fin avec la dévaluation de Poincaré ; le franc Poincaré ne vaut plus que 58.95 mg de fin ; moins d’un cinquième de la valeur du franc germinal.
—
[1] Contre 8.271 g d’or fin à la fin du règne de Saint Louis — ça coûte cher les croisades.
[2] Le franc à cheval, première monnaie française à porter le nom fût créé le 5 décembre 1360 pour financer la rançon de Jean II dit le Bon alors prisonnier des anglais. La chose pesait 3.88 grammes d’or pur et sa valeur en unité de compte était fixée à une livre tournois.
—



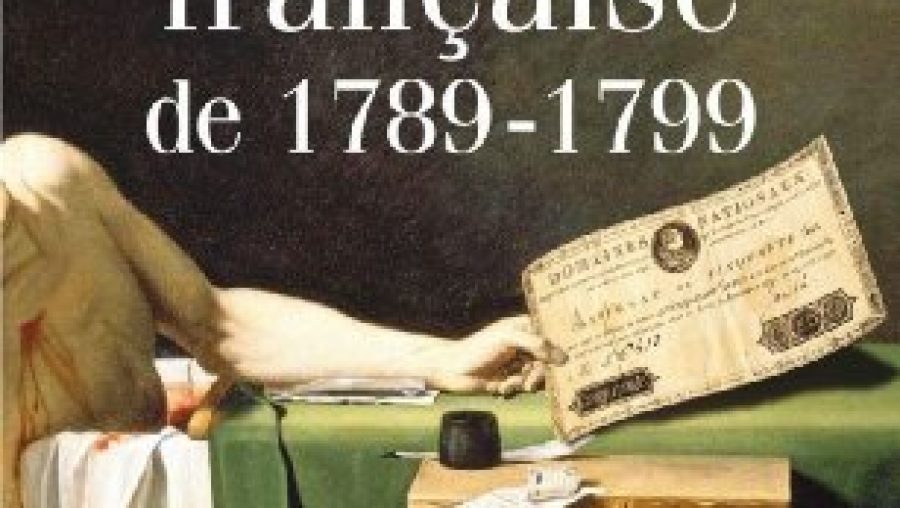

merci pour cet excellent résumé.
je pense que le titre des pièces de Calonne c’était 11/12 (0,91666…) et non 917 millièmes
11/12 soit 916.666 arrondis à 917 millièmes.
C’est ce qu’on appelle un article pour spécialiste, voire même plus, pour érudit….
Merci !