Par Kabukabu Ikwueme, chercheur en droit des assurances.
Un article de Libre Afrique.
 Au cours des dernières années, de grandes compagnies opérant en Afrique ont mis au point des méthodes innovatrices en matière de montage de produits financiers, afin de répondre à une demande croissante émanant des personnes incapables d’accéder aux mêmes services auprès des institutions financières traditionnelles. L’un des produits financiers les plus populaires a été la Micro-assurance.
Au cours des dernières années, de grandes compagnies opérant en Afrique ont mis au point des méthodes innovatrices en matière de montage de produits financiers, afin de répondre à une demande croissante émanant des personnes incapables d’accéder aux mêmes services auprès des institutions financières traditionnelles. L’un des produits financiers les plus populaires a été la Micro-assurance.
Il s’agit d’un produit de l’industrie de la microfinance, qui a pendant un certain temps été agressivement commercialisé comme étant essentiel, en particulier pour les personnes dans le secteur informel. Le but étant de fournir un filet de sécurité leur permettant de gérer leurs risques afin de ne pas tomber dans la pauvreté en cas de crise.
Avec la croissance continue du nombre des utilisateurs de téléphones mobiles en Afrique, les assureurs ont désormais une énorme opportunité de faire croître leur chiffre d’affaires, puisqu’ils peuvent puiser dans cette large base de consommateurs – ciblant la population dans le milieu de la pyramide économique – qui ne vit pas avec moins de 2 dollars par jour, sans pouvoir accéder à des produits d’assurance traditionnels.
La Micro-assurance a été sans doute avantageuse et bénéfique à quelques PME (petites et moyennes entreprises) et peut être applaudie comme un moyen innovant pour atteindre un grand nombre de personnes qui comptaient auparavant sur les moyens informels dans la gestion de leurs risques, notamment en s’appuyant sur le soutien de leur famille ou celui de leur communauté. Toutefois, les inconvénients de ce produit financier et le manque de transparence par les entreprises qui offrent ce mécanisme de gestion des risques méritent d’être examinés. Il y a eu des inquiétudes concernant le fait que la micro-assurance ne soit pas tout à fait ce qu’elle semble être.
Le manque de transparence de la part de certaines compagnies signifie que de plus en plus d’assureurs peu scrupuleux exploitent les consommateurs qui ne sont pas familiers avec l’idée d’assurer leurs biens et revenus. Il existe déjà certains assureurs prétendant offrir des services d’assurance gratuits, alors qu’en réalité ils feignent d’informer les consommateurs que leurs primes sont liées de manière déguisée aux achats de produits tels que les recharges de leurs téléphones mobiles par exemple.
Ce choix délibéré, par les assureurs, de manquer de clarté à l’égard des consommateurs les moins financièrement avertis, est en grande partie fondé sur l’hypothèse que les consommateurs ne seront pas au courant de la plupart des pratiques commerciales déloyales utilisées. Ces pratiques de marketing trompeuses sont à l’ordre du jour pour certains assureurs. Par conséquent, il est légitime de s’interroger sur le fait que des produits d’assurance sont commercialisés d’une manière contraire à l’éthique.
Il ne sera peut-être pas exagéré de dire que c’est parce que les profits dans l’entreprise de micro-assurance sont difficiles à obtenir que les entreprises sont moins ouvertes et moins transparentes au sujet de leurs produits, car il est besoin d’un grand nombre de contrats d’assurance pour rendre l’entreprise viable. Cela peut ne pas être particulièrement le cas dans les pays où la réglementation de l’industrie n’est pas stricte.
Alors que des pays comme l’Afrique du Sud ont fait de grands progrès dans la régulation de l’industrie de l’assurance afin de garantir la confiance des clients, par l’introduction d’un modèle “Twin Peak” (modèle bicéphale consistant en des autorités de surveillance séparées pour la surveillance prudentielle et la surveillance des règles de conduite des entreprises, tous établissements financiers confondus ) de la régulation financière visant à combler les lacunes de la structure réglementaire, d’autres pays d’Afrique ont encore un long chemin à parcourir dans ce domaine.
De meilleures pratiques réglementaires doivent être développées pour faire face au risque des abus potentiels dans le secteur de l’assurance. Les modèles réglementaires qui existent actuellement dans certains pays d’Afrique sont en grande partie inefficaces en raison de la lenteur du processus d’élaboration des lois et du manque de fiabilité des systèmes judiciaires.
La réforme rigoureuse du cadre juridique du secteur de l’assurance est indispensable dans de nombreux pays à travers le continent ainsi que la mise en place d’institutions indépendantes de réglementation afin de protéger les consommateurs vulnérables contre toute forme d’exploitation.
—
Sur le Web. Article initialement publié en anglais par African Executive – Traduction réalisée par Libre Afrique


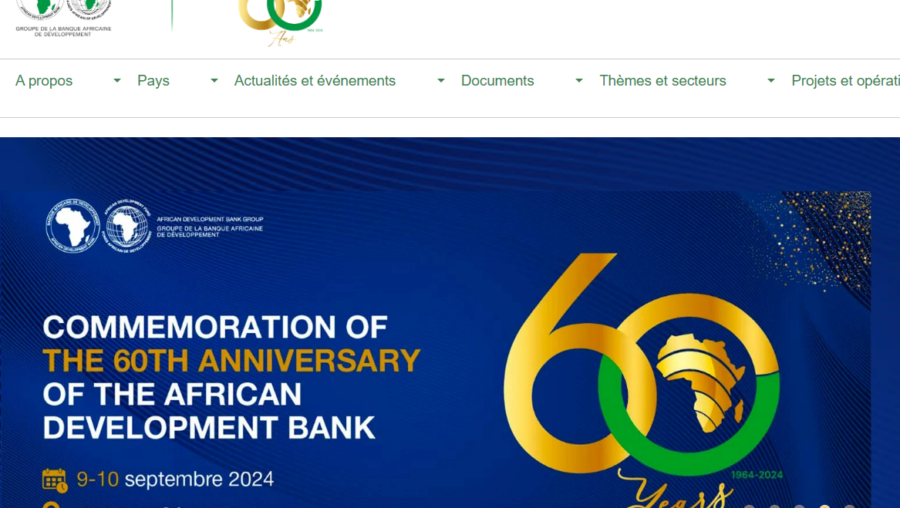

Pas compris grand’chose à votre charabia… Venir sur Contrepoints et demander une réglementation, faut oser et pourquoi pas une taxation, bonne et grosse ! Si l’assureur y trouve son compte et règle les sinistres, c’est tout bon. Sans l’assurance, aucun développement possible.
Pour autant, l’auteur se dit “chercheur en droit des assurances”. Peu importe quelle langue on parle, en assurance, et encore plus en droit de l’assurance, on fait la distinction vie/IARD (= distinction Life/Non-Life).
A moins que je n’ai lu l’article trop vite, je ne vois aucune distinction.
Au contraire je vois plutôt des confusions.
D’abord l’auteur parle de produits financiers, de risque en cas de pauvreté. Il s’agit donc de l’assurance vie ?
Mais ensuite il embraye sur les assurances des entreprises. Les entreprises, ne souscrivent pas de vie. Que de l’IARD ou des la prévoyance.
Et ensuite l’auteur a l’air de parler de l’assurance affinitaire.
Enfin bref, un sacré mélange de contrats qui ont des implications très différentes.
Il finit par conclure qu’il veut un organe de régulation en Afrique. J’aurais bien envie de lui répondre : “Bougez pas, je vous mets les mecs de l’ACP dans un charter et je vous les envoie”
L’auteur de l’article se trompe gravement s’il croit qu’un surcroît de réglementations et de surveillance par les pouvoirs publics peut améliorer les pratiques commerciales au bénéfice des clients.