Par Johan Rivalland.
Cet essai passionnant est mené à la manière d’une enquête.
La question à élucider : Quel mal frappe les jeunes Occidentaux ? Pourquoi sont-ils si pessimistes ou désabusés ? D’où viennent leurs apparentes contradictions entre méfiance envers le marché, la politique, la société, les mécanismes individualistes, d’un côté, et leur foi dans l’évolution du monde, leur engagement dans des associations, leur propre comportement de purs homo œconomicus ?
Un mal purement occidental
 Pierre Bentata, s’appuyant sur son expérience de jeune professeur en écoles de commerce, université et autres centres de formation, au contact donc d’une partie de cette jeunesse, décide de mener l’enquête et de rassembler l’ensemble de ses observations.
Pierre Bentata, s’appuyant sur son expérience de jeune professeur en écoles de commerce, université et autres centres de formation, au contact donc d’une partie de cette jeunesse, décide de mener l’enquête et de rassembler l’ensemble de ses observations.
Il commence par examiner la différence d’état d’esprit frappante entre les jeunes Occidentaux (les 18-25 ans, plus spécifiquement) et les jeunes d’autres endroits du monde.
Pour cela, il se base sur les quelques enquêtes disponibles au niveau international, portant sur les aspirations, la perception du monde et les sentiments liés à leur avenir des jeunes de différents pays.
Or, ce qui est frappant, c’est l’optimisme et la confiance dans l’avenir partagées par les jeunes issus des pays émergents, notamment des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, auxquels on ajoute à présent l’Indonésie). À rebours du sentiment occidental (à l’exception des Américains et Scandinaves, au sujet desquels notre auteur propose des explications que je vous laisserai découvrir, liées à leur propre histoire).
Des jeunes pétris de paradoxes
Ce qui est également frappant est le décalage entre le pessimisme qu’ils éprouvent à l’égard de l’avenir de leur pays et le plus grand optimisme concernant leur propre avenir. De même, ils sont majoritairement satisfaits de leur époque, de la mondialisation, de la démocratie, du multiculturalisme et de l’évolution du monde, mais pas de leur société (qui en est pourtant, en bonne partie, à l’origine), des médias, surtout traditionnels, dont ils se méfient, ou de la politique nationale à laquelle ils ne se sentent pas intégrés.
La détestation du marché est un autre paradoxe, de la part de jeunes nombreux à vouloir par ailleurs se situer au cœur de ce marché.
Bien sûr, vous voyez poindre des explications à travers ces constats, que l’auteur ne manque pas d’évoquer, mais dont il va surtout tenter de vérifier les fondements au fil de son enquête.
Enquête sur les causes du malaise
Face à ces constats, Pierre Bentata va adopter une démarche qui vise à écarter certaines explications possibles, avant d’en venir peu à peu à centrer ses analyses sur ce qui va émerger progressivement.
Il commence donc, en se basant là encore sur de multiples données, par écarter les explications auxquelles on pourrait spontanément penser, ou du moins celles qui sont trop souvent avancées sans être véritablement vérifiées :
– La crise économique ? Écarté.
– Les inégalités ? Adoptant un regard critique, notamment à l’égard des conclusions d’un certain Thomas Piketty, et se basant sur la réalité des chiffres concernant la fantastique création de richesse et l’évolution du pouvoir d’achat au cours des deux derniers siècles, il écarte aussi cette explication.
– Le malaise de la démocratie libérale ? Écarté. Les jeunes apparaissent attachés aux valeurs d’égalité des droits, de liberté individuelle et d’équité, qui en constituent les fondements.
L’hypothèse de la fin de l’histoire
C’est donc du côté des prolongements des travaux de Francis Fukuyama sur la fin de l’histoire que Pierre Bentata va chercher des explications.
Partant d’une intuition, issue de son observation, il va nous retracer l’évolution qui a mené à ce que la supériorité du marché vienne mettre à mal les tentatives de planification et toutes les tentatives de régimes autoritaires qui n’ont pu résister au vent de liberté qui a soufflé de plus en plus fort et mis à mal les velléités de contrôler les peuples, l’économie, les marchés.
On se situerait ainsi, en grande partie, « après l’histoire », à une époque sans grands combats, du moins pas du niveau de ceux qui ont précédé, sans lutte idéologique du niveau de ce que les générations précédentes ont connu. Et dans un cadre qui n’est pas non plus celui des pays émergents, où beaucoup de choses restent à construire, où par conséquent l’avenir est source d’espoir. Une situation d’état relativement statique à l’échelle de l’histoire, de grand vertige qui peut saisir, selon l’auteur, ceux qui n’ont pas connu le Mur de Berlin ni les périodes antérieures de famines, maladies, épidémies, espérances de vie plus restreintes.
Finalement, une perte de sens et une lente désillusion qui peuvent mener à un grand vertige, celui de la confrontation à sa propre individualité, un certain relativisme et la perte du destin commun.
Une enquête et une démonstration que, bien sûr, je résume ici de manière bien rapide et schématique, qui ne peut qu’inviter à la critique. Mais, une fois encore, l’ouvrage est riche et passionnant. Il faut le lire pour en découvrir la véritable substance et se faire une meilleure idée des arguments de l’auteur.
Les enjeux du monde de demain
Loin de dresser une vision pessimiste de l’avenir, Pierre Bentata s’évertue au contraire à s’appuyer sur le diagnostic établi pour examiner les voies à emprunter pour domestiquer ce vertige occidental et montrer en quoi le monde de demain a des chances à saisir.
Les défis géopolitiques et technologiques sont au cœur des développements qui suivent. Et la principale source d’espoir réside dans les multiples changements auxquels nous assistons dans tous les domaines actuellement, y compris en politique, même si à l’échelle du temps présent, on peut avoir le sentiment que les choses évoluent trop peu rapidement. Mais aussi et surtout au sein de la société civile. Avec au centre de la réflexion la question du sens de la vie.
Au vertige de la liberté répondent parfois la tentation de la nostalgie ou du repli, face au sentiment de déclin et de décadence. Au contraire, selon Pierre Bentata, nos démocraties libérales demeurent à l’avant-garde du monde, et sont même enviées par d’autres, qui tentent de s’en inspirer pour avancer. « L’avenir sera tel que nous le voulons, pour le bien de tous ». Il reste de nombreux défis à relever. Et c’est cette prise de conscience qui, seule, nous mènera vers « la grande aventure de notre époque, la quête philosophique ultime ».
- Pierre Bentata, Des jeunes sans histoire – Essai sur le malaise occidental, Les Éditions du libre-échange, mai 2016, 226 pages.

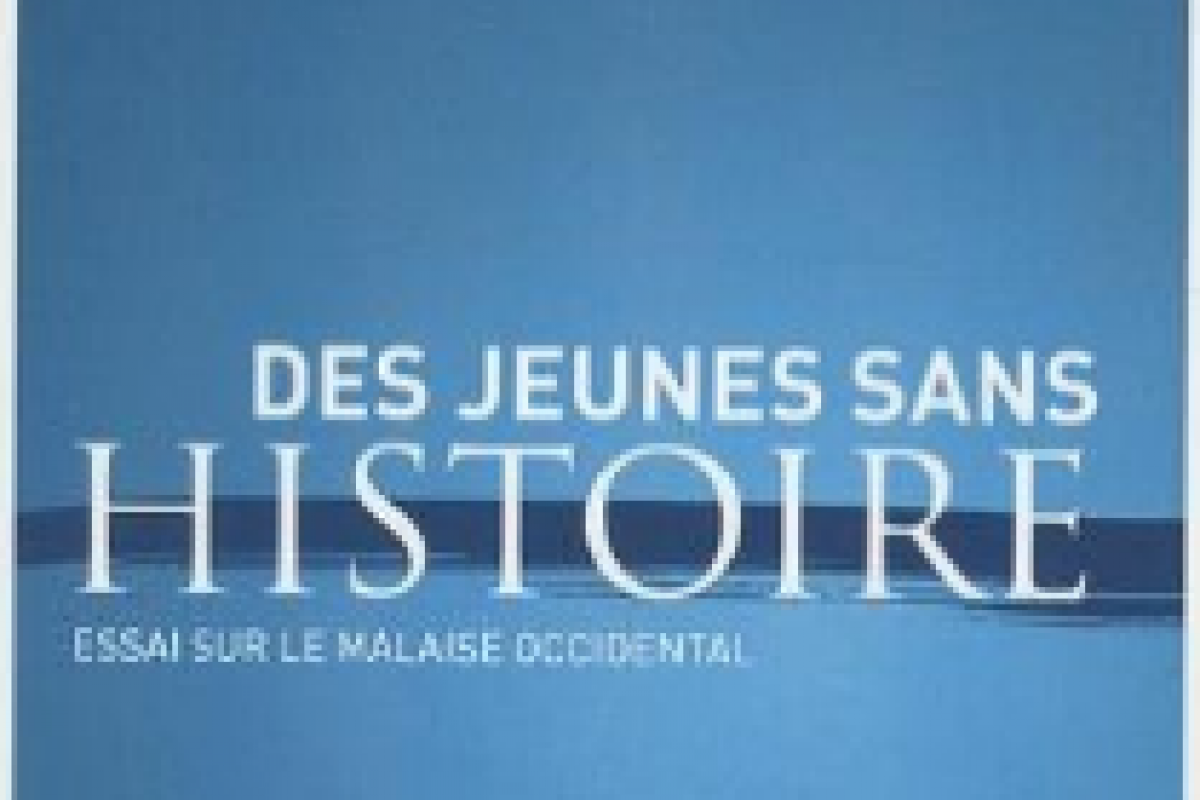



Je retiens de cette belle introduction, le potentiel d’ enthousiasme du libéralisme pour les individus encore toujours et celui de déception s’affaiblissent, lié a l’utopie socialiste (rappelant bien que le terme UTOPIE tire ses racines chez Thomas More – absolument voir l’exposition de qualité sur lui a Louvain – philosophe humaniste protoliberal, assassiné par Henri VIII Tudor)…
Chez les jeunes que je rencontre, de toutes CSP, l’étiquette “la Gôche c’est le Bien, le Libéralisme turbo capitaliste, arrg-c’est-le-mal” commence à se décoller.
Je les encourage à la réflexion…