Par Philippe Granarolo.
 « Jamais sans doute livre de philosophie n’a été bâti, du moins à un tel degré, sur le procédé de la mise en abyme ».1 Cette phrase de la p. 62, dont on trouvera quantité de répliques dans l’ouvrage, en est l’illustration : « Pensifs, inventifs, nous autres humains produisons des cultures qui inventent des sciences qui comprennent l’Univers dont le Grand Récit nous produit comme humains pensifs ou inventifs. ».
« Jamais sans doute livre de philosophie n’a été bâti, du moins à un tel degré, sur le procédé de la mise en abyme ».1 Cette phrase de la p. 62, dont on trouvera quantité de répliques dans l’ouvrage, en est l’illustration : « Pensifs, inventifs, nous autres humains produisons des cultures qui inventent des sciences qui comprennent l’Univers dont le Grand Récit nous produit comme humains pensifs ou inventifs. ».
Si bien que dans ce livre à tiroirs, l’on pourra tout aussi bien lire un brillant résumé de l’itinéraire de notre philosophe académicien qu’une nouvelle variante des Grands Récits qu’ont permis les découvertes scientifiques du siècle dernier, aussi bien un approfondissement des thèses explorées dans Petite Poucette2 que les prémisses d’une prochaine philosophie de l’histoire que l’auteur nous promet dans l’Envoi qui clôt l’opus.
L’erreur de Descartes3
La pensée n’est pas notre propre. Nous autres humains ne sommes pas exceptionnels au sein du cosmos. Il convient de s’immerger dans le Récit du Monde, dans le « flux mondial », dans le « fleuve artiste de l’Univers et de la vie ». La nature toute entière pense. Les arbres comptent en ajoutant chaque année une circonférence à leur tronc, les atomes, comme l’avait décrit le premier Lucrèce4, codent en s’informant mutuellement, en se choisissant et en se repoussant : « chaque objet peut devenir le sujet d’autres objets » (p. 208). Doit-on objecter qu’il faut un humain pensant pour dénombrer les stries d’un tronc et les relations entre les atomes ?
Penser par personnages
Dans aucun de ses ouvrages antérieurs, l’auteur n’était autant revenu sur son parcours, jamais il n’avait mis autant de soin à justifier sa démarche et à défendre ses choix. C’est en particulier le cas dans le fait de « penser par figures et personnages », démarche qui caractérise depuis l’origine tous les livres de Michel Serres. À Pantope au Tiers-instruit, à Hermès, et à Petite Poucette viennent s’agréger le Boiteux et le Gaucher, figures relevant davantage de l’autoportrait, l’auteur nous confiant les difficultés de gaucher contrarié vécues durant son enfance et, à l’autre bout de la chaîne de la vie, la légère claudication du vieil homme faisant suite à un AVC. « Pourquoi donc penser par figures et personnages ? Parce que ces synthèses se présentent devant nous comme des réponses émergentes et vives, comme des naissances ou des nouveautés à venir, comme un avenir de la pensée » (p. 69) : il faut bien entendu lire dans cette interrogation qui n’en est pas un plaidoyer pro domo.
Trop optimiste ?
De nombreux commentateurs, particulièrement pour ce dernier livre, accusent Michel Serres de faire preuve d’un optimisme tout à fait excessif. Une lecture attentive repérera pourtant au fil des pages de nombreuses incidentes négatives. Ainsi lorsque l’enfant des campagnes du sud-ouest, énumérant tous les éléments du spectacle de la nature qui a construit sa pensée, dénonce le lourd handicap de l’existence urbaine qui devient le lot de l’immense majorité des terriens. Ainsi lorsqu’il s’en prend au capitalisme sauvage qui détruit peu à peu les meilleures capacités des humains, avant de conclure que « le savoir-vendre tue le savoir-faire » (p. 228).
Certes ces rares moments critiques pèsent peu face au parti pris positif du philosophe. Même si les statistiques lui donnent partiellement raison, lire sous sa plume que « soumis à Hermès, le village mondial est en paix aujourd’hui » (p. 229) ne convaincra guère les foules qui ont défilé dans toute la France au lendemain du massacre des journalistes de Charlie Hebdo. Quant à la prophétie selon laquelle « le doux dissoudra le dur », ne peut-on la comparer aux annonces du futurologue américain Alvin Toffler qui annonçait, dans ses écrits des années 1980, que nous vivrions bientôt la fin des mastodontes industriels et commerciaux, résumant dans la formule « small is beautiful » la devise des décennies à venir ? « small is beautiful », écrivait Toffler… quelques années à peine avant que ne se développent Google, Apple, Facebook, etc.
Mais plutôt que de dénoncer l’optimisme excessif de Michel Serres, ne pourrait-on mettre en valeur la lucidité dont il ne cesse de faire preuve, au moins depuis Le contrat naturel5, sur la précarité de notre condition ? Étendant à l’humanité entière la claudication dont il souffre, il remarque que « nous boitons d’équilibre déséquilibré en équilibre compensé, plus ou moins ponctués » (p. 83)6. Une autre famille de métaphores relaie celle de la claudication : la série des images filées autour de la notion de dissymétrie. Celle-ci caractérise notre espèce, Michel Serres allant jusqu’à considérer l’humanité comme « l’animale anomalie ».
La revanche de Bergson
Henri Bergson ne faisait guère partie, jusqu’à ce dernier livre, du panthéon philosophique de Michel Serres. Le gaucher boiteux se caractérise par un hommage constant à Bergson, un peu comme si notre académicien avait été visité sous la Coupole par l’ombre de l’auteur de L’évolution créatrice. Si le nom de Bergson n’apparaît qu’une fois ou deux, les concepts bergsoniens hantent la plupart des pages du livre. Qu’il s’agisse de l’émergence des propriétés des corps que la nature invente sans jamais les déduire des propriétés antérieures, qu’il s’agisse de l’imprévisibilité des formes de vie qui se succèdent, qu’il s’agisse de la notion de possible revisitée par Michel Serres au point que certains paragraphes peuvent être lus comme de très pertinents commentaires de grandes pages bergsoniennes.
Et n’est-ce pas à nouveau Bergson qui, tel un prophète, annonçait la parution au siècle suivant du Gaucher boiteux, quand il écrivait : « je crois bien que notre vie intérieure toute entière est quelque chose comme une phrase unique entamée dès le premier éveil de la conscience, phrase semée de virgules, mais nulle part coupée par des points »7 ? Un peu comme si Le gaucher boiteux concluait une phrase unique que Michel Serres aurait commencé à écrire il y a près de cinquante ans, phrase qui elle-même entend s’inscrire dans la phrase-monde que la nature rédige depuis l’origine des temps.
- Michel Serres, Le gaucher boiteux, Paris, Essai Le Pommier, mai 2015.
—
- L’exemple le plus simple permettant de comprendre ce qu’est une « mise en abyme » est la boite de « Vache qui rit » de notre enfance : sur la boite une vache portant à son oreille, en guise de boucle, la boite de fromage représentant la vache portant à son oreille…, etc.,etc. ↩
- Petite Poucette, Paris, Le Pommier, mars 2012. ↩
- Antonio R. Damasio me pardonnera de lui emprunter le titre d’un de ses ouvrages majeurs. ↩
- J’ai eu la chance de suivre à Nice, où il était invité chaque année par la section de philosophie, les cours de Michel Serres sur le thème de la matière, sujet du concours de l’agrégation 1970. Son commentaire du De natura rerum de Lucrèce n’a jamais quitté ma mémoire. ↩
- Le contrat naturel, Paris, François Bourin, 1990. ↩
- J’ai eu moi-même l’occasion de comparer la condition humaine à celle d’un funambule en « équilibre déséquilibré » sur sa corde. Cf. A l’école du funambule, in Éloge de l’équilibre, Éditions L’Harmattan, 2009, p. 23-47. ↩
- L’énergie spirituelle, in Œuvres, Édition du Centenaire, Paris, P.U.F., 1963, p.858. ↩

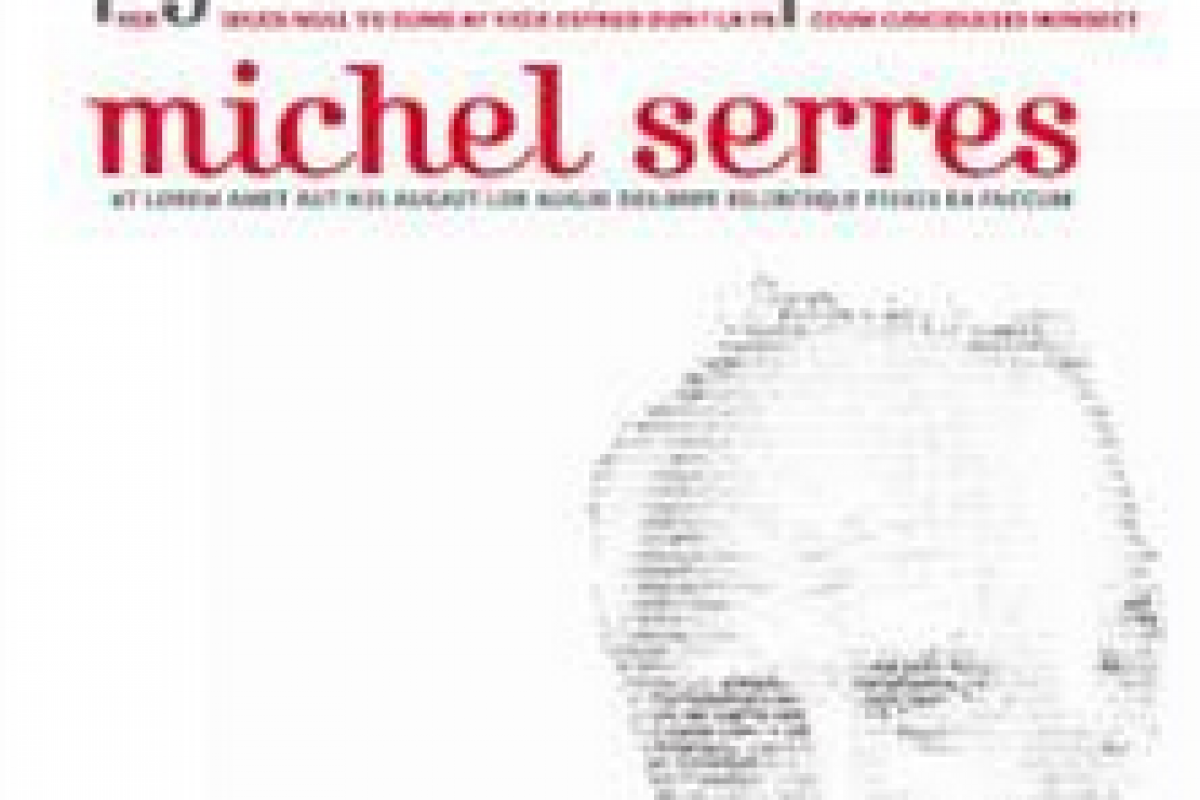
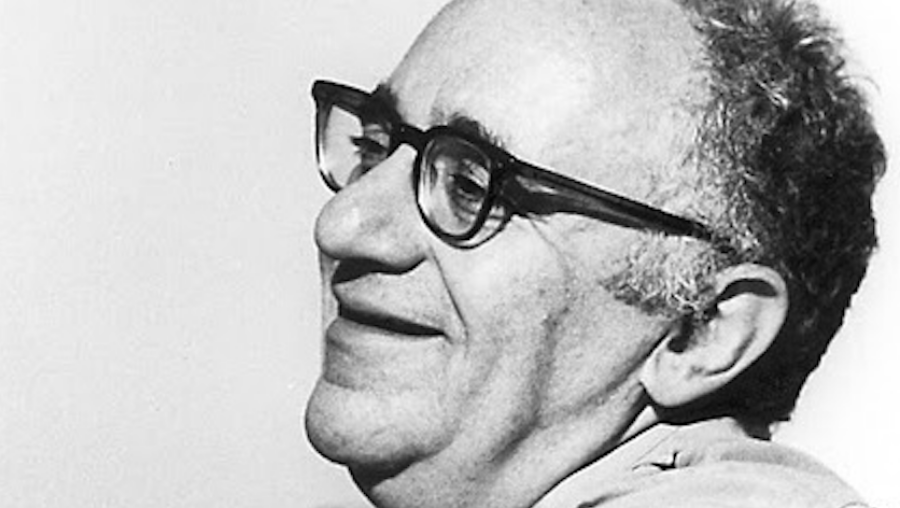


Michel Serres est l’un des rares philosophes s’exprimant dans les médias que j’ai plaisir à écouter, notamment sur France Info.