Par Catherine Le Bris1.
Un article de The Conversation
S’asseoir sur un banc dans un parc, rêver en regardant la mer sur la plage, dîner avec sa famille, ses amis, sortir faire ses emplettes, courir et respirer à pleins poumons… Être libre.
À vivre chaque jour ces libertés, peut-être en avait-on oublié leur caractère précieux. À les considérer comme acquises, peut-être avait-on occulté, aussi, qu’elles ne sont pas absolues. Aujourd’hui confinés, munis de nos attestations de sortie, nous expérimentons, ce que nombre d’entre nous, nés en temps de paix, dans un État de droit, n’avions encore que peu connu : les limites aux libertés.
Les droits de l’Homme permettent à l’individu de se définir et d’agir en toute indépendance, d’être autonome au sein du groupe dont il fait partie. Pour autant, l’individu n’est pas placé hors du groupe : c’est seulement dans le cadre de la « communauté » que « le libre et plein développement de sa personnalité est possible ».
C’est pourquoi l’individu doit exercer ses libertés dans le respect des droits d’autrui, en particulier des plus vulnérables, et de manière à « satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique ». L’État, lui-même, peut – voire, doit, dans certains cas – limiter les libertés individuelles, quand les circonstances l’imposent, en particulier pour des raisons sanitaires.
Ceci explique que même si chacun a, en principe, le droit de circuler librement, l’État a la possibilité de restreindre ou prohiber les déplacements pour éviter la propagation d’une épidémie telle que le coronavirus. C’est dans cet esprit que la France a adopté le décret du 16 mars 2020 (puis ceux des 19 et 23 mars) qui interdit à toute personne la sortie du domicile sauf exception.
L’état d’urgence n’est pas un blanc-seing
Des entorses aux libertés sont ainsi possibles en situation d’urgence, mais elles sont strictement encadrées : une dérogation aux droits de l’Homme n’est permise qu’« en cas de danger public exceptionnel », lorsque l’existence même de la nation est en cause et « dans la stricte mesure où la situation l’exige ».
Il peut s’agir d’un conflit armé, d’une catastrophe, de terrorisme ou d’une pandémie – « guerre sanitaire » contre un ennemi « invisible » – comme aujourd’hui, mais quoi qu’il en soit, la situation doit être particulièrement grave ; elle doit notamment menacer l’intégrité physique de la population.
L’État doit pouvoir justifier non seulement sa décision de proclamer un état d’exception, mais aussi et surtout chaque mesure concrète qui découle de cette situation. Ces mesures doivent remplir deux conditions : elles doivent être nécessaires, mais aussi strictement proportionnées, c’est-à-dire que l’intensité de l’atteinte aux libertés est fonction de la gravité de la menace. Pour être conforme aux exigences internationales en la matière, « chaque mesure doit être dirigée contre un danger réel, manifeste, présent ou imminent et ne peut être imposée par simple crainte d’un danger potentiel ».
De plus et surtout, avant d’adopter toute mesure, les autorités doivent s’assurer que les autres moyens, moins liberticides, sont manifestement inefficaces. Ainsi, si le port de masques ou des dépistages massifs sont éventuellement susceptibles de prévenir la contagion, les autres mesures telles que les interdictions de sortie ne sont, en soi, pas fondées. La situation est donc problématique lorsque les moyens nécessaires ne sont pas mis à disposition.
En général, en cas de danger exceptionnel, déroger à la liberté de mouvement et de réunion est suffisant : les autres libertés n’ont, en principe, pas à être impactées. S’agissant de la lutte contre le coronavirus, toutefois, le droit à une vie familiale normale se voit aussi limité puisque les rapports entre petits-enfants et grands-parents sont à éviter. Quant au droit au travail, il est soit aménagé (avec le télétravail), soit entravé selon les cas.
Certains droits, cependant, ne peuvent souffrir d’aucune limitation, y compris en situation d’urgence : tel est le cas, notamment, du droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants. À ce titre, il est strictement interdit, même en cas d’épidémie, de soumettre une personne, sans son libre consentement, à une expérience médicale ou scientifique : ni la recherche – qui est, elle-même, une liberté – ni les préoccupations de santé publique ne justifient qu’un médicament soit testé sur une personne qui n’a pas donné son accord dans le seul but d’en vérifier les propriétés. Un tel procédé est contraire à la dignité humaine.
La liberté de conscience et de pensée est, elle-même, par essence, absolue même si la liberté de manifester sa religion ou ses convictions peut, elle, être restreinte, ce qui explique que les rassemblements liés au culte puissent être temporairement interdits.
L’état d’urgence ne confère ainsi nullement un blanc-seing à l’État. D’ailleurs, lorsqu’il adopte des mesures d’urgence et décide de déroger aux droits de l’Homme, celui-ci est tenu de le déclarer formellement : il doit, selon les règles internationales, adopter un « acte officiel » proclamant le danger public exceptionnel.
Il est aussi tenu d’en informer aussitôt, entre autres, le Secrétaire général de l’ONU, et ainsi les autres États : il doit fournir au Secrétaire des explications circonstanciées sur ce qui l’a conduit à prendre ces mesures et sur les libertés ou droits qui sont suspendus. De la sorte, les organes de protection des droits de l’Homme des Nations unies peuvent s’assurer que l’État respecte bien ses obligations en la matière.
Si tel n’est pas le cas, l’individu dont les libertés ont été violées pourra adresser une « plainte » à ces organes, en particulier au Comité des droits de l’Homme des Nations unies (organe qui s’apparente à une juridiction et qui ne doit pas être confondu avec le Conseil des droits de l’Homme des Nations unies). Or si l’État n’a pas formulé de déclaration de dérogation, il lui est impossible d’arguer de la situation d’urgence pour justifier les violations de droits individuels en cas de « plainte ».
Pour proclamer l’état de danger exceptionnel, l’État doit suivre « les procédures prévues par la loi nationale » ; des procédures qui doivent être « établies avant la survenance du danger ». Cette dernière précision est essentielle car il n’est jamais bon de légiférer sur les libertés pour l’avenir lorsque l’on vit une situation de crise.
En France, c’est par le décret du Premier ministre du 16 mars, cosigné par le ministre de la Santé, que les libertés ont initialement été limitées. Il s’agissait donc d’un acte réglementaire, et non pas législatif, mais le décret s’appuie sur la loi de 2007 relative aux menaces sanitaires de grande ampleur. Ce texte autorise le ministre de la Santé (et non pas directement le Premier ministre) à prendre « toute mesure » pour protéger la santé de la population.
Les mesures en causes doivent être « proportionnées », mais elles sont néanmoins susceptibles d’affecter une liste de droits et libertés « impressionnante et presque sans limite ». De plus, « le Premier ministre peut, en vertu de ses pouvoirs propres, édicter des mesures de police applicables à l’ensemble du territoire, en particulier en cas de circonstances exceptionnelles, telle une épidémie avérée, comme celle de covid-19 » comme l’a rappelé, le Conseil d’État.
Reste qu’en réponse à la crise sanitaire, le choix a été fait de légiférer. Adopter ainsi une nouvelle loi, qui s’ajoute à celle du 3 avril 1955 sur l’état d’urgence de droit commun, n’est pas en phase avec l’esprit des textes internationaux de droits de l’homme.
Certes la finalité poursuivie est légitime puisqu’il s’agit d’associer le Parlement face à l’ampleur de la crise et de chercher à « concilier les impératifs d’efficacité dans cet objectif de santé publique avec les droits et libertés », mais « toute législation d’exception porte des risques de dérives ».
La nouvelle loi du 23 mars 2020 relative à l’épidémie de Covid-19 instaure un « état d’urgence sanitaire » (Titre Ier). Elle autorise le Premier ministre à limiter les droits et libertés par de nombreuses mesures, qu’il s’agisse de « restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret », d’« interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé » ou encore d’ordonner des mises en quarantaine.
Ces mesures doivent toutefois avoir pour « seule fin de garantir la santé publique ». Surtout, elles doivent être « strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu » ; et « il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires ». En d’autres termes, des mesures prolongées alors que le contexte sanitaire ne l’impose plus constitueraient une atteinte grave aux libertés.
De plus, la proportionnalité doit s’apprécier en fonction de la durée de la mesure : une dérogation à un droit, par exemple au droit au travail avec la fermeture des bars et restaurants, peut être proportionnelle un temps, mais ne plus l’être sur le long terme selon les circonstances.
On le voit, dans un tel contexte, les limites aux libertés sont largement tributaires du contexte sanitaire. C’est pourquoi il serait tentant pour les autorités de s’abriter derrière l’expertise scientifique.
Or si l’expert permet d’identifier un risque pour la santé (et joue donc un rôle essentiel à ce titre), c’est pourtant au politique qu’il appartient d’arbitrer entre ce risque et les libertés. D’autant que ni le Conseil scientifique ni le CARE (Comité analyse recherche et expertise) ne comprennent de juristes, ce qui est regrettable.
En toute hypothèse, il faut garder à l’esprit que la sécurité absolue (y compris la sécurité sanitaire) est contraire à la condition humaine. Il n’y a pas de liberté sans sécurité, mais une « sécurité dénuée de liberté ne peut être l’objectif d’une démocratie ».
Or, il n’est pas certain que l’équilibre entre l’une et l’autre soit respecté dans la loi organique qui sera prochainement promulguée. Selon celle-ci, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) n’a pas à être transmise et examinée par le Conseil constitutionnel d’ici le 30 juin.
En situation d’état d’urgence, on ne peut que le regretter sachant que la QPC permet de s’assurer de la conformité d’une loi aux droits et libertés garantis par la Constitution. Même si les cours suprêmes ne peuvent se réunir en formation collégiale, on pourrait peut-être imaginer des alternatives pour pallier cette difficulté.
Ni trop, ni pas assez : rechercher le juste milieu
Les dérogations aux libertés prises en cas de situations d’exceptions ne doivent en aucun cas pécher par excès. Toutefois, elles ne doivent pas, non plus, pécher par insuffisance. En effet, l’État a l’obligation internationale de prendre toutes les mesures qui sont nécessaires pour sauvegarder les droits de l’Homme.
Cela signifie que sa responsabilité internationale peut être engagée (devant la Cour européenne des droits de l’Homme notamment) non seulement s’il a, par son comportement, porté atteinte, de manière active, à un droit de l’Homme, mais aussi, si, par sa passivité, il n’a pas pris les mesures qui s’imposaient. Sur les autorités nationales pèsent ce qu’on appelle des « obligations positives » de telle sorte que celles-ci peuvent être sanctionnées pour leur inertie ou leurs insuffisances.
Ainsi, s’agissant du droit à la vie, l’État doit non seulement s’abstenir de porter atteinte de manière arbitraire à celle-ci, mais il doit aussi prendre toutes les mesures qui s’imposent pour la protéger à l’égard d’un individu déterminé ou de la population dans son ensemble.
Ni trop, ni pas assez : trouver le juste équilibre. Tel est, face à une pandémie, le devoir principal de l’État en matière de droits de l’Homme, celui de la mise en balance qui est le propre de la justice.
C’est sur cet équilibre, fragile, entre libertés et préoccupations sanitaires que le Conseil d’État s’est prononcé le 22 mars dernier. Saisi en urgence (en « référé » dans le langage juridique) par le syndicat Jeunes Médecins, il lui a été demandé de prononcer un confinement total de la population.
De l’avis du syndicat, les transports en commun devaient s’arrêter, de même que les activités professionnelles non vitales ; une interdiction absolue de sortie, sauf motif médical, devait être décidée et un ravitaillement de la population instauré. Pour les jeunes médecins, en s’abstenant de prendre de telles mesures, l’État portait atteinte au droit à la vie et à la santé de la population, en particulier du personnel soignant.
Le syndicat a adressé cette demande au Conseil d’État dans le cadre d’un « référé-liberté ». Cette procédure permet au juge d’ordonner, dans les 48 heures, « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale ».
Certes, la situation peut sembler quelque peu paradoxale : alors que cette procédure a pour but, en principe de parer une atteinte aux libertés, le syndicat de jeunes médecins l’utilise ici pour demander une restriction plus importante de celles-ci, en particulier de la liberté d’aller et venir.
Pour comprendre une telle contradiction, il faut savoir que, pour le Conseil d’État, « le droit à la vie » est aussi une « liberté », notion qu’il entend largement ; il est donc possible de recourir à cette procédure pour protéger la vie, en particulier en cas de carence de l’autorité publique (au nom des « obligations positives » précédemment évoquées).
Cette affaire le montre toutefois, le Conseil d’État gagnerait à clarifier la notion de liberté fondamentale : tous les droits de l’Homme ne sont pas des libertés ; certains d’entre eux tels que le droit à la vie sont des droits à l’intégrité ; ils conditionnent, il est vrai, l’exercice de la liberté, mais sans en constituer une eux-mêmes. En somme, cette procédure s’apparente davantage à un « référé-droits de l’Homme » plutôt qu’à un « référé-liberté » stricto sensu.
Or, dans le contexte actuel de pandémie, deux types de droits de l’Homme sont en conflit : d’une part, les droits à la vie et à la santé, et d’autre part, les libertés de circulation et de réunion. Sur un plan international, ces deux types de droits ne sont pas tout à fait sur un pied d’égalité : alors qu’il est possible de déroger à la liberté de circulation en cas d’état d’urgence, le droit à la vie est, quant à lui, intangible : les privations arbitraires de la vie sont interdites en toute circonstance.
Confronté à ce conflit, le Conseil d’État fait preuve d’une grande prudence. Il ne donne pas suite à la demande de confinement total, mais il enjoint le gouvernement de « réexaminer le maintien de la dérogation ‘pour déplacements brefs, à proximité du domicile’ compte tenu des enjeux majeurs de santé publique » et de « préciser la portée de la dérogation au confinement pour raison de santé ».
La pratique du jogging, en particulier, paraissait assez floue. C’est pourquoi, dès le lendemain de l’ordonnance du Conseil d’État, le 23 mars, Édouard Philippe a indiqué que l’activité sportive est désormais limitée à une heure par jour dans un rayon d’un kilomètre.
Le Conseil d’État renvoie ainsi le gouvernement à ses responsabilités. En effet, la mise en balance des différents droits de l’Homme est étroitement liée aux circonstances factuelles, en l’occurrence à la gravité du virus dans ses effets ou dans son mode de contagion.
C’est pourquoi, en cas d’épidémie, recevoir des informations précises revêt un caractère crucial ; c’est d’ailleurs aussi une liberté. Si les autorités peuvent être tentées de minimiser la gravité de l’épidémie pour éviter des vents de panique ou, au contraire, de dramatiser pour justifier des mesures fortes, elles doivent garder à l’esprit que tout un chacun a le droit d’être informé précisément de manière à pouvoir s’assurer que ses droits sont bien protégés et à apprécier la légitimité des dérogations à ceux-ci.
Ainsi, des informations détaillées sur le profil des victimes (en particulier leur âge, leur profil médical), sur les nouveaux foyers d’infection ou sur une mutation éventuelle du virus sont essentielles. Il en va de même s’agissant des traitements potentiels et leurs risques ou des mesures de prévention telle que l’intérêt du port des masques ou de gants même lorsque ces moyens ne peuvent pas être mis à disposition.
Outre le confinement, toute mesure doit être l’objet d’une mise en balance entre liberté et santé. Il en va ainsi notamment du « pistage numérique » envisagé pour lutter contre la propagation du Covid-19 comme cela se fait déjà dans certains pays : ces derniers jours, l’idée a été avancée d’identifier les personnes en contact avec celles infectées par le virus du Covid-19, en les géolocalisant grâce à leur téléphone.
L’impact de ce projet sur les libertés et droits, en particulier le droit à la vie privée, sera fonction des options techniques retenues si ce projet est mis en œuvre, en particulier du traitement de données anonymisé ou non et du caractère volontaire ou imposée de la démarche pour la personne concernée.
Respecter la règle d’or des droits de l’Homme, l’égalité
Par ailleurs, si l’État doit trouver le juste équilibre entre liberté et santé, il doit aussi respecter l’autre règle d’or des droits de l’Homme : celle de l’égalité.
Or deux types de personnes sont susceptibles d’être particulièrement impactés face à l’épidémie. D’une part, ceux qui, en temps normal, sont déjà confinés puisqu’ils évoluent dans des lieux d’enfermement : il s’agit en particulier des détenus ; or, le 30 janvier dernier, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme en raison de la surpopulation carcérale et de conditions de détention indignes. D’autre part, ceux qui ne peuvent pas se confiner puisqu’ils sont sans logement : ces personnes doivent être mises à l’abri et, en aucun cas, elles ne peuvent être sanctionnées.
En toute hypothèse, l’état d’urgence implique de faire preuve de la plus grande vigilance car il est propice à la violation des droits de l’Homme. Ainsi, les enfants ou femmes confrontés à des situations de violence au sein de leur famille sont d’autant plus exposés compte tenu du confinement.
Surtout, l’état d’urgence ne doit pas faire oublier que les droits de l’Homme comportent aussi un volet économique et social : il ne s’agit pas de droits abstraits ou « purs » comme on se les représente parfois. Ils impliquent, entre autres, le droit pour tout un chacun d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail et de jouir d’un niveau de vie suffisant.
Si des limites aux droits économiques et sociaux sont admises, l’État a néanmoins en tout circonstance « l’obligation fondamentale minimum d’assurer, au moins, la satisfaction de l’essentiel de chacun des droits ». D’où l’importance des mesures d’urgence économiques au bénéfice de tous ceux qui ont dû cesser leur activité ou l’ont vu ralentir, ou qui, sans emploi, n’ont pu se mettre en quête d’un travail.
C’est ainsi d’un point d’équilibre, constamment réajusté, réévalué, que découle la sauvegarde des droits de l’Homme en période de pandémie comme en d’autres temps : entre libertés et santé, l’État doit rechercher le juste milieu. Avec toujours l’égalité en perspective. « J’appelle mesure, disait Aristote, ce qui ne comporte, ni exagération, ni défaut » ; la vertu « tient la juste moyenne entre ces deux extrémités fâcheuses ».
—
- Chargée de recherche au CNRS, Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne, Paris 1, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ↩





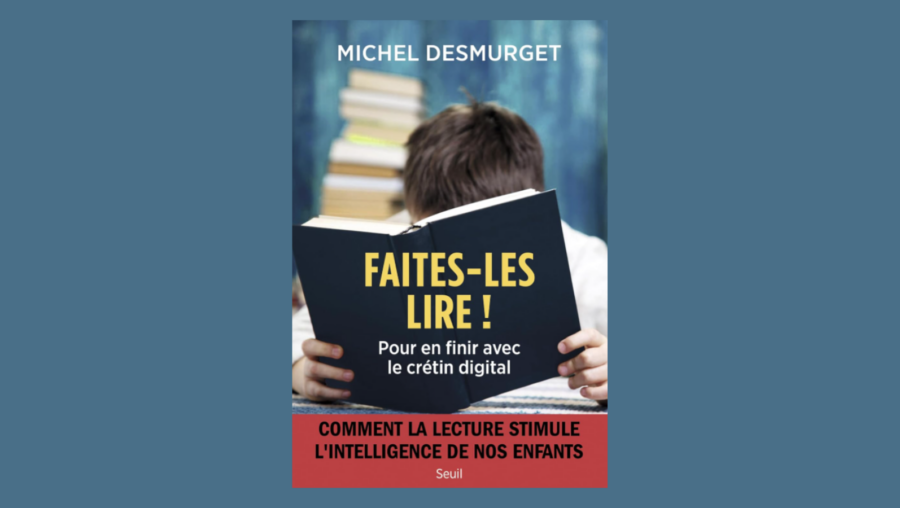
Et que dire des maires qui prennent des décisions plus restrictives que celles de l’Etat, seront-ils jugés pour excès ?
Cette affaire est à replacer dans un mouvement plus large de restriction des libertés qui s’étend en Occident. Rappelons-nous que la plupart des dispositions adoptées pour lutter contre le « terrorisme » ont perduré. On me dira que le terrorisme dure lui aussi, mais il faudrait analyser d’où il vient et pourquoi il dure.
Il y a fort à parier que ce nouveau vecteur de la peur induise lui aussi des mesures durables…
Un peuple qui a peur ne peut pas être libre…
Hélas, le peuple ne cessera jamais d’avoir peur.
Tant qu’il n’y a pas de masques disponibles, ils ne servent à rien pour le péquin,
mais le jour où il y en aura, ce sera 135 euros pour ‘non port de masque’…
Etat d’urgence sanitaire , oui mais qui a oublié de conserver des stocks suffisants de matériels médical de protection pour l’ensemble de la population ? Et pourquoi une dépendance à 90 % des pays asiatiques pour ces matériels , où peut-on trouver les responsables ?
Gouverner , c’est prévoir , y compris pour les comités théodules qui ne servent à rien en dehors de leur passages médiatiques;
Les commentaires sont fermés.