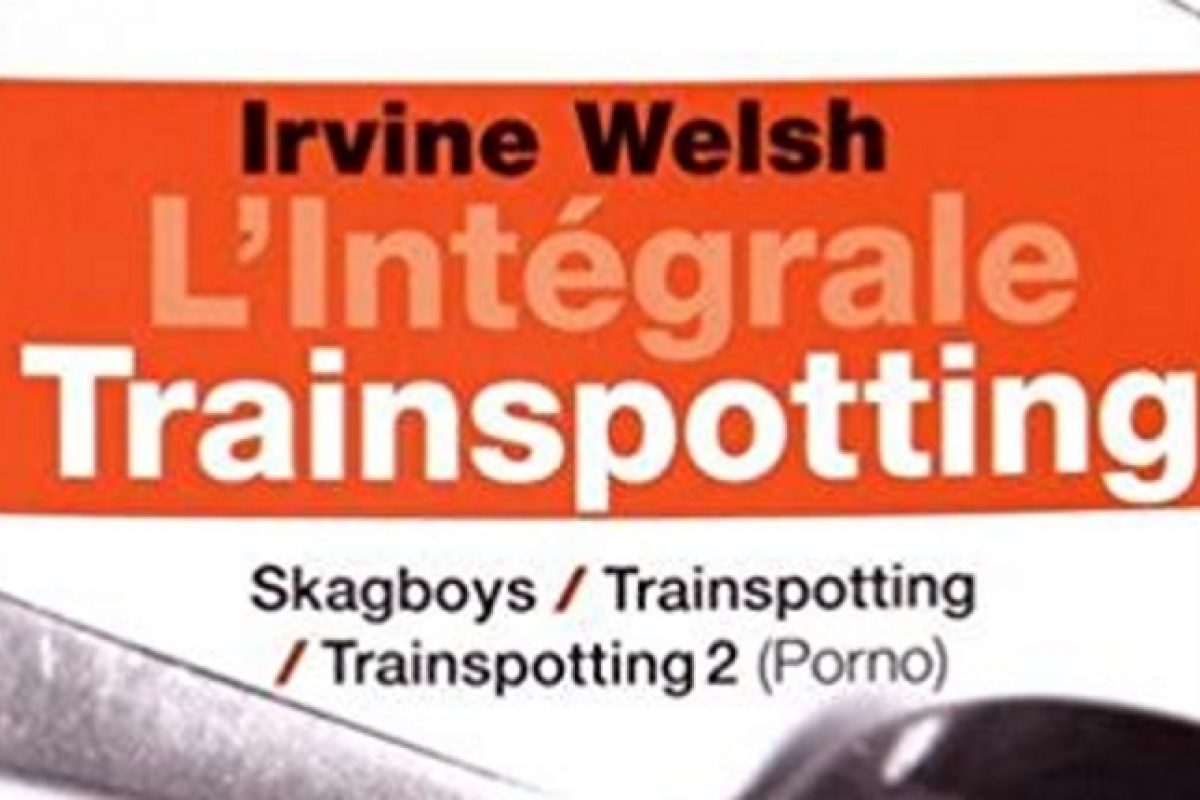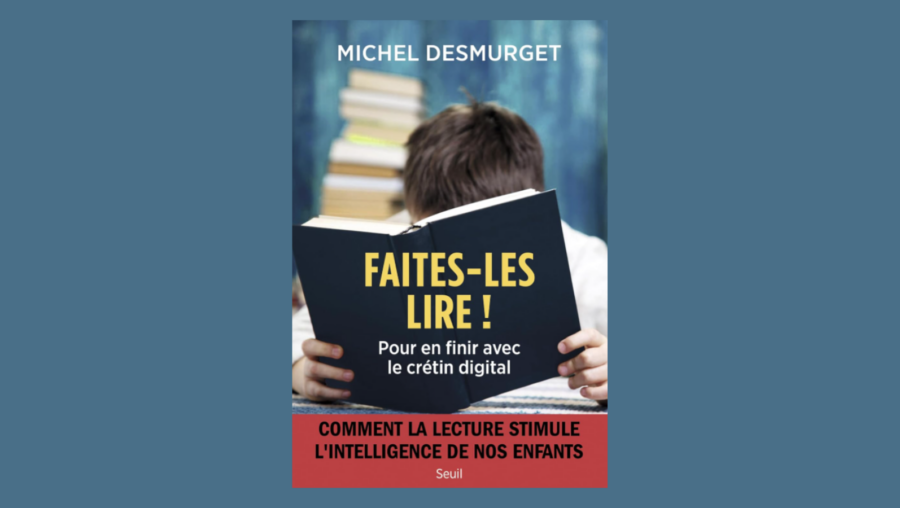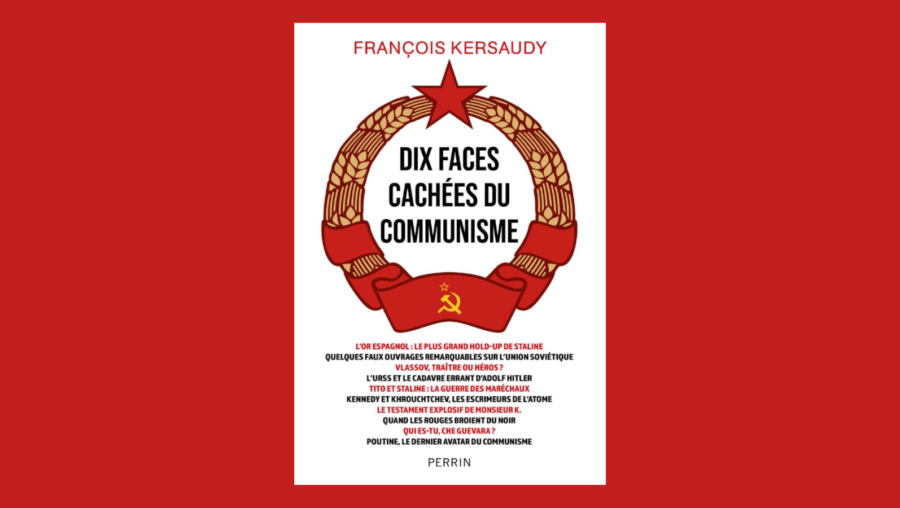Par Thierry Guinhut.
Depuis Les Paradis artificiels de Baudelaire et Gautier, et malgré leur prudence, un mythe tenace colle aux drogues, opium, héroïne, ecstasy, selon lequel elles sauraient assurer l’inspiration créatrice de l’écrivain et du poète. Cette sale légende, qui ne tient pas compte de tous ceux qui en sont morts ou ont dépéri sans la moindre capacité créatrice, ne tient guère dans l’esprit d’Irvine Welsh, icône trash des drogues et des sexualités. Cet Écossais graphomane, né en 1958 à Edimbourg, n’a pas attendu la piquouse ou le cachet pour booster ses capacités de travail et se targuer de l’enviable dignité de satiriste sous ecstasy, dans l’énorme triptyque de Trainspotting.
Trainspotting, satire à l’acide et au sida
Avec Trainspotting, Irvine Welsh s’est taillé en 1993 une sulfureuse réputation de spécialiste de l’addiction. Sordide, déjanté, le récit suivait à vau-l’eau quatre défoncés grave dans un Edimbourg ravagé par le thé, la bière, le chômage et la baston. Seul paradis, la seringue les délivrait un instant d’un manque à crever. Les veines brûlées jusqu’à l’os, nos anti-héros poursuivaient d’un amour-haine constant une héroïne toujours recommencée. « Drogue honnête », l’héro rend « immortel » pour aussitôt te crasher « dix fois comme le caca ambiant ». La mort fauche.
 Le style speedé, les images « à cent litres de salive à l’heure » peinaient à sauver ces saynètes mal raboutées, crades, scatologiques, ces pantins psychotiques, abjects, attendrissants, dont l’un s’en sortira peut-être, dont l’autre plonge la tête dans la cuvette des toilettes, dont l’autre encore enchaîne les dérives, aux dépens de celui qui ne peut plus que s’injecter les pissenlits par la racine…
Le style speedé, les images « à cent litres de salive à l’heure » peinaient à sauver ces saynètes mal raboutées, crades, scatologiques, ces pantins psychotiques, abjects, attendrissants, dont l’un s’en sortira peut-être, dont l’autre plonge la tête dans la cuvette des toilettes, dont l’autre encore enchaîne les dérives, aux dépens de celui qui ne peut plus que s’injecter les pissenlits par la racine…
À quoi donc peut croire un ado d’Edimbourg dans un appartement destroy où le père chômeur a quitté une mère alcoolique, lorsqu’au bas des ascenseurs les éclats de bouteilles fusent vers les immigrés Indiens ? Faute d’une volonté intime, d’un contexte éducatif propice, que reste-t-il, sinon le désespoir et l’insolence, « la défonce » enfin ? La brusquerie de l’image dit bien les deux pôles de l’échappatoire. Défoncé comme on éclate une poubelle qui n’a plus apparence ni raison d’être, et dont le néant permet l’abstraction totale d’un réel immonde ; défoncé comme le passage d’une « porte de la perception » vers un au-delà aux promesses affolantes… Sexe, drogue et utopie impossible sont les contrées soudées de la « défonce » où les personnages d’Irvine Welsh, mais aussi de son contemporain anglais Will Self, font leur nid.
Un œil délicat, coutumier des cattleyas proustiens et des bonnes mœurs du langage, ne peut qu’éprouver une implacable nausée devant ces quatre copains crados, scatos, scotchés à leur héroïne et ravagés par le sida… Abonnés à l’assurance chômage, ils dopent une intrépide narration avec le désir et le manque récurrents de ce « jus qui donne la vie et la reprend » :
Prends ton meilleur orgasme et multiplie-le par vingt et tu seras encore à des kilomètres du résultat. Mes os friables et desséchés sont dorlotés et liquéfiés par les tendres caresses de ma belle héroïne.
Portées par un style gangrené de métaphores et de grossièretés « top dance » ces saynètes mal torchées font fureur et mouche, même lors de cette célèbre scène de cuvette de water closet qui empuantit autant la page que l’écran. Un amputé, un crevé qui « n’était plus qu’un morceau rabougri de peau et d’os », des séropositifs, un seul décrochera peut-être… Un bilan affligeant, une œuvre néanmoins efficace. Au point que le succès de Trainspotting poussa d’intelligents politiques à s’interroger sur la vanité de la prohibition. Jusqu’à The Independant qui fit campagne pour la légalisation du cannabis…
On peut se demander alors par quel miracle paradoxal, des récits qui ne laissent place à aucun salut par les drogues, sauf par brefs flashes, et n’en montrent que la déchéance, qu’il s’agisse de Morphine de Boulgakov ou du Roman avec cocaïne d’Aguéev, jusqu’à notre Trainspotting, bénéficient d’une telle aura chez des lecteurs plus ou moins consommateurs, du joint à l’héro en passant par la coke. À moins de trouver dans la littérature une dimension transgressive faussement héroïque, même et surtout -pulsion de mort oblige- par l’intermédiaire d’anti-héros, dimension qui fait défaut dans le quotidien.
Une réputation souterraine emporta cependant ces pages vers les sommets du livre culte. Jusqu’à ce que le film de Danny Boyle vienne shooter et speeder les écrans. Et vienne conforter le mythe selon lequel Trainspotting est le sismographe d’une société déglinguée marquée par l’ère Thatcher, et dont cette dernière aurait été la responsable. C’est bien vite inverser cause et conséquence, plaie et guérison, en accord avec l’idéologie antilibérale. Car la ruine de l’État providence travailliste, donc socialiste, en est la cause, et le néolibéralisme de Madame Thatcher, le remède, certes pas toujours miraculeux, puisque sous son premier mandat, le chômage anglais, auparavant astronomique, fut divisé par deux…
Le sillon fut poursuivi -et pas encore jusqu’à la lie- au moyen d’un roman, Marabou Stork Nightmares, dans lequel un narrateur comateux est traversé de flash-back : une famille de psychotiques, les taudis d’Edimbourg, un suicide au sac en plastique. C’est violent, cousu de culpabilité, de revendications politiques, d’homosexualité et d’ecstasy. Le portrait du moi contemporain est implosif, un rien influencé par Martin Amis, et loin des complaisances nombrilistes pauvrement osées des prêtres et prêtresses de l’autofiction.
De Skagboys à Porno, la boucle de l’Intégrale
L’Intégrale Trainspotting est en fait un triptyque formé de Skagboys, Trainspotting et Porno ; une sorte de roman de formation, voire de déformation, d’une bande potes, de l’enfance à l’âge adulte, parmi la déshérence urbaine.
Skagboys, à rebours de la chronologie créatrice d’Irvine Weslsh, puisqu’il le publia en 2012, est le premier volet de l’hydre à trois têtes, qui cultive à outrance le filon. Le « skag » est le doux nom de l’héroïne, seule drogue que n’a pas encore essayé le quatuor de déjantés : nous avons nommés nos comparses Renton, Spud, Sck Boy et Begbie, fort connaisseurs en speed, acide et autres saloperies. Dès le shoot initial, nos anti-héros de l’héroïne creusent la fosse d’excréments de l’addiction. En toute logique, l’un sombre dans la délinquance et la violence, l’autre devient un terrible psychotique, l’autre perd son boulot. Seul Sick Boy parait avoir la possibilité de réchapper de l’exclusion sociale, cet euphémisme qui rejette la faute sur la société.
On navigue de pubs en rues mal famées, on drague les filles et les « skaggirls ». Doses de manque et de sexe, de manque et de came, de manque et d’alcool, se succèdent avec une invention de péripéties scabreuses que l’on n’eût pas cru possible. On vit, fort mal, du « chomdu » et sans complexe :
Les types qui bossent sont incapables de comprendre la vie d’un dilettante. Si je travaille pas, c’est par choix, bande d’abrutis.
Les fêtes succèdent à l’oisiveté, les plans foireux aux copineries peu fiables. Un ersatz de métaphysique de comptoir survole le tout :
Ça fait déjà longtemps que j’ai accepté que l’univers était un vrai bordel, imparfait et alambiqué.
Quelques personnages sont un peu plus clairvoyants : « c’est la consommation de l’alcool de coke qui les a tous fait basculer dans cette misère ». Sans compter la liste qui conclut le roman : celles de ceux qui sont atteints du sida, sans plus d’espoir. L’intérêt sociologique est évident, si l’intérêt dramatique et littéraire, hors le sociolecte des personnages, l’est moins. Hors la typographie particulière des pages du « Journal de réhab » qui n’est pas sans fatiguer les yeux et la patience du lecteur, le rythme saccadé et les métaphores branchées, vigoureuses, agrippent le lecteur.
Après le succès de Trainspotting, odyssée réaliste, répugnante, enjouée, pathétique et tragique d’un groupe d’accros aux drogues gagné par le sida, on attendait la suite : ce fut, en 2002, Porno. Le moins que l’on puisse dire est que la concision n’est toujours pas le fort de Welsh. Cependant la capacité de ses personnages à s’emparer des mythes de notre société de licence et de médias est avérée lorsqu’ils croient rebondir au-delà de leur galère en montant le coup du siècle : Sick Boy va tourner un porno avec la sulfureuse Nickki. La réussite à Cannes tourne court : arnaques, enquête de police et grand blessé. L’industrie du porno procure un instant l’argent et la gloire, sans supplément d’âme : les « capotes usagées et pleines » sont « des soldats morts sur un champ de bataille, un holocauste ». Le porno reste sous culture de masse, consommation, addiction : « une illusion de disponibilité ». Triste morale : il n’y a pas de rédemption dans le cycle maudit de Trainspotting.
- Irvine Welsh, Trainspotting, l’intégrale, Au Diable Vauvert, mars 2017.
—