Si Orwell inspire évidemment le titre et la forme de La Nouvelle Ferme des animaux, d´Olivier Babeau, c´est en réalité une œuvre publiée un an avant Animal Farm qui fournit la matrice intellectuelle de cette brillante « fable politique et économique à l’usage des hommes » : La Route de la servitude, de Hayek.
Comment un peuple épris de liberté, qui se choisit des institutions fondées sur les idéaux de république et de démocratie, peut-il, après une trop brève période de prospérité, sombrer progressivement dans la misère économique, la détresse sociale et la médiocrité morale, au point de ne plus trouver, pour seul remède à ses malheurs, que la négation de la liberté, la diabolisation de l’individu, le rejet de l´étranger et l´idéalisation de l’autoritarisme fascisant ?
C’est la question à laquelle le grand économiste et philosophe viennois apportait une réponse ô combien dérangeante en 1944, et qu’Olivier Babeau actualise en disséquant, avec un humour impitoyable et un sens inné de la pédagogie, certains mécanismes trop mal compris des démocraties contemporaines.
Pour se maintenir au pouvoir, les hommes politiques sont condamnés à user de plus en plus systématiquement du pouvoir de réglementation et de prélèvement fiscal de l’État pour distribuer des avantages de toutes natures aux différentes catégories qui composent leur électorat. Mais ces dispositifs clientélistes, dont les bénéfices pour les populations concernées sont identifiables, mesurables, et célébrés sans retenue par la propagande officielle, ont un coût indirect, diffus, souvent réparti sur l’ensemble de la collectivité, difficile à quantifier et soigneusement négligé par les dirigeants et les observateurs.
Ce coût est considérable, il explique même la plupart des problèmes économiques et sociaux des sociétés contemporaines, ce que seule une analyse attentive et honnête permet de comprendre. Mais les dirigeants en place et la troupe des intellectuels serviles qui vantent leur action préfèrent toujours attribuer ces maux aux « excès du marché », à « l’égoïsme des individus », à la « domination des possédants », à la « quête éhontée du profit ». Cela leur permet, pour paraître utiles, de proposer toujours plus d’interférences coercitives des pouvoirs publics dans la vie économique et sociale, qui à leur tour créent des effets pervers appelant davantage d´interventionnisme étatique.
À chaque stade de ce cercle vicieux, le discours antilibéral de plus en plus décomplexé accrédite, auprès du public, l’idée que c’est la liberté qui est coupable, et qu’une bonne dose d’autoritarisme ne serait pas inutile… jusqu’au jour où les électeurs finissent par traduire pleinement ce sentiment dans leur vote. Telle est la dangereuse dérive qui guette les démocraties où se conjuguent antilibéralisme, clientélisme et démagogie. Et tel est le sort pitoyable qui frappe la ferme des animaux.
Platon, le président élu des animaux, est un cochon cynique, pas très intelligent mais habile et manipulateur. Sitôt élu, il se vautre dans le luxe, engraisse à vue d’œil et justifie son niveau de vie quasi-monarchique par la nécessité d’assurer la dignité de sa fonction et le prestige de la communauté à l´extérieur.
« Platon portait à présent le plus souvent une des vestes en velours côtelé de l’ancien fermier. Les manches avaient été ajustées à ses courtes pattes avant, et le dos cintré afin d’amincir sa silhouette. Malgré tous les efforts de la poule couturière spécialement appointée, il avait surtout l’air d’une grosse saucisse empaquetée dans un sac de velours ».
Cela n’empêche pas le vénérable politicien de constater avec plaisir qu’il a nettement plus de succès auprès de la gent féminine depuis qu’il est au pouvoir.
« Le protocole était invariable : la truie était introduite par une porte détournée dans le manoir puis menée directement dans la chambre à coucher. D’un naturel peu romantique, Platon avait horreur des préliminaires et témoignait immédiatement sa passion de la façon la plus directe. Cinq minutes plus tard, le cochon émettait un grognement rauque, signal que la truie pouvait être reconduite. « Merci pour ce moment », glissait-il à la femelle étourdie par la brièveté de l’assaut avant qu’elle ne sorte ».
Terrorisé à l’idée de perdre les élections (lucide, il se sait parfaitement incompétent pour toute autre activité professionnelle), Platon comprend vite qu’il doit convaincre ses électeurs qu’il leur est indispensable malgré ses échecs systématiques.
Pour cela, il peut compter sur l’aide indéfectible de trois types d’intellectuels qui, chacun dans son registre, lui fournira des arguments justifiant sa glorieuse action et flattant son ego.
Le premier est le chat Savonarole, félin filou, prêcheur charismatique et illuminé, idéologue mystique toujours prompt à justifier la soumission au collectif et au pouvoir terrestre par la volonté divine.
Le deuxième est le renard Goupil, principal conseiller de Platon, technocrate d’élite, intelligent et machiavélique, qui retournera sa veste sans vergogne, non sans avoir, au préalable, érigé de multiples dispositifs administratifs aussi complexes qu’inefficaces.
Le troisième est la taupe Jeanne, économiste « experte en création de richesses », incarnation désopilante de l’aveuglement keynésien, focalisée sur le court terme, aussi myope que sophistiquée, qui conseille un « plan de redémarrage » aux conséquences catastrophiques.
Platon et Goupil commencent par consolider leur pouvoir nouveau en expliquant que l’économie est un jeu à somme nulle, que la « fracture de l’inégalité » menace, et qu’il leur faut des moyens pour « coordonner les actions individuelles ». Ils rendent progressive la contribution aux « Services Communs », pour assurer un début de redistribution fiscale, et traitent « d’individualiste asocial » le malheureux mouton qui ose demander pourquoi il travaillerait davantage dans ces conditions. Pour les animaux les plus démunis, un « Service de la Gestion des Inégalités » est mis en place : à l’issue d’un épuisant et kafkaïen parcours bureaucratique, le demandeur obtiendra une compensation temporaire égale « au tiers de la moyenne des revenus du dernier décile ».
Un déluge d’aides sociales s’abat sur la Ferme.
« Il y avait ainsi une allocation spécifique réservée aux poules rousses pondeuses pesant plus de trois kilos, une autre pour les lapines veuves ayant eu plus de cent lapereaux, une autre encore pour les chèvres dont les cornes étaient plus courtes que la moyenne. Petit à petit, la moindre différence pouvant être interprétée comme pénalisante fut assortie d’une compensation particulière ».
Platon est triomphalement réélu. Mais la lourdeur de la fiscalité, le poids des réglementations et les effets désincitatifs des mesures de protection ont des conséquences économiques désastreuses : baisse de la production, hausse du chômage, délitement du lien social.
Platon lance alors un « Plan de partage de la tâche », un « Plan de justice pour des chances égales » et un « Prélèvement spécial de crise pour la sauvegarde des services communs », tout en fustigeant la « quête obsessionnelle du profit » des employeurs qui n’embauchent pas assez.
Face aux conséquences encore plus calamiteuses de ces nouvelles actions (désorganisation, retards, gaspillages, baisse de la qualité des produits, grogne sociale, etc.), Platon crée une « Allocation fourragère de solidarité ».
Il affirme que « la solution est dans plus de protection » et que « la Ferme doit être une mère pour nous tous. Une mère qui protège ses enfants des dangers et qui sait aussi leur interdire ce qui pourrait être mauvais pour eux, même s’ils ne le savent pas ».
Il décide aussi de multiplier les embauches d’agents publics, ce qui contribue accessoirement à consolider son électorat.
La seule courageuse voix à s’élever contre cette course folle vers l’abîme collectiviste est celle du cheval, modèle de bravoure, d’intégrité et de rationalité. Ce superhéros au nom évocateur (Randy) est ridiculisé par le pouvoir et accusé de rechercher – crime suprême – la « casse des Services Communs ». Écœuré par tant de cynisme et d’incompétence, il finira par jeter l’éponge en allant contribuer, avec d’autres exilés, à la prospérité des fermes voisines.
Sur les conseils de la taupe, Platon actionne vigoureusement la planche à billets, embauche des fonctionnaires à tout-va, augmente leurs salaires sans compter et lance des grands travaux absurdes. Cela ne fait qu’engendrer une explosion de la demande et des prix, puis une dévaluation massive qui ruine les épargnants.
Pour dissimuler la hausse continue du chômage, Platon en trafique les chiffres et crée des « Emplois du futur à venir ». Il lance une extension sans précédent de la sphère publique : dans la vie des animaux, tout est de plus en plus réglementé, encadré, régulé, contraint, orienté, organisé par des administrations toujours plus nombreuses et tatillonnes. L’expression « Services Communs » est ressassée ad nauseam par la propagande officielle. Le marché noir est en plein essor, et la Ferme est au bord de la faillite. Qu’à cela ne tienne, Orphée, le rossignol chargé de clamer la bonne parole gouvernementale, fustige le pessimisme des déclinistes.
Platon use et abuse de l’endettement auprès des communautés voisines.
« La fermière élue de la ferme des Tudesques, une grosse poule qui ne s’en laissait pas compter, accorda un prêt, mais les négociations furent beaucoup plus difficiles que prévu ».
La crédibilité de la Ferme s’effondre et le taux d’intérêt qui lui est appliqué augmente. Platon reconnaît que les autres fermes sont plus prospères, mais il affirme que leurs habitants sont « perdus dans l’enfer d’un individualisme forcené ». Il attise le ressentiment contre elles, restreint les visites d’animaux étrangers et chante les louanges de l’autarcie et de l’autosubsistance. La famine et la violence se répandent dans la Ferme qui se trouve au bord du chaos.
Platon joue alors son va-tout, il instaure un régime semi-autoritaire : « tout ce qui n’est pas permis est interdit ». La surveillance est généralisée, les loisirs encadrés, un salaire universel créé, l’enthousiasme productif au travail contrôlé par un « Service de la Cohésion Égalitaire Durable ». Mais la situation ne s’améliore aucunement. La famine n’épargne plus que les dirigeants politiques.
La colère gronde dans la Ferme. Les animaux sont à bout. Un concurrent inquiétant se prépare avec efficacité aux prochaines élections : le rat Maximilien. Il propose de lutter contre les inégalités de manière encore plus autoritaire et de renvoyer les animaux étrangers chez eux. Ses propositions connaissent un succès fulgurant.
Platon assiste, incrédule et désabusé, à l’ascension irrésistible du rat facho-jacobin.
« Voilà qu’une nouvelle opposition était née, à travers un rival qui avait l’audace d’aller encore plus loin que lui, appliquant en la portant à l’extrême la stratégie qui lui avait valu de réussir ».
Chacun appréciera ce livre en fonction de sa sensibilité philosophique personnelle.
Le libéral y goûtera la mise en scène jubilatoire des théories de ses penseurs favoris, par exemple sur le fonctionnement économique du marché politique (Buchanan et l’école du Public Choice), les effets crétinisants de la propagande étatiste (Nemo), la négation obstinée des faits par les antilibéraux (Revel), le désastre des manipulations monétaires par la puissance publique (monétarisme de Friedman et surtout école autrichienne, de Mises à Salin), l’exaltation de la rationalité et de la responsabilité (Rand), les sophismes et illusions des politiques publiques (Bastiat), l’antilibéralisme pavlovien et l’étatisme idolâtre des intellectuels (Aron, Hayek, Boudon), la troublante résignation des masses face à la servitude (La Boétie), les tendances maternelles de la démocratie pré-totalitaire (Schneider, Laine), le phénomène du pouvoir dans les bureaucraties complexes (Crozier), les vices intrinsèques de la démocratie et de l’État-providence (Rothbard, Hoppe), etc.
Quant aux étatistes (de droite comme de gauche), certains ricaneront avec mépris et ne verront dans tout cela que caricatures, exagérations, simplifications et vaines théories. Il est à craindre que, comme les animaux de la ferme qui se sont longtemps laissés berner par le cochon Platon, ils ne se résignent un jour à offrir leur vote au parti de Maximilien. Les autres trouveront dans cette talentueuse fable un éclairage instructif sur les causes réelles et les conséquences possibles, sinon probables, de leurs préjugés antilibéraux.
- Olivier Babeau, La nouvelle ferme des animaux, éditions Les Belles Lettres, janvier 2016, 144 pages.


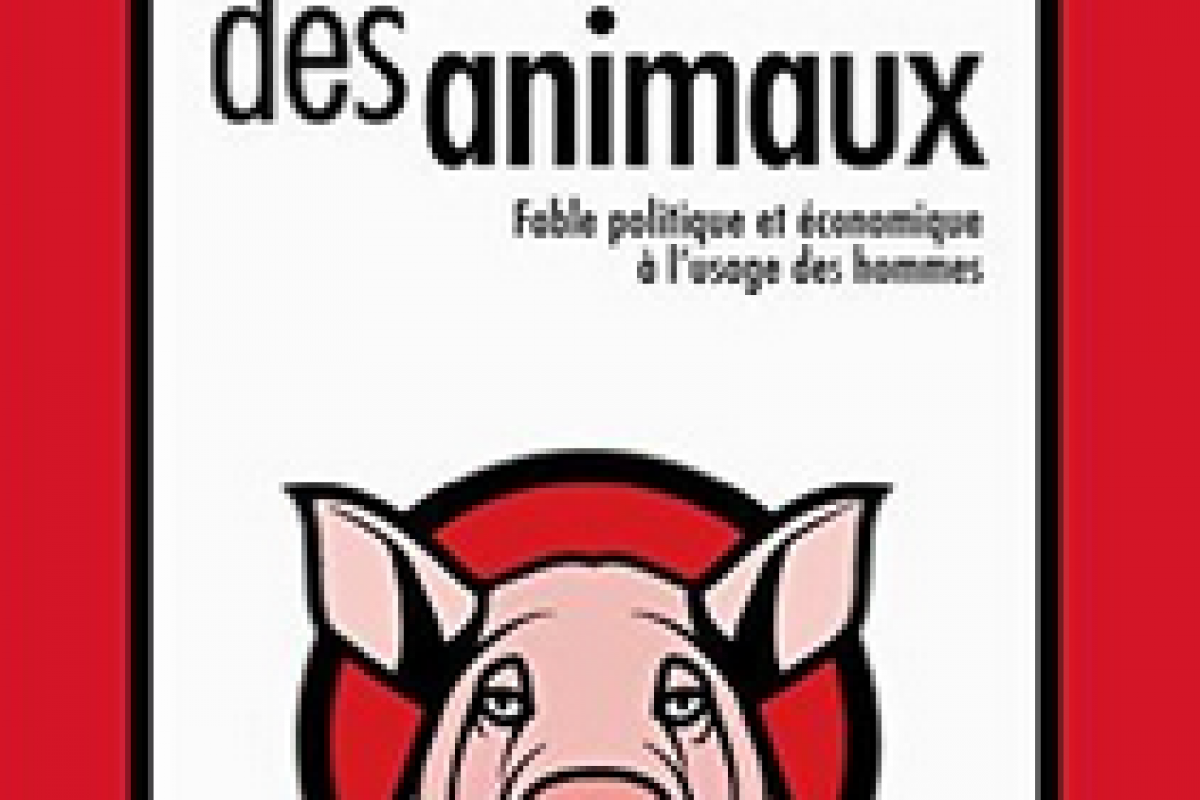



Terriblement d’actualité, avec entre autres le cochon et ses maîtresses.
Les commentaires sont fermés.