Par Guillaume Nicoulaud.
Pour ceux d’entre nous qui s’intéressent à la voile en général et aux régates en particulier, le 13 mai 1995 reste une date mythique. Ce jour-là, dans la baie de San Diego, la Team New Zealand de Peter Blake remportait sa cinquième manche d’affilée face à l’équipe de Dennis Conner avec une avance de près de deux minutes. La coupe de l’America était désormais néo-zélandaise après 144 ans de domination presque interrompue des Américains1.
Si vous connaissez un peu l’histoire de la coupe, vous savez que cette compétition n’est pas que sportive : c’est aussi un défi technologique, financier et organisationnel. Défi technologique parce que de la fameuse goélette qui a donné son nom à la coupe2 aux catamarans sur foils qui seront utilisés lors de la 35ème édition, tous les engins qui ont participé à cette compétition étaient à la limite des compétences techniques de leur époque. Défi financier parce que l’histoire de la coupe c’est aussi celle de la victoire des méthodes de financement modernes – les syndicats de J. P. Morgan ou d’Harold Vanderbilt – sur les tentatives chevaleresques de leurs opposants anglais – notamment Sir Thomas Lipton.
Défi organisationnel, enfin, parce la victoire dépend d’une multitude absolument invraisemblable de détails. Une coupe de l’America, c’est un cas d’école du syndrome de l’o-ring3 : la moindre erreur, aussi insignifiante puisse-t-elle sembler, peut réduire à néant des mois d’efforts. La conquête du Auld Mug est, et a toujours été, un projet de très haut niveau ; un projet qui ne peut être mené à son terme que par une équipe composée d’individus exceptionnels mais aussi, et surtout, par une équipe parfaitement organisée.
On a beaucoup épilogué sur les causes de la victoire de la Team New Zealand de 1995. Le budget de Peter Blake étant relativement limité, on a surtout évoqué le talent de skipper de Russell Coutts, l’excellence des choix tactiques de Brad Butterworth et, naturellement, les performances exceptionnelles du fameux Black Magic (NZL-32), le bateau le plus rapide de la compétition. Tout ceci est vrai mais ce que les commentateurs ont largement sous-estimé et qui est, à mon sens, la cause la plus fondamentale du succès des Néo-zélandais, c’est que Peter Blake était un véritable génie du management.
Le secret de Sir Peter Blake
Peu de gens le savent mais durant toute la préparation de la coupe, Pete Mazany, un universitaire d’Auckland, a suivi et conseillé Blake sur la meilleure façon d’organiser son équipe. Quelque temps après la victoire des kiwis, j’ai pu me procurer une copie de Team Think, le volumineux rapport dans lequel Mazany avait consigné soigneusement tous les détails. Une idée, en particulier, me semble bien résumer la philosophie managériale de Blake4 : la différence entre un groupe et une équipe c’est que dans une équipe, tous partagent le même objectif.
Ce que Blake a compris, fondamentalement, c’est la règle la plus essentielle de toute organisation humaine : quel que soit le système que vous souhaitez mettre en place, vous devez toujours partir du principe que les gens poursuivent leurs intérêts personnels. Toujours. Bien sûr, il existe des individus qui sont prêts à se sacrifier pour une noble cause, pour obéir aux dieux ou par conviction politique. Mais si vous concevez une organisation dont le bon fonctionnement requiert que tous acceptent de faire passer leurs intérêts particuliers au second plan, vous courez droit à l’échec.
De là, il suit que vous devez faire en sorte que les intérêts de chacun des membres de votre équipe soient parfaitement alignés, pour ne pas dire confondus, avec votre objectif. Ce que Blake voulait, c’était ramener la coupe à Auckland ; ce qu’il a du faire pour y parvenir c’est comprendre exactement ce que chacun des membres de son équipe venait faire dans cette aventure, ce qui les motivait et ce qu’il fallait donc leur offrir pour qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes et travaillent en équipe.
E pluribus unum
Pour un type comme Russel Coutts, par exemple, l’aspect financier était sans doute très secondaire. Quand on est déjà deux fois champion du monde de match racing5, s’il y a bien une coupe qu’on rêve de rajouter à son palmarès pour inscrire définitivement son nom dans la légende, c’est le Auld Mug. Qu’a fait Blake ? Eh bien là où Dennis Conner n’aurait lâché les commandes de son Stars & Stripes pour rien au monde, il s’est attribué un rôle subalterne à bord et a offert à Coutts l’objet de ses rêves : la barre de Black Magic.
Prenez Tom Schnackenberg, le designer en chef6 et navigateur de l’équipe : qu’est-ce qui peut bien le motiver ? Bien sûr, comme Coutts, il rêve d’inscrire son nom sur la liste des designers de légende – les Starling Burgess, Charles Ernest Nicholson et tutti quanti – mais seriez-vous étonné ou scandalisé qu’il puisse aussi espérer en tirer quelque avantage matériel ? C’est l’évidence même : quand vous faites profession de dessiner des yachts de course, être de ceux qui ont conçu un vainqueur de la coupe de l’America ça vous remplit un carnet de commande pour quelques décennies.
Et maintenant, considérez les anonymes, ceux dont on n’a pas retenu le nom, ceux qui n’apparaissent pas sur la photo et pour cause : l’essentiel de leur travail se déroulait dans un hangar à l’abri des regards comme, par exemple, lorsqu’il fallait passer une nuit entière à poser une nouvelle quille sous Black Magic. Qu’ils aient tous participé à une aventure passionnante ne fait aucun doute mais laissez-moi vous dire une bonne chose : avec une prime sonnante et trébuchante à la clé, on est moins sensible à la fatigue et on laisse plus volontiers ses états d’âme à la porte du hangar.
Voilà le génie de Blake : en s’assurant qu’il comprenait exactement ce que voulaient les uns et les autres – « no hidden agenda » écrira Mazany – et en mettant en place les incitations adéquates, il a fait coïncider les objectifs personnels de chacun des membres de son équipe avec celui de la Team New Zealand toute entière. C’est peut-être moins poétique que, par exemple, la magie du maillot sur laquelle certains comptaient en envoyant les Bleus de 2010 en Afrique du sud mais ça fonctionne. Que ce soit pour une compétition sportive, une entreprise ou dans un cadre encore plus large (devinez), nier l’individualité des hommes n’a jamais rien apporté de bon. Toute communauté humaine est avant tout composée d’individus ; le reste n’est que littérature.
- Jusque-là, seule l’équipe d’Alan Bond et John Bertrand sur Australia II était parvenue à ravir le Auld Mug au New York Yatch Club en 1983. ↩
- L’America ; la coupe s’appelait à l’origine la One Hundred Guinea Cup. ↩
- Du nom du joint en caoutchouc responsable de l’explosion de la navette Challenger en 1989. ↩
- Ayant bêtement perdu l’original, je vous la cite de mémoire – d’où l’absence de guillemets ↩
- En 1992 et 1993. Il remettra ça en 1996. ↩
- Black Magic avait deux particularités : il était rapide, très rapide et il n’était pas le fruit du travail d’un seul homme mais celui de toute une équipe et notamment de son équipage. ↩






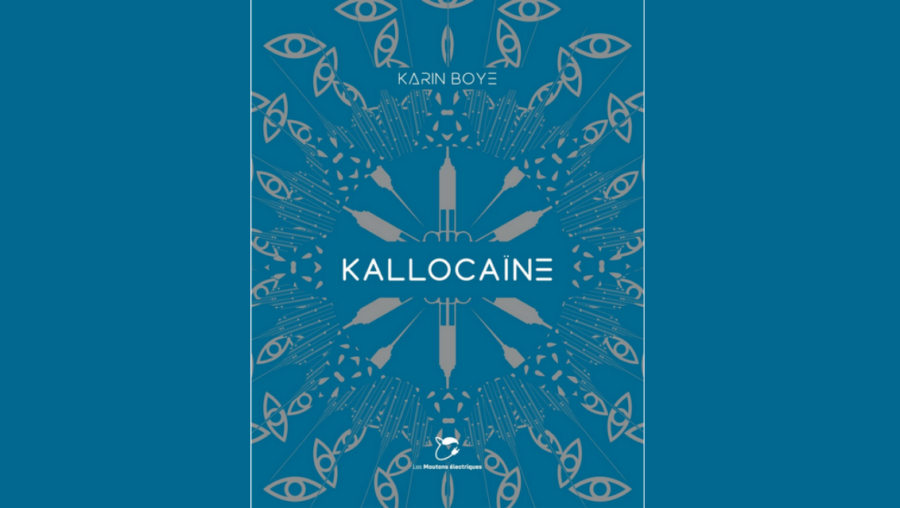
bonjour ,ancien navigant professionnel au long cours et à 78 ans toujours « voileux » ,certes modeste ,mais toujours « voileux » , si vous permettez ,je ne vois moi que les bateaux & l’équipage .
Quand je dis bateaux ,j’entends : une coque ! Pas autre chose !
Bien entendu chacun son avis ; sauf que votre serviteur n’apprécie pas les tri et autres cata *,encore moins les skippers porte-enseignes .
*Imaginez qu’un jour ,seuls les catamarans aient droit de pontons : Où les mettriez-vous ?
Pas d’ostracisme. Moi j’aime les catas, je n’en fais pas toute une histoire et je n’interdis pas aux amoureux des monocoques de naviguer.
Bon vent quand même.
bonsoir radius ,c’est seulement un choix esthétique ,et par tradition ,tout un chacun étant libre de ses propres choix . Mon souci est d’ordre pratique , partant la plaisance ne pourra plus être accessible à ceux qui souhaitent vraiment naviguer ,si les ports (déjà pleins ) sont emplis d’unités prenant la place de 2 bateaux ordinaires .
C’est le principe des forces spéciales dans le monde entier.
Une formation commune.
Des test de sélection renforcant l’esprit d’élite et de corps.
Une spécialisation au sein de l’équipe.
Un brieffing avec une mission claire et précise où chacun sait ce qu’il doit faire et ou chacun peut donner son avis pour le bien commun.
La VIE de chacun reposant sur les épaules de chacun.
Un débriefing gratifiant chaque acte de courage ou réussite technique.
Une mort qu’on peut expliquer et tenter d’éviter la prochaine fois.
Et la vie encore plus puissant que le pouvoir ou l’argent.
Et avec 10 hommes vous faites l’Histoire.
Manque plus que Juppé à la barre de ville de paris et son « casino bestiale » ..LOL
On voit dans ce superbe article de Guillaume Nicoulaud l’esprit anglo-saxon d’équipe qui nous fait tant défaut en France et que l’on ne voit apparaître que dans les grandes victoires (sportives) ou les grands conflits, quand l’esprit d’équipe et de cohésion devient si affuté qu’il permet à chaque individualité de s’exprimer dans toute son ampleur.
Personnellement dans ma carrière professionnelle de plus de 35 ans en France, je n’ai vécu ce type de phase de cohésion collective que pendant un laps de temps de 3 ans, ce qui n’est déjà pas si mal, période pendant laquelle un groupe artistique a réussi par un travail collectif distribué selon les compétences de chacun à produire un travail reconnu du monde entier. Il arrive qu’on assiste à cela sur des projets culturels à succès (films, spectacles, concerts…) dont le managering est occasionnellement miraculeux, quand la synergie des talents et la vision d’un leader permet à tous de s’exprimer totalement.
Pourquoi occasionnellement miraculeux ? Parce que la même équipe rencontrée sur un projet ultérieur ou précédent sera resté au sol, sans grand dépassement des cadres, sans élévation « quasi mystique » de tous au bénéfice du projet global.
L’alchimie des gens tient toujours à la qualité d’un projet.
Après le succès a amené la dislocation du groupe et la résurgence des égoïsmes…
Je suis la Coupe de l’America depuis les défis du Baron Bic, aussi depuis que je suis en âge de comprendre pleinement les implications technologiques et philosophiques de ce genre de défi à priori « inutiles » pour le spectateur lambda, certainement pour toutes les mêmes raisons qui doivent animer Guillaume Nicoulaud, d’amour de la voile et de la mer, des grandes épopées maritimes, certainement aussi inutiles que les courses de Formule 1, mais qui amènent invariablement des progrès dans tous les domaines (matériaux, techniques développées…).
Las, en France, on aime l’échec global et on vante l’individualité, qui devrait s’opposer (à droite) au projet collectif (à gauche). On aime, pire, on cajole le négativisme dans le même pays où naquit Emile Coué, Tocqueville et Bastiat, aussi La Fontaine qui mit des mots sur nos défauts récurrents : arrogance, suffisance, mépris hautin de la culture autre que la nôtre (la méprisable culture américaine, par exemple, si liée au succès et à l’argent)… On a pas encore compris qu’aucune individualité ne peut surgir du néant sans le groupe et qu’aucun groupe ne peut vivre et survivre sans le talent de ses individualités. Las en France, on oppose l’un à l’autre, on oppose l’argent (c’est mal !) et la pauvreté (c’est bien !). On brise les individualités, on coupe les têtes qui dépassent, on n’aime pas le succès (et l’argent qui va avec), c’est mal vu. C’est dénoncé quand les anglo-saxons n’y voient qu’un moyen et la conséquence du succès et du travail. En France un patron qui gagne de l’argent et qui emploie des gens est nécessairement un escroc, un voleur, un usurpateur, un exploiteur. Jamais un inventeur, un développeur, un génie des affaires…
Le pire de tout : les français admirent les autres français qui réussissent à l’étranger et y gagnent des sommes astronomiques, pourvu que ce succès ne soit pas obtenu en France… Le succès obtenu à l’étranger permet au français richissime de revenir après cette carrière dans son pays d’origine faire partager ses largesses et investir. Sans aucune récrimination populaire ! Le succès venant de l’étranger est légitimé. Le succès obtenu en France est nécessairement malsain, la France étant un berceau du communisme, dont l’antienne invariante est : « L’argent, c’est mal, pire, c’est le mal incarné. » Le succès financier en France est perçu nécessairement comme des sommes indument obtenues, comme le résultat d’une corruption ou d’amitiés bien placées, pas d’un talent propre et jamais d’un travail acharné. On voit ici aussi le mal endémique qui s’exprime dans l’habitude nauséabonde du népotisme qui nous rappelle si justement les errements de l’aristocratie d’Ancien Régime, des aristocraties de toutes époques (l’énarchie aujourd’hui qui n’a rien d’un recrutement qualitatif, les aristocraties professionnelles et familiales…), qui ressurgissent chez nous toujours en période de crises.
Politique et jalousie si françaises, en lieu et place de chercher à trouver un moyen de motiver des équipes et des individus dans un même sens (comme le montre si bien le managering à succès de Peter Blake dans cette campagne de 1995), autrement que par l’envie, autrement que par la carotte et le bâton si présents encore dans nos structures professionnelles à mentalité régionale, voire départementale, voire rurale, d’avant guerre (laquelle ?), toutes incapables de managering à la mode mondialisée, lieux français où l’on exerce encore les manipulations, la défiance, les oppositions de classe, le mépris social, la casse des talents, le salaire à la baisse afin d’exprimer un ordre hiérarchique issu d’un autre âge, celui du maître, afin de tordre le cou à toute velléité d’indépendance, d’intelligence, d’initiative personnelle ou de percée d’urticaire liée au talent.
On a encore rien compris en France du managering des équipes à la mode anglo-saxonne, sauf sociétés multinationales qui importent et adoptent les modèles à succès pour une question de survie dans la concurrence internationale, aussi pour attirer les meilleurs éléments qui n’ont plus de frontières et vomissent les structures trop archaïques où ils n’auraient pas pleine liberté pour s’exprimer. Quand les américains on débarqué en Normandie, ici on mettait encore le charbon dans la baignoire… Ce n’est pas ici que les modèles de Facebook, de Microsoft et d’Apple pourrait surgir dans le fond des garages, malgré les business angels… Ici, même à plus de 50 ans passés, on regarde plus encore vos diplômes que vos réussite professionnelles, votre CV. On vous demande de VAElider votre expérience (valider les acquis de l’expérience par un diplôme) pour l’actualiser aux normes actuelles de recrutement plutôt que d’agir instantanément avec vos acquis et vos qualités afin de profiter tout de suite de ce qu’ils peuvent apporter au collectif. Des années perdues, pourquoi ? Pour rien ! Ici on ne fait pas confiance à l’expérience, au talent. Il faut un DIPLOME. Et oui, c’est comme ça en France ! Dans quel pays d’attardés vit-on ? Zuckerberg comme Gates n’ont pas fini Harvard ! Que dirait-on d’un français qui n’aurait pas terminé Science Po, Polytechnique, ENS, ENA, Centrale, Navale, CNSMDP… Sa carrière serait finie avant d’avoir commencé.
Pour être honnête et finir sur une note positive, restent aussi quelques instants de magie dans le managering d’équipes françaises qui gagnent, dont souvent les éléments ont fait carrière à l’étranger (football, basket, natation…) où « gagner » n’est pas un vilain mot. Et le livre d’Aimé Jacquet le lendemain de la Coupe du Monde FIFA de1998 ne me contredira pas. Pas celui d’un fin littéraire mais celui d’un homme de terrain conquis par la gagne, à tout prix, et qui reste aussi, dans ma bibliothèque, noyé au milieu des livres d’exploits sportifs, une référence pour comprendre l’alchimie des vainqueurs et des succès. Étant jeune, on m’a appris à tendre la joue gauche quand on m’avait frappé la droite »… Drôle d’éducation qui s’oppose en toute logique à celle aussi débile définie par le « mords ou tu seras mordu ». Choisir entre le destin de JC ou de Luis Suarez ? Pas facile !
En France, le pays tire à hue et à dia. Pourtant il ne demande qu’à aller dans le même sens. Le peuple en a marre de traîner des boulets et en a marre de l’insuccès récurrent par faute d’une mentalité fâchée avec le succès et l’argent, d’un État centralisé et de politiques qui ne savent plus que promouvoir l’assistanat. L’assistanat tue les esprits conquérants et détruit toute envie de dépassement, d’esprit collectif, de succès individuel. Les forces politiques on intérêt à rendre les problématiques machiavéliques, au sortir d’une période mitterrandienne dont on ne sait si elle est close ou non, où la devise centrale, qui pourrait si facilement devenir « allons tous dans le même sens chacun dans son intérêt propre » rendrait caduque la favorite de nos édiles « diviser pour régner ».
Mais cet article comme mes commentaires ne sont certainement, en notre époque de sinistrose avancée, que des vœux pieux. Pourtant, les devises françaises les plus marquantes « impossible n’est pas français et « quand on veut on peut » ne demandent qu’une étincelle (pas celle issue des grandes écoles) pour à nouveau rallumer le feu en nos cœurs et nos esprits. Celui de la conquête (intellectuelle, culturelle, économique et sportive, les uns n’allant pas sans les autres) du monde. Le peuple français a toutes les qualités pour. Il l’a montré dans l’histoire. Nul besoin de diplômes pour être créatifs et rencontrer le succès ! C’est même l’inverse.
Les commentaires sont fermés.